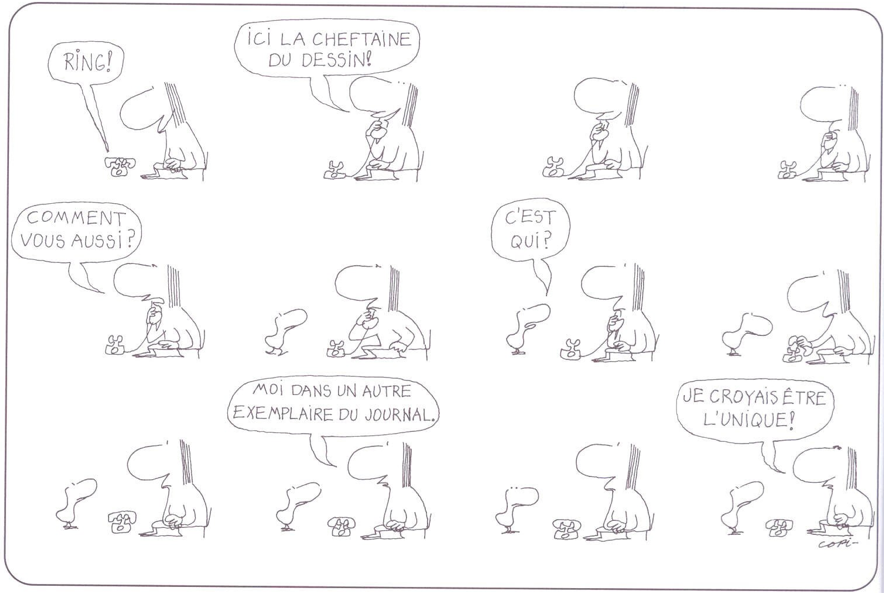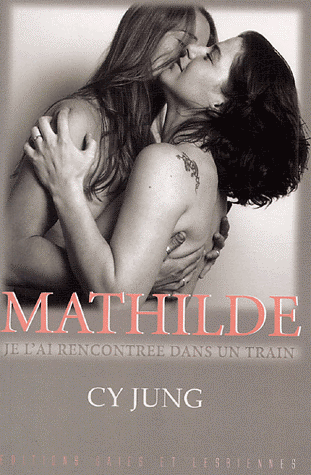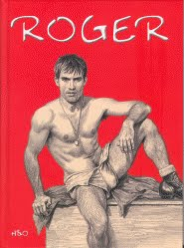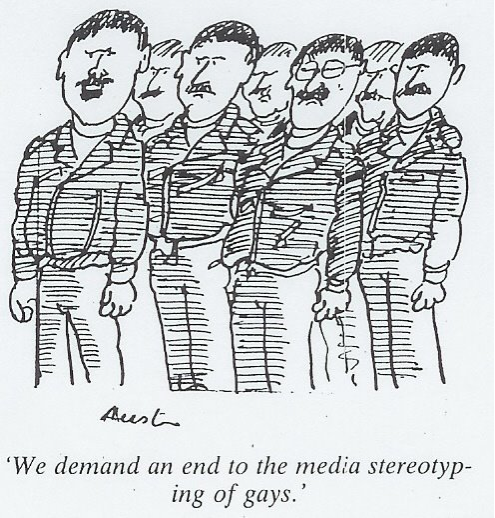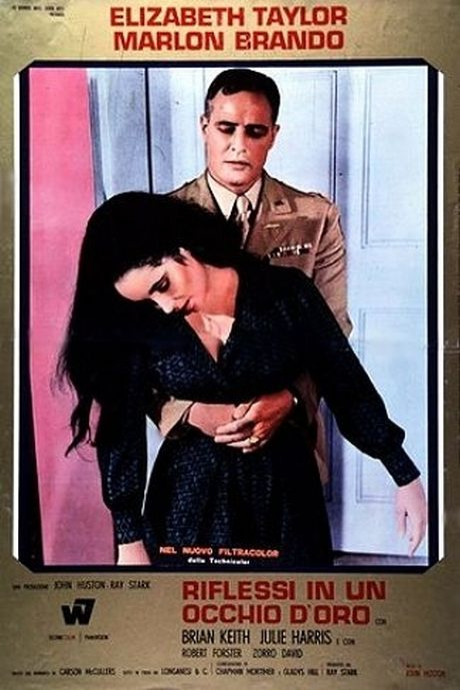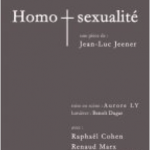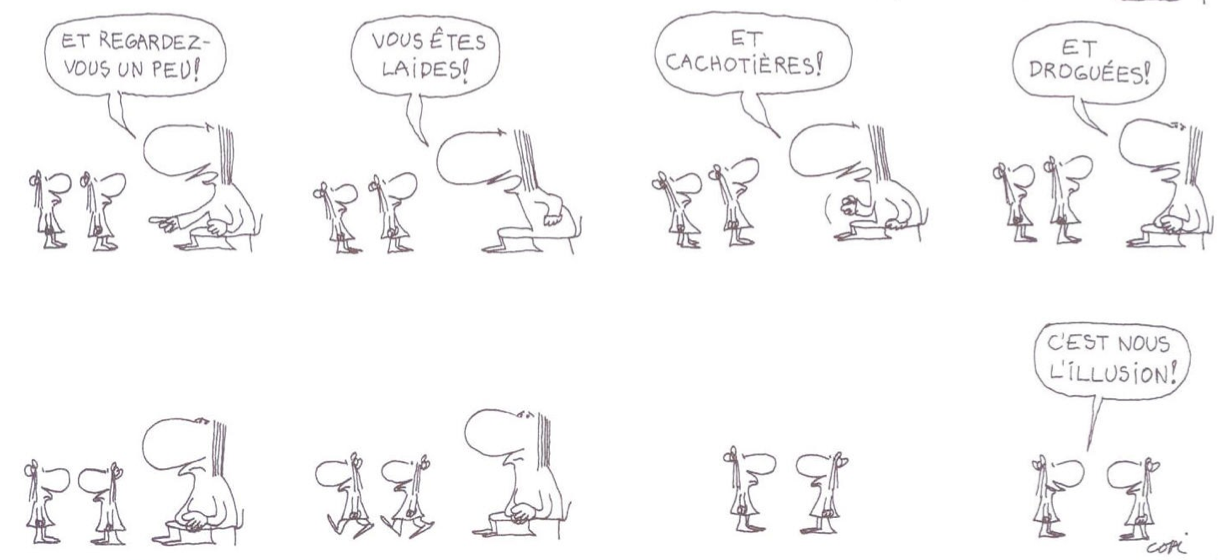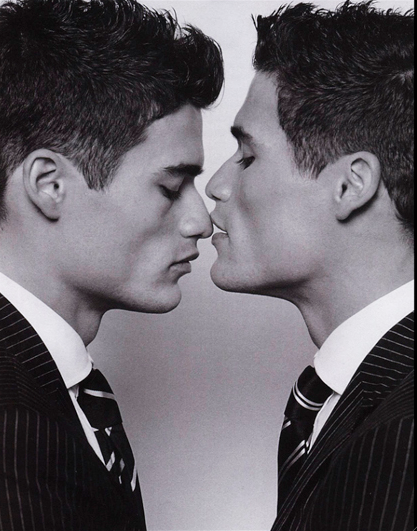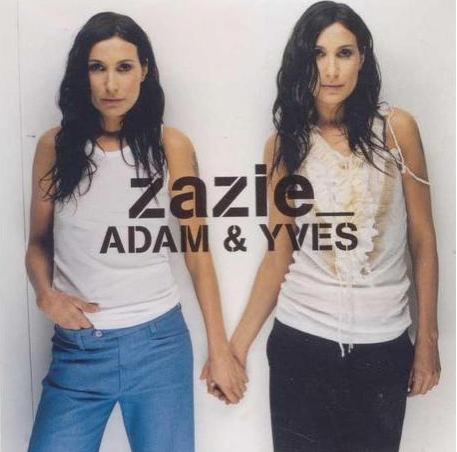Destruction des femmes
NOTICE EXPLICATIVE :
Les personnes homosexuelles : meilleurs ami(e)s des femmes ??? C’est une blague ou quoi ?
Tout est dans cette phrase : « Cette femme, j’ai aimé la haïr. » (Heinrich dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 198) En règle générale, les personnes homosexuelles pensent sincèrement aimer la femme par la haine. Quand on comprendra qu’elles entretiennent avec la femme réelle – qu’elles confondent avec la femme cinématographique – une haine jalouse, on aura touché à une des plus grandes clés de l’énigme de l’homosexualité !
C’est en me baladant (par hasard ?) au Centre Pompidou de Paris en avril 2005, à l’exposition consacrée au réalisateur homosexuel allemand Rainer Werner Fassbinder, que la misogynie du désir homosexuel m’est apparue dans toute son horreur, toute sa banalité aussi. En effet, dans un pauvre coin du sous-sol du Centre, déserté des visiteurs, était projeté sur un écran géant une succession de toutes les nombreuses scènes des films de Fassbinder où les femmes sont giflées, battues, humiliées, écrasées par des voitures, tuées, à quatre pattes… le tout diffusé sans son, dans un silence glaçant, qui passerait presque inaperçu. Je croyais rêver. Qui avait fait ce montage ? Et surtout, pourquoi un réalisateur tel que Fassbinder, qui a toujours aimé mettre les femmes au centre de sa vie et de son cinéma, en donna une image aussi désastreuse ? Je touchais là à un des grands paradoxes du désir homosexuel : adorer (quelqu’un qui n’est pas Dieu) n’est pas aimer, mais en fin de compte souhaiter détruire. Et j’ai trouvé un élément de réponse à ce paradoxe de la vénération homosexuelle de la femme dans mon propre rapport aux femmes réelles et cinématographiques, et dans le rapport des personnes homosexuelles elles-mêmes à la gent féminine. Je me suis dit qu’il n’y avait pas d’amour dans tout cela : il y avait surtout de l’idolâtrie. Une fascination identificatoire inconsciente, qui ressemble à de l’Amour ou à de la rêverie, mais qui est en réalité du fanatisme destructeur. Pour nier cette violence en germe, la société s’amuse à faire croire au mythe d’un légendaire copinage entre les garçons « sensibles » et les filles. Mais avons-nous de la merde dans les yeux pour croire encore à cette fausse idylle amicale ?
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Bergère », « Prostitution », « Matricide », « Violeur homosexuel », « Femme vierge se faisant violer un soir de carnaval ou d’été à l’orée des bois », « FAP la « fille à pédé(s) » », « Personnage homosexuel empêchant l’union femme-homme », « Actrice-Traîtresse », « Poupées », « Sirène », « Duo totalitaire lesbienne/gay » et « Carmen », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
La faute impardonnable
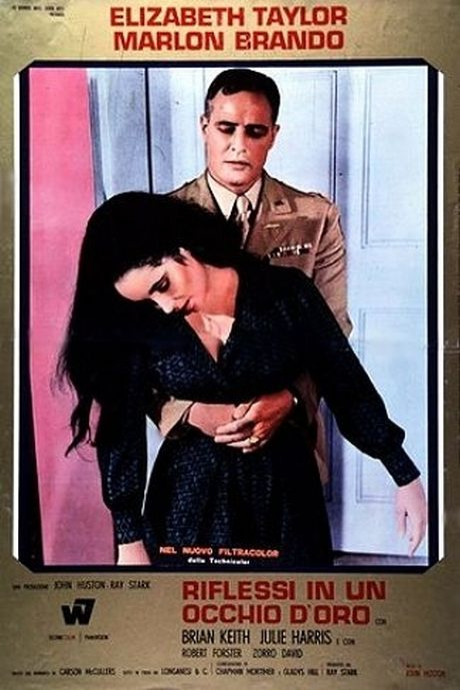
Film « Reflets dans un œil d’or » de John Huston
Comme la femme réelle (non-hétérosexuelle et non-homosexuelle) ne correspond évidemment ni à son image parfaite de victime blonde ni à celle de tigresse machiavélique toute-puissante, elle finit par apparaître comme une traîtresse décevante aux yeux de beaucoup de personnes homosexuelles qui pensaient s’être mis en quatre pour la mettre sur un beau podium. « C’est ça que je n’aime pas chez la femme : c’est cette fragilité. » (Alain dans le reportage « Jeune homme à louer » (1992) de Mireille Dumas) ; « L’imperfection du féminin est la plus grande des fautes. » (la Reine Christine, pseudo « lesbienne », dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; etc. La femme-objet, qui leur avait promis de ne jamais collaborer avec l’ennemi bourgeois capitaliste et patriarcal, de rester éternellement vierge, n’a pas tenu ses promesses. Mais plus que pour son indécence, elle est fautive de ne pas parvenir à être universelle ni totalement réelle, de ne pas devenir celui qui désire s’y identifier. Elle incarne un rêve collectif impossible que beaucoup de personnes homosexuelles ont elles-mêmes construit ou contribué à fomenter : c’est là son seul crime… mais il est énorme ! Beaucoup de personnes homosexuelles décident alors de se venger des simples femmes « mortelles » qui les entourent et de prendre leur distance avec elles. La plupart du temps, l’ensemble des femmes réelles paient pour la trahison d’une poignée d’actrices opportunistes et lâches. Dans les créations homosexuelles, ce sont souvent les personnages impuissants et homosexuels qui finissent par violer leur idole féminine ou leur meilleure amie.
La misogynie homosexuelle inattendue

Planche « Sida » dans la B.D. « Le Monde fantastique des gays » de Copi
Actuellement, les media et la communauté homosexuelle se plaisent à nous faire croire que les personnes homosexuelles sont les meilleurs amis des femmes (cf. l’article « George Cukor, l’homme qui aimait les femmes… (jusqu’à un certain point !) », sur le site suivant). Rien n’est plus faux ! Certains hommes gay, connus pour être doux comme des agneaux avec les filles (ils passaient parfois leur temps en leur compagnie depuis la cour d’école), ou les « hommes de compagnie » des vieilles bourgeoises, se prennent volontiers pour l’antithèse des « machos ». Mais il suffirait qu’ils se penchent un peu sur leurs propres discours, créations artistiques et fantasmagorie pour changer d’avis ! Il y a parmi eux énormément de misogynes qui à la fois s’ignorent et qui revendiquent ouvertement leur aversion pour les femmes.
Ne nous y trompons pas. Beaucoup de personnes homosexuelles n’ont pas compris la femme réelle, et veulent régler leurs comptes avec celle qui leur aurait imposé un « martyr d’amour à dix-huit ans » (Arthur Rimbaud, Un Cœur sous la soutane, 1869-1872) parce qu’elles ont eu le malheur de la sacraliser dans leur jeunesse. Elles n’ont majoritairement perçu que l’enveloppe émotionnelle, sentimentale, plastique ou scientifique, de la femme, celle qui ne donne pas envie de percer plus loin le mystère féminin. Elles célèbrent une femme idéale qui n’est pas la femme réelle. La femme de chair et de sang, elles la transforment en « spectre du sex-appeal » (comme dirait Salvador Dalí), en caricature de petite fille modèle ou de matrone autoritaire, en monstre sacré intouchable avec qui elles pourraient maintenir une relation platonique à distance. Mais au fond, elles passent à côté.
Certaines psychanalystes féministes actuelles qui annoncent que l’arrivée des personnes homosexuelles et des femmes aux commandes du monde audiovisuel et professionnel va « préserver l’image de douceur de la femme » (Loïs Bonner dans le documentaire « Pin-Up Obsession » (2004) d’Olivier Megaton) se voilent complètement la face, surtout quand nous prenons conscience que la plupart des membres de la communauté homosexuelle, en collaboration avec des individus machistes et hétérosexuels (Russ Meyer, John Waters, et bien d’autres), ont contribué à construire et à intérioriser des images insultantes ou déréalisées de la gent féminine. Les personnes homosexuelles sont héritières, et parfois conceptrices, de la culture de l’image violente de la femme née après la Seconde Guerre mondiale (cf. je vous renvoie à l’important documentaire d’Olivier Megaton, « Pin-Up Obsession », diffusé sur la chaîne ARTE le 21 novembre 2004, et qui retrace l’inquiétante histoire de la vision de la femme dans nos médias).
Le paradoxe se situe dans le fait que la misogynie homosexuelle passe par la glorification de la femme imagée. Au cinéma par exemple, certains réalisateurs homosexuels ont parfois le don de la sublimer, de la rendre magnifique, de capter finement la psychologie et la sensibilité féminines. Et pourtant, c’est précisément parce qu’ils prétendent résoudre comme une équation esthétique ou émotive celle qui restera pour eux un mystère corporel et symbolique tant qu’ils se déroberont à elle qu’ils passent précisément à côté de son identité profonde. Catherine Breillat a tout à fait raison de parler du « regard intégriste sur la femme » (« Entretien… avec Catherine Breillat » (2004) de Gaillac-Morgue) porté par la majorité des individus homosexuels, car tel est le cas, y compris dans l’idéalisation.
Par leur imitation de la femme glamour, beaucoup de personnes homosexuelles ne rendent pas hommage à la femme réelle puisqu’elles la réduisent à une poupée Barbie, à une chanteuse sophistiquée de music-hall, ou à une actrice de films X. Le travestissement (chez les hommes gay) ou le refus radical du travestissement féminin (chez les femmes lesbiennes, et même chez les personnes transsexuelles : pour se dire travesti, il faut déjà avoir conscience d’être déguisé ; or, comme pour certaines, le déguisement est leur être profond, elles ne pensent pas se travestir (Vincent McDoom dans le magazine Égéries, n°1, décembre 2004/janvier 2005, p. 52) !) se veulent un chant à la femme. En réalité, il s’agit pour elles d’être « plus que femme », d’imiter la bombe sexuelle ultra-siliconée ou la grande actrice hollywoodienne. Au bout du compte, la surféminité est conquise par un dépassement du féminin, une caricature de femme-objet, ou (pour le cas lesbien) un rejet viscéral du « féminin d’accessoire » se traduisant par son absorption inconsciente par une sur-virilité d’apparat.
La passion homosexuelle pour la femme cache en réalité un sublime mépris. Plus les actrices connaissent un destin tragique, un succès foudroyant et éphémère, une réputation de pestes, plus elles ont de chances de devenir des icônes gay. Nous ne sentons pas d’amour entre les personnes homosexuelles et la femme médiatique. C’est bien plus fort et plus vil que cela. On va jusqu’à la folie passionnelle du fan prêt à défigurer sa star pour s’approprier le droit d’être le seul à la violer iconographiquement. Les artistes homosexuels qui toute leur vie ont le plus célébré la femme sont aussi ceux qui l’ont le plus maltraitée, au moins à l’écran, et parfois concrètement. C’est une triste réalité qu’il faut bien reconnaître.
Il arrive aussi que les femmes lesbiennes s’attaquent énormément aux femmes. Je peux vous assurer qu’on rencontre beaucoup plus de femmes machistes et misogynes dans les rangs lesbiens que parmi les femmes et les hommes dits « hétérosexuels ». Ces femmes si heureuses d’être « plus que des hétérosexuelles » méprisent très souvent les femmes mariées, bisexuelles, ou trop conformes aux canons de la beauté féminine définis par les media. Elles associent en général leur beauté de femmes à la superficialité, la maternité au summum de la soumission, l’engagement dans le mariage à un emprisonnement et un viol, la réalité de leur nature spécifique de femmes à une simple étiquette culturelle ou à un destin anatomique aliénant. Il n’est pas rare d’en entendre certaines – celles qui paradoxalement se battent pour l’homoparentalité ou le mariage gay – mépriser les femmes enceintes (Anne Hurtelle dans l’émission Ça se discute, sur la chaîne France 2, le 18 février 2004) en les traitant par exemple de « poules pondeuses » (véridique).
Croire que les femmes ne peuvent pas être machistes est précisément une attitude machiste. Le machisme, au fond, n’est que le mépris ou la célébration excessive de la faiblesse humaine : il n’a pas, comme certains se plaisent à le croire, de sexe ni d’orientation sexuelle prédéfinis. Beaucoup de femmes lesbiennes n’aiment pas la femme réelle, même si elles prétendent la défendre par une image victimisante. En voulant tirer la couverture à elles sous prétexte qu’elles seraient femmes (… éternellement spoliées et fières de l’être), elles oublient que le machisme est également l’affirmation d’une homosexualité féminine assumée. Cathy Bernheim, dans son autobiographie L’Amour presque parfait (2003), a tout dit quand elle écrit qu’« elle doit être un peu macho quelque part, au niveau du désir » (p. 132). Le lesbianisme semble être majoritairement une obéissance docile aux codes du machisme et du matriarcat, tout comme l’homosexualité masculine. Que certaines femmes lesbiennes ne s’étonnent pas que tout comportement ou apparence relevant du masculin social violent soit souvent perçu comme symptôme de lesbianisme. Les plus bisexuelles d’entre elles sont généralement les premières à affirmer que les hommes dits « hétérosexuels » sont en général bien plus doux avec elles que ne le sont leurs camarades lesbiennes, les premières aussi à dénoncer leur misogynie et leur haine d’elles-mêmes traduite en misanthropie (Marguerite Yourcenar, Le Coup de grâce (1938), citée dans la biographie Marguerite Yourcenar (1990) de Josyane Savigneau, p. 144).
La misogynie enrubannée de rose
Au lieu d’avouer frontalement aux femmes réelles qu’elles les rejettent via les femmes médiatiques et qu’elles les considèrent comme des putains, les personnes homosexuelles s’y prennent généralement de manière plus clean, avec des gants de velours. L’éjection se pare des meilleures intentions. L’excuse n° 1, en théorie très valable, trouvée par bon nombre d’hommes gay pour ne pas aller vers les femmes réelles, c’est l’évitement des souffrances : « Si je vais vers une femme, elle souffrira, et moi aussi. » Mais cette souffrance est bien souvent écrite avant qu’elle n’arrive. Certains supportent mal d’entendre Serge Lama chanter que « les amitiés particulières, c’est quand les filles nous font peur ». Mais il n’a pourtant pas tort. Beaucoup d’entre eux sont tétanisés par la femme, et camouflent leur peur par la fausse proximité et l’idolâtrie sincère ou singée. Ils envisagent, à tort mais non sans bons motifs, l’union sexuelle avec la femme comme l’inceste diabolique qu’elle n’est pas, puisqu’ils ont pour la plupart mis leur mère à la place de la femme.
Pour convaincre les femmes réelles de ne pas insister en matière d’amour, ils jouent les pestiférés homosexuels, inconsciemment troublés par une maladie incurable qui les dépasse. « Juan-Carlos oserait-il proposer le mariage à une femme s’il connaissait la gravité de son mal ? » (Manuel Puig, Boquitas Pintadas, Le Plus beau tango du monde (1972), p. 120) Ils pensent que les obus de Madonna ou de Dolly Parton les perforeront, que le passage à l’acte sexuel les fera disparaître – au moins symboliquement –, c’est-à-dire qu’il leur fera oublier qui ils sont, les rendra éternellement malheureux parce qu’ils vont commettre un meurtre et voir dans le visage de leur femme pénétrée par eux l’expression de la femme cinématographique violée. « Richard avait un grand respect du corps des femmes. Presque trop. Il avait toujours peur de faire mal. » (la compagne de Tanguy dans le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume) Ils trouvent cette peur de la sexualité anormale et révélatrice d’une identité minoritaire normale – l’homosexualité –, alors que pourtant, aucun homme ne s’aventure sans crainte dans le sexe de la femme, qu’il soit homosexuel ou dit « hétéro ». La sexualité nous met en face de nos richesses et de nos propres morts : ce n’est ni dramatique ni anodin.
La misogynie homosexuelle prend parfois une forme plus subtile : celle de la sincérité, de la « mixité de circonstance », celle de la camaraderie temporaire, de l’amitié adolescente en apparence désintéressée… mais en réalité, très intéressée (cf. je vous renvoie au code « FAP la « fille à pédés » » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) et qui cache une grosse misère affective, et du côté de la dénommée « fille à pédés » ( = FAP) et de celui de l’individu homosexuel.
L’hypocrisie de l’intégration forcée de la différence des sexes dans un cadre (= le couple homosexuel) qui la rejette trouve son climax dans la simulation de mixité femme-homme au sein de la communauté homosexuelle. J’aborde très largement le rejet des femmes lesbiennes par les hommes gay dans le code « Duo totalitaire gay/lesbien » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) La misogynie homosexuelle en mots :

Film « Teorema » de Pier Paolo Pasolini (et la bonne enterrée vivante…)
On retrouve le personnage homosexuel haïssant la femme dans énormément de productions artistiques homo-érotiques : cf. la pièce Hamlet, Prince de Danemark (1602) de William Shakespeare (avec la légendaire misogynie du héros), le film « Reflection In A Golden Eye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston (avec Weldon, l’ours mal léché, méprisant Leonora), la chanson « Cette fille est une erreur » du groupe Taxi Girl, le roman Les Jeunes Filles (1936) d’Henri de Montherlant, le film « Le Petit César » (1930) de Mervyn LeRoy (avec le personnage de Rico), le film « L’Aurore » (1927) de Friedrich Wilhelm Murnau, le film « Amours particulières » (1969) de Gérard Trembaciewicz, le film « Lonesome Cowboys » (1968) d’Andy Warhol, le film « Je vous hais petites filles » (2008) de Yann Gonzalez, la chanson « Henri, pourquoi n’aimes-tu pas les femmes ? » de Dranem, etc.
Le héros homosexuel se désigne lui-même comme misogyne, ou bien est traité de misogyne par un autre personnage : « Nous, les lopes, misogynes et misanthropes » (les quatre comédiens de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « C’est un avantage d’être pédé : au moins, on n’a pas à supporter ces connasses ! » (le Dr Labrosse parlant des femmes, dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Elles sont idiotes ! » (Étienne et Bill s’adressant à deux de leurs partenaires féminines, dans le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy) ; « À l’exception de Cossima, vous avez méprisé les femmes. » (Wagner à Nietzsche, dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman) ; « Pédale misogyne, va ! » (Daphnée à Luc dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Misogyne en plus… Enfin, ça, c’est pas un scoop… » (Frédérique, l’héroïne lesbienne à son camarade gay Romuald, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « Son histoire était un concentré de tous les préjugés les plus misogynes. Les filles y étaient présentées comme des caricatures de femelles. Des goules anthropophages, lubriques et frigides à la fois. » (la voix narrative à propos de l’histoire racontée par Jason le héros homosexuel, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 65) ; « Je me méfie des femmes. Comme toi. » (Harge, le héros hétérosexuel, s’adressant à sa femme Carol, l’héroïne lesbienne, dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes) ; etc.
L’homosexualité est parfois montrée comme la cause ou la conséquence directe de la misogynie ou de la misandrie (haine des hommes) : « À cause d’une femme, il en veut à toute ! » (Jean-Luc parlant de son amant Romuald, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) Par exemple, dans le film « Plan B » (2010) de Marco Berger, le couple d’amants gay se forme sur la base d’un plan de vengeance contre l’inconstance amoureuse des femmes. Dans la pièce Lettre d’amour à Staline (2011) de Juan Mayorga, l’écrivain Boulgakov, sous l’emprise d’un Staline homosexuel, rejette sa femme Boulgakova, et ne ressent plus rien au lit avec elle : « Tu te sens coupable d’être avec moi plutôt qu’avec elle… » dira Staline, satisfait. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, la misogynie de Georges, l’homme marié bisexuel, va s’accroître à mesure qu’il choisit de devenir un homosexuel exclusif : « Les femmes sont de plus en plus insupportables. » Il se met à rêver d’un monde sans femmes, puis s’en excuse à peine : « On ne peut pas s’empêcher d’espérer l’impossible. C’est humain. »
Chez le héros homosexuel, l’aversion pour la gent féminine se manifeste par le désintérêt : cf. la pièce A Woman Of No Importance (Une Femme sans importance, 1894) d’Oscar Wilde, le film « On est toujours trop bon avec les femmes » (1970) de Michel Boisrond, le film « A Mí, Las Mujeres, Ni Fu Ni Fa » (« Les femmes, ni chaud ni froid », 1972) de Mariano Ozores, etc. « Une femme sur les bras ? Qu’est-ce que j’en ferais ? » (Serge dans le film « L’Invité de la onzième heure » (1945) de Maurice Cloche) ; « Le pouvoir et les femmes ne m’intéressent pas. » (Thibaut de Saint Pol, Pavillon noir (2007), p. 13) ; « Faut pas croire. C’est bien, une femme. Ça tient compagnie. Mais après, ça peut devenir très chiant, une femme, quand ça s’y met. » (le héros homosexuel dans la pièce Big Shoot (2008) de Koffi Kwahulé) ; « Sacré boulet, cette Wendy… » (Clark dans la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès) ; « La meilleure femme ne vaut pas un bon cheval. » (une réplique du film « Le Banni » (1941) d’Howard Hawks et Howard Hughes) ; « Les femmes se sont tellement émancipées. » (le Dr Katzelblum, homosexuel, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; « Pour moi, on ne peut pas faire confiance à une femme. » (Arnaud, homo, idem) ; « Si seulement elles avaient le sens de l’humour… » (le Dr Katzelblum, idem) ; « Aaaaah les femmes… Y’a toujours quelque chose de dérangé dans ces machines compliquées. » (Monsieur de Rênal, le mari efféminé de Louise, dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir (2016) d’Alexandre Bonstein) ; « Quelle machine compliquée que la femme. » (idem) ; etc. Par exemple, dans le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder, quand Joe demande à son ami Jerry lui annonçant qu’il va se marier avec un homme « Pourquoi un homme en épouserait un autre ? », Jerry lui répond du tac au tac : « Pour être tranquille. »
Mais bien souvent, l’indifférence laisse place au mépris et à l’insulte claire et nette : « Je parle à vous, femmes traîtresses ! » (Cachafaz à ses voisines, dans la pièce éponyme (1993) de Copi) ; « Ô femelles ennemies ! » (Jean-Luc, le héros homosexuel de la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali) ; « Une dame ici ?!? Ce ne peut être que ma belle-sœur. Dites-lui que j’ai détesté sa robe de chambre et que je n’ai pas l’intention de les recevoir. » (Cyrille, le héros homosexuel de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « Je ne veux pas mourir assassiné par une femme. J’ai passé ma vie à fuir les femmes ! » (idem) ; « Les vraies femmes ?!? Ça va pas ! Quelle horreur !!! » (Pedro dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphane Druet) ; « Il en faut du courage pour supporter les gonzesses ! Moi j’ai encore du mal ! Ah moi j’assume, je déteste les femmes. » (la bourgeoise de la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « Sacré monstre ! » (Ignace à propos de sa future belle-fille, dans la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz) ; « Putain de femelles. C’est toujours aux gars de se taper le boulot ! » (l’amant de Gary dans le film « À la recherche de M. Goodbar » (1977) de Richard Brooks) ; « Aaaah les femmes… J’aurais dû épouser un âne ! […] Voyez-vous cher ami, les femmes, c’est pervers. » (Didier s’adressant à son amant Bernard, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Putain de meufs ! » (Matthieu, le héros homosexuel du film « Prora » (2012) de Stéphane Riethauser) ; « Donatienne est en cuisine. Après tout, c’est une femme. » (Bernard, le héros homo parlant de sa meilleure amie, dans la pièce Nous deux (2012) de Pascal Rocher et Sandra Colombo) ; « Y’a tant de femmes ! Y’a tellement de femmes ! Pourquoi l’a-t-il épousé ? » (Cal – interprété par James Dean – parlant de son frère, dans le film « East Of Eden », « À l’Est d’Éden » (1955) d’Elia Kazan) ; « Moi ?!? Être une femme ?!? Oh quelle horreur ! » (Samuel Laroque dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « C’est toutes des sacs à foutre, les bonnes femmes ! » (Simoney dans le film « Cruising », « La Chasse » (1980) de William Friedkin) ; « J’ai envie de pisser comme une femme enceinte. » (Smith, le héros homosexuel, dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki) ; « Vous êtes connes comme des bourriques ! » (Bacchus s’adressant aux trois sœurs Minias, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré) ; « Une fille moche, ça va sans dire… » (Rodolphe Sand parlant de Rosetta, dans son one-man-show Tout en finesse, 2014) ; « Voici ce qui se passe quand on laisse sortir les femmes de la cuisine ! » (Jean-Jacques, l’un des héros homosexuels refoulés de la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis) ; « Elle va se taire, la pintade ! » (Ruzy, le héros homosexuel s’adressant à Marilyn, dans la pièce Happy Birthgay Papa ! (2014) de James Cochise et Gloria Heinz) ; « Tu ferais mieux de rentrer chez toi faire tes lessives ! » (Marjan et sa pote s’adressant à Rana, chauffeur de taxi femme, dans le film « Facing Mirrors : Aynehaye Rooberoo », « Une Femme iranienne » (2014) de Negar Azarbayjani) ; etc.
Par exemple, dans la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant, l’Infante lesbienne trouve la femme – qu’elle idéalise en la personne d’Inès de Castro – trop « molle ». Dans le film « Love, Simon » (2017) de Greg Berlanti, Simon, le héros homo, est « très exigeant avec les filles », selon les dires de sa meilleure amie Leah. Dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde, après avoir adulé l’actrice Sibylle, Dorian Gray la méprise suite à une représentation décevante : « Tu as tout gâché. Tu es vaine et stupide. » Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Jonathan, l’un des héros homosexuels, insulte une femme dans le public de « vieille conne ! » simplement parce qu’il la fait rire. Dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, Jean-Paul, le héros homosexuel (rentrant un instant dans la peau de Léonard de Vinci) dit à Catherine (interprétant Mona Lisa) qu’elle est « du caca ». Dans le one-man-show Au sol et en vol (2014) de Jean-Philippe Janssens, Jeanfi, le steward homo, qualifie les femmes de « bombonnes de merde » : « Les femmes, tu les déplaces, elles se constipent. »
Dans le film « Noureev, le Corbeau blanc » (2019) de Ralph Fiennes, le danseur et chorégraphe homo Rudolf Noureev est misogyne et ignoble avec les femmes, en particulier avec son amie Clara Saint qui semble pourtant amoureuse de lui. Il lui demande d’« arrêter de poser des questions idiotes ». Il refait le même procès en « idiotie » à Xenia, sa prof de danse. Plus tard, avec le plus grand sérieux, il insulte Clara en plein restaurant : « Fuck you ! ». La jeune femme n’est pas rancunière puisqu’après l’avoir emmené dans des clubs de danseuses dénudées, elle l’absout de toutes les crasses et de tous les coups bas qu’il lui a fait subir : « Je te pardonne d’être le plus égoïste des hommes. » dit-elle.
Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Rémi et Damien se rencontrent dans une laverie. À priori chacun est hétéro, mais les femmes dont ils parlent sont soit invisibles (Marie, la copine de Damien, et l’ex de Rémi), soit transsexuelles (Vanina). Elles sont tellement dématérialisées que Rémi finit par tomber amoureux de Damien. « Marie ne m’a pas remplacé par un con. Elle a toujours bon goût. » La femme est éjectée du triangle amoureux, après avoir été flattée et exploitée. « J’arrête. Toutes des chieuses ! » (Rémi justifiant son célibat) Les deux hommes découvrent de la lingerie féminine (culotte et soutien-gorge) oublié dans une des machines à laver de la laverie. Au départ, ils singent l’excitation, mais très vite, les dessous affriolants suscitent chez Damien (pourtant en couple avec une femme) le plus grand des dégoûts : « C’est une pute !! Salope !! »
Dans son one-man-show Fabien Tucci fait son coming-outch (2015), Fabien, le héros homosexuel, ne mâche pas ses mots quant à la gente féminine : « Elles sont vivaces, ces p’tites bêtes. » ; « J’ai été obligé de laisser Cécile étendue sur le sol. C’est pas grave, c’est qu’une fille. On s’en fiche. » ; « Il y a une fille dans mon lit !! Qu’est-ce que je vais faire avec ça ?? J’espère qu’elle ne va pas me toucher, la vicieuse ! Je ne suis pas un sex-toy, Mademoiselle ! » ; « C’est mal fichu, une fille. Il manque l’essentiel ! » ; « C’est pas drôle d’être homo. Y’en a marre, je deviens hétéro. Comment ça marche, une fille ? Ça mange quoi ? Ça boit quoi ? Faut arroser combien de fois par jour ? »
Dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit, Arnaud, l’un des héros homos, a des démêlés professionnels avec une collègue de boulot qui l’emmerde. Benjamin, l’amant d’Arnaud, surenchérit : « La peste ! » ; « C’est une sale petite peste de pute de connasse de merde ! » Plus tard, quand Arnaud découvre que Benjamin a eu, dans son parcours amoureux, une aventure avec une femme, lui pique une crise de jalousie : « Quoi ?!? Tu t’es tapé une meuf pour de vrai ?!? Mais c’est dégueulasse !! C’était une lesbienne, c’est ça ?!? »
Les femmes sont présentées comme des godiches, des bourgeoises sans cervelle, ou bien des caricatures de féminité fatale/violée, dans des créations telles que le film « Another Gay Movie » (2006) de Todd Stephens, le film « Girls Will Be Girls » (2004) de Richard Day, la pièce Jeffrey (1993) de Paul Rudnick, la pièce Les Homos préfèrent les blondes (2007) d’Eleni Laiou et Franck Le Hen, le film « Urbania » (2004) de Jon Shear, le film « Boat Trip » (2003) de Mort Nathan, le roman El Día Que Murió Marilyn (1969) de Terenci Moix, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, etc.
Par exemple, dans la comédie musicale Les Miséreuses (2011) de Christian Dupouy, on assiste à une parodie de la chanson « Être femme » de Nicole Croisille, transformée pour l’occasion en « Être infâme », qui en dit long sur ce que pensent les concepteurs de la pièce sur l’essence féminine…
Dans la bouche de beaucoup de personnages homosexuels, la féminité est associée à la violence, à la jalousie, à l’hystérie, au caprice, à la médisance, au danger sexuel, à l’animalité. Par exemple, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson, Zize, le travesti M to F, méprise les femmes enceintes, comparées à des « cachalots » ou à des vaches qui « mettent bas », et montre la jalousie comme une caractéristique typiquement femelle : « Toutes les femmes du mariage étaient jalouses. » Dans le film « Toute première fois » (2015) de Noémie Saglio et Maxime Govare, Nounours, l’un des héros homos, est un artiste d’art contemporain qui peint des vagins en forme de nénuphars roses… et tout le monde trouve ça moche et ignoble.
b) Toutes des guenons !

Film « Cabaret » de Bob Fosse
Il arrive même au héros homosexuel de comparer les femmes à des êtres laids, des cruches décervelées, et même des singes ! : « Ce qui rend les femmes bêtes, c’est d’avoir la cervelle en trop. » (le travesti M to F Charlène Duval, dans son one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines, 2011) ; « Tous les deux, si on les écoute, toutes les filles sont moches, seuls les mecs sont des tops models ! » (la mère de Bryan parlant de son fils et du petit copain de ce dernier, dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 410) ; « Je préfèrerais coucher avec un chimpanzé plutôt qu’avec Martine. » (Jules le héros homosexuel s’adressant à Martine, la prostituée, dans la pièce Les Sex friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) ; « Regarde ces jambes de guenon. J’ai même pas eu le temps de m’épiler. » (Gwendo, la « fille à pédés », dans le one-man-show Hétéro-Kit (2011) de Yann Mercanton) ; « Elles étaient allées chez Jacques Desinges. » (Zize, le travesti M to F décrivant les belles jeunes femmes en compétition au concours de Beauté avec lui, dans le one-(wo)man-show Zize 100% Marseillaise (2012) de Thierry Wilson) ; « On dit à la Comédie Française qu’on choisit toujours des filles de concierge qu’on habille en singe… » (l’efféminé Villedieu – Jean-Claude Brialy – dans le film « Le Juge et l’Assassin » (1976) de Bertrand Tavernier) ; etc.
Très souvent dans les fictions homosexuelles, la féminité est liée à un animal, la guenon : cf. la pièce On vous rappellera (2010) de François Rimbau (avec le singe en peluche de Léonore, l’héroïne lesbienne), le concert Le Cirque des mirages (2009) de Yanowski et Fred Parker (avec la référence à « une vieille rombière fagotée comme une guenon »), le roman The Well Of Loneliness (Le Puits de solitude, 1928) de Marguerite Radclyffe Hall (avec Mme Blackeney comparée à un singe, p. 367), le roman Le Singe et la Sirène (2001) de Nicolas Dumontheuil et Éliane Angéli, la chanson « Where’s My Girl… And Where’s My Monkey ? » d’Étienne Daho, la chanson « Adelaïde » d’Arnold Turboust (« De temps en temps, je vous observe quand votre singe vous promenez. »), le vidéo-clip de la chanson « Land Of Confusion » du groupe Genesis, la pièce Le Retour au désert (1988) de Bernard-Marie Koltès, le film « The Monkey’s Mask » (2001) de Samantha Lang, le roman N’oubliez pas de vivre (2004) de Thibaut de Saint Pol (où la khôlleuse est comparée à une « guenon »), le film « Dans la peau de John Malkovich » (1999) de Spike Jonze, le roman Autopsie d’un petit singe (1998) d’Andrea H. Japp, le film « Rebel Without A Cause » (« La Fureur de vivre », 1955) de Nicholas Ray (avec la scène de Natalie Wood qui, au moment de sortir son miroir de poche pour se refaire une beauté, se fait comparer à un singe), la pièce L’Autre monde, ou les états et empires de la lune (vers 1650) de Savinien de Cyrano de Bergerac, le spectacle musical Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte (avec la femme-guenon), le film « All Men Are Apes » (1965) de Joseph P. Mawra, le film « B. Monkey » (1998) de Michael Radford, la chanson « Monkey Me » de Mylène Farmer, le film « Cabaret » (1972) de Bob Fosse (avec le Maître de cérémonie, très efféminé, mimant un mariage avec une guenon en robe de mariée), le roman La Journée de la guenon et le patient (2012) de Mario Bellatin, le film « La Forme de l’eau » (« The Shape of Water », 2018) de Guillermo del Toro, etc.
Aussi surprenant et insultant que cela puisse paraître, la femme-singe est un archétype de la fantasmagorie homosexuelle : « cette singe d’Élise » (Julien Green, Si j’étais vous (1947), p. 202) ; « À son tour, Leyla gesticulait contre mon flanc en manquant de me faire tomber. Singe qui singe sa guenon, agacée, je l’envoyais rouler sur le parquet. » (Nina Bouraoui, La Voyeuse interdite (1991), p. 130) ; « C’est pas à une vieille guenon qu’on apprend à faire la grimace… » (Grany dans le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte) ; « On avait dit ‘Pas celle avec le singe’. » (Patrick Bruel quand Michèle Laroque le menace de dévoiler sa sex-tape avec la marionnette Jean-Marc, dans Mission Enfoirés 2017); etc.
Par exemple, dans la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz, Yvonne, la femme-objet blonde, est imitée en macaque ; un peu plus tard, elle est qualifiée de « guenon ». Dans la pièce Nietzsche, Wagner, et autres cruautés (2008) de Gilles Tourman, Nietzsche traite Salomé de « petit singe » ; par la suite, Élisabeth la nomme « singe rachitique » ; Goebbels renchérira : « On représente la femme sous la forme d’un gorille. » Dans la pièce À plein régime (2008) de François Rimbau, Lola est traitée de « vieille guenon ». Dans le roman L’imposture (1927), Jules, le jardinier-masseur homosexuel, ancien légionnaire est mis en scène par Georges Bernanos. Il sert le critique littéraire obèse Henri Guérou que vient visiter M. Pernichon. Une fillette fait irruption dans la pièce et il la chasse. Puis en parlant de son maître, il lui dit : « … Et il faut que ça se laisse détruire par des femelles, des garces – respect de vous monsieur – et qui n’ont pas l’âge, des vrais singes ! Dieu sait ce qu’il en consomme, et de pas ordinaires ! … » Dans la pièce Elles s’aiment depuis 20 ans de Pierre Palmade et Michèle Laroque, Mathilde racontant à son amante Isabelle son rêve, avec « une majorette avec une tête de babouin ».
Cette animalisation de la femme est parfois une vengeance secrète réservée à une incestueuse famille, réelle ou symbolique : « Mal à l’aise, ta mère te fait penser aux femelles orangs-outans qui, même après la mort de leur bébé, continuent de le transporter d’arbre en arbre, de mimer l’allaitement, de le choyer comme si de rien n’était. » (Félix dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 170) Par exemple, dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, le Père 1, homosexuel, se présente comme le « Gorille de feu son père », en prenant ainsi le place et le rôle de la femme soumise auprès de son « mari » le Père 2.
Sinon, la métaphore du singe associée à la féminité peut tout à fait être une image triviale et potache du sexe génital des femmes. Par exemple, dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afailal et Yannick Schiavone, dès le début de l’histoire, Sana, l’héroïne lesbienne, parle d’un singe qu’elle a vu en songe : « J’ai rêvé d’un singe. » Sa ex-compagne, Noémie, qui essaie de revenir subtilement à elle, joue sur la même corde sensible : « Sana, je dois te parler. Je sais que toi aussi, tu as rêvé du p’tit singe… »
Dans l’expression « femme singe », il y a « femme singée ». On voit que la femme-singe correspond tout simplement à la femme-objet, à la femme-potiche (parfois valorisée) : « Ça me faisait plaisir de la voir habillée comme moi à côté de moi, comme un singe, à la tribune officielle. Pauvre Fanny. » (Evita dans la pièce Eva Perón (1969) de Copi) ; « À quinze ans, mon père m’a échangée à un Marocain contre un singe. » (Arlette dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, p. 105) ; « Le doute vous habite… Vous vous attendiez à Demis Roussos dans le rôle de Dieu ? Et vous vous retrouvez avec Anna Nicole Smith/Lolo Ferrari/La Cicciolina… De toute façon, je vais décevoir toutes vos attentes » (Lise dans la pièce La Fesse cachée (2011) de Jérémy Patinier) ; « J’étais une esclave dans mon propre foyer, un animal en cage. Un singe que l’on donnait en spectacle dans la rue. » (Anamika, l’héroïne lesbienne du roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 132) ; « Je les regardais s’engouffrer tous dans l’escalier qui menait au balcon, lorsque je reconnus Perrette Hallery de dos… accompagné d’une magnifique femme en manteau de poil de singe, rousse à mourir sous son chapeau à voilette, la peau laiteuse et la démarche assurée. Le cliché de la belle Irlandaise, Maureen O’Hara descendue de l’écran pour insuffler un peu de splendeur à l’ennuyeuse vie nocturne de Montréal, la Beauté visitant les Affreux. […] La fourrure de singe épousait chacun de ses mouvements et lui donnait un côté ‘flapper’ qui attirait bien des regards admiratifs. Les hommes ne regrettaient plus d’être là, tout à coup. » (le narrateur homo décrivant la belle Maureen O’Hara, dans le roman La Nuit des princes charmants (1995) de Michel Tremblay, p. 44) ; etc.
La femme-singe, c’est quelquefois aussi le personnage homosexuel ou bien travelo : « Moi, c’est Chita mais je suis épilée. » (Francis, le héros homosexuel de la pièce Hors-piste aux Maldives (2011) d’Éric Delcourt) ; « Qu’est-ce qu’elle est monstrueuse, cette fille, oh la la, et comme elle s’habille ! Tu es un singe, mon pauvre vieux ! Ça se voit à cent mètres que tu es un travelo ! » (Daphnée à Micheline dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi) ; « Alors, elle, resplendissante, monterait et redescendrait la Butte, comme une pute enveloppée de Chanel à la lumière de la lune, toute seule avec son destin, singe, guenon ou femme cruelle, souvenir d’un Carnaval solitaire de fille à bite ou d’homme sans apparat ! » (Fifi à propos de Lou dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Et si je mettais une cape en singe noir ? Le singe noir et le cygne blanc c’est très intéressant ensemble. » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Eh ! vous, commença-t-il, la bouche pleine, que diriez-vous de certaine jeune demoiselle à la chasse ? Que diriez-vous d’une grosse jambe de chaque côté de son cheval, comme un singe sur une branche. » (Roger critiquant l’héroïne lesbienne Stephen, dans le roman The Well Of Loneliness, Le Puits de solitude (1928) de Marguerite Radclyffe Hall, p. 69) Dans le film « Tomboy » (2011) de Céline Sciamma, le père de Laure la traite affectueusement de « petit singe ». Dans le film « Fried Green Tomatoes » (« Beignets de tomates vertes », 1991) de John Avnet, Idgie, l’héroïne lesbienne, se fait traiter de singe par Julien quand elle n’a que 7 ans : « On dirait une vraie guenon ! ». Cela la blesse profondément, même si elle ravale son orgueil en jouant au « p’tit mec ».
c) Toutes des putes !
Les femmes réelles ont le malheur d’être fragiles, de ne pas être des Superwomen… ce qui attise chez le héros homosexuel une déception et une méfiance croissantes. Par exemple, dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, le juge Kappus, secrètement homosexuel, décrit Lucile (avec qui il est marié) comme une femme « trop douce pour que cela ne vire pas au mensonge. » (p. 118)

Film « Remember Me In Red » d’Hector Ceballos
Dans les fictions homo-érotiques, la femme, jadis désincarnée en vierge, finit, parce qu’elle est incarnée, par être traitée de prostituée, de femme impure, de putain, par le héros homosexuel : « T’as l’air d’une pute. Cache-moi ces mamelles. » (Alba à Claudia sa servante, dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet) ; « Les femmes sont toutes des putes. » (Franck, le personnage homosexuel de la pièce Mon Amour (2009) d’Emmanuel Adely) ; « Tu vas la fermer, salope !!!! » (Romain Carnard, le coiffeur homosexuel, à la concertiste Isabelle, dans la pièce Dernier coup de ciseaux (2011) de Marilyn Abrams et Bruce Jordan) ; « Toutes les femmes sont des salopes. » (Raphaël, le héros homosexuel de la pièce Open Bed (2008) de David Serrano et Roberto Santiago) ; « Toutes les femmes sont des putes. » (Willie, le héros homosexuel du roman La meilleure part des hommes (2008) de Tristan Garcia, p. 103) ; « Tu es toujours habillée comme une pute ! » (Louis à son « mari » Marie-Gabrielle, dans la pièce Dépression très nerveuse (2008) d’Augustin d’Ollone) ; « Les filles ?… Vous voulez dire des putains. » (Marie Besnard dans le téléfilm « Marie Besnard, l’Empoisonneuse » (2006) de Christian Faure) ; « C’est que des catins ! » (les héros de la pièce Vu duo c’est différent (2008) de Garnier et Sentou) ; « Nathalie, c’est une pute ! » (Stéphane, le héros homosexuel de la pièce Confidences (2008) de Florence Azémar) ; « Et il paraît qu’il y en a qui s’en serve comme un ventriloque. » (Samuel Laroque parlant du vagin des femmes, dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Toutes des putes. Même maman ! » (Gwendoline dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Je suis sûr qu’elle a laissé un parfum de pute sur l’oreiller ! » (Benjamin, en parlant avec ressentiment d’Isabelle à son amant Pierre, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « T’es habillée comme une pute. » (Jean-Pierre s’adressant à sa femme Fanny – qui va se lesbianiser –, dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat) ; « Ça fait pute. » (Seb, homosexuel, s’adressant à sa meilleure amie Marie à propos de sa tenue, dans le film « Pédale dure » (2004) de Gabriel Aghion) ; etc.
Par exemple, dans le roman Des chiens (2011) de Miko Nietomertz, Polly, la meilleure amie lesbienne de Simon, l’un des héros homosexuels, est dépeinte comme une femme embauchée dans un peep-show ; et on voit clairement que dans l’esprit de Cody, le héros homosexuel nord-américain hyper maniéré, être une femme se limite à être violé : « Il a venu pour s’excuser […] Il a été obligé de ma voler, mais il a dit désolé, quoi et on a fait l’amour ensemble. » (p. 112).
Dans la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet, le couple « marié » Dominique et Marcel rivalise de misogynie. D’ailleurs, Raymond, le fils de Marcel, le leur fait remarquer : « Ah bravo ! Au rayon Misogynes, vous vous placez large ! » Par exemple, ils traitent de « salope » leur amante commune.
Dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade, Pierre, le héros homosexuel, envisage les femmes comme des objets, des faire-valoir ou des mères porteuses (il organise une « Soirée Génitrices » chez lui), exactement comme le font les personnages hétéros : « J’ai adoré me taper des femmes plus belles que les leurs. Juste pour faire chier mes copains hétéros. » Il veut un enfant et surtout pas une fille : « Déjà, si tu prévoies de me faire une fille, tu pars mal. […] Si c’est une fille, on la noie. » (Pierre, le héros homosexuel, à sa meilleure amie Sylvie qui désire porter un enfant de lui par tous les moyens) Et Isabelle, l’étrangère hétérosexuelle de l’histoire, se définit elle-même comme « une salope » qui ne peut pas se satisfaire d’un seul homme et qui peut coucher et faire des enfants à n’importe quel homme-objet qui saura la valoriser matériellement.
Dans la pièce Ça s’en va et ça revient (2011) de Pierre Cabanis, Viviane se fait traiter de « grosse pute ». Dans le film « La Vie d’Adèle » (2013) Abdellatif Kechiche, Emma insulte sans s’arrêter sa copine Adèle de « sale pute », de « traînée », de « prostituée », une fois qu’elle a découvert ses fidélités hétérosexuelles. Dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Danny traite « gentiment » sa meilleure amie Abbey de « pute ». Dans le one-man-show Le Jardin des dindes (2008) de Jean-Philippe Set, une mère traite sa fille Kimberley de « petite pute ». Dans le film « Vil Romance » (2009) de José Celestino Campusano, Alejandra est traitée de pute par Raúl, l’irascible héros homosexuel. Dans la pièce Bang, Bang (2009) des Lascars Gays, les filles sont définies comme « des pétasses » et des « putes ». Dans la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand, Xavier, l’un des héros homosexuels, traite les femmes de « grosses poufs », de « grognasses ». Dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant » (« Les Larmes amères de Petra von Kant », 1971) de Rainer Werner Fassbinder, Petra qualifie sa copine de putain : « Tu n’es qu’une misérable petite putain… » Dans la pièce Western Love (2008) de Nicolas Tarrin et Olivier Solivérès, Clark rebaptise sa bien-aimée Lili Jane « Lillipute ». Dans le film « Crocodile Dundee II » (1988) de John Cornell, la femme est traitée de « pute » par le personnage homosexuel. Dans le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier, comme Marie, la « fille à pédés », a été « infidèle » à son meilleur ami homo Loïc (elle a osé sortir avec un autre homme que lui !), ce dernier la traite de « pute ». Dans le film « Eating Out » (2004) de Q. Allan Brocka, Gwen, la FAP, se fait également insulter de « pute » par son copain gay Joey. Dans la pièce Jupe obligatoire (2008) de Nathalie Vierne, Bernard qualifie France de « pute » parce qu’elle sort avec une femme. Dans la pièce Les deux pieds dans le bonheur (2008) de Géraldine Therre et Erwin Zirmi, Damien, l’homosexuel, traite sa meilleure amie de « garce ». Dans la pièce Confidences entre frères (2008) de Kevin Champenois, Damien injurie Amélie de « salope » parce qu’elle a osé coucher avec son frère Samuel. Dans la pièce La Famille est dans le pré (2014) de Franck Le Hen, Cindy, la « fille à pédé » dont Tom, le héros homo, se sert comme couverture hétérosexuelle, est maltraitée et méprisée par l’ensemble de la famille de Tom ; par exemple, la mamie de Tom parle d’elle comme « la traînée qui pose dans les magazines avec mon petit-fils ». Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, le pasteur Ralph traite sa femme de « salope » parce qu’ils ont chopé une maladie vénérienne et qu’il n’assume pas sa propre pratique homosexuelle extra-conjugale. Dans la pièce La Belle et la Bière (2010) d’Emmanuel Pallas, Léo, le héros homosexuel, traite sa sœur lesbienne Garance de « pute ». Dans le roman The Girl On The Stairs (La Fille dans l’escalier, 2012) de Louise Welsh, Alban Mann traite sa propre fille de « pute » (p. 18), et finira par la tuer, comme il a assassiné sa femme Greta, elle-même prostituée « professionnelle ».
d) Toutes des diablesses !
Chez le personnage homosexuel, le dégoût des femmes semble presque épidermique : « J’étais terrorisé. Elle était tout près de moi. Elle n’était plus la même jeune femme qui m’avait abordé. Plus elle parlait, plus elle devenait une autre. Avec une autre voix. Un autre âge. Elle était collée à moi. Je sentais son odeur. Je reconnaissais cette odeur. Il fallait fuir. C’était l’odeur de la mort. » (Omar, le héros homosexuel du roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa (2010), p. 47) ; « Tu sais bien que les femmes, nues ou pas, ça m’écœure. » (François, le héros homosexuel, à Marc, dans la pièce On la pend cette crémaillère ? (2010) de Jonathan Dos Santos) ; « Elle me répète qu’elle m’aime et je joue avec elle comme un petit animal effrayé. Ses baisers me donnent la nausée. La manière dont elle s’est jetée dans mon lit, dont elle s’est couchée contre moi, sans que je lui demande rien, me dégoûte. […] Son insouciance, sa beauté me répugnent. » (Heinrich parlant de Madeleine, dans le roman À mon cœur défendant (2010) de Thibaut de Saint-Pol, p. 65) ; « Ce sont de vraies femmes, chéri. Regarde. Vomis au besoin mais ne les touche pas. L’homme naît d’elles, de ces grossiers objets de reproduction. » (Louis XIII dans le film « Les Diables » (1971) de Ken Russell) ; « Dans toute femme, il y a une Ève malveillante qui sommeille. » (Rodin, l’un des héros homosexuels de la série Joséphine Ange-gardien (1999) de Nicolas Cuche, épisode 8 « Une Famille pour Noël ») ; « La femme est l’avenir des pommes. » (Didier Bénureau dans son spectacle musical Bénureau en best-of avec des cochons, 2012) ; « Cette femme diabolique […] qu’est-ce que je la déteste ! » (le narrateur parlant de Marilyn, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 97) ; etc.
La femme-serpent, la femme-ventouse, ou la femme-pieuvre fait son apparition dans l’imaginaire fantasmatique homosexuel : « Quand je quittais la scène, elles m’attendaient en coulisse par grappes ! Parfois elles montaient par le trou du souffleur ! » (Cyrille, le héros homosexuel de la pièce Une Visite inopportune (1988) de Copi) ; « La grosse Carole, pute géante à bras tentaculaires, est entourée de nabots besogneux, tous occupés à ses aises. Ils sont fourmis naines à côté d’elle. » (Vincent Garbot dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 8) ; etc. Par exemple, dans la nouvelle « La Chaudière » (2010) d’Essobal Lenoir, le narrateur homosexuel essaie de se débarrasser de « cette inconnue dont les bras serpentaient autour de la taille de son Didier » (p. 22). Dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, il est question des « tentacules de Marilyn » (p. 100).
Dans le roman Les Nettoyeurs (2006) de Vincent Petitet, par exemple, l’ensemble des femmes passe au crible du regard sexiste et asexualisant du héros Antoine : « Martine Van Decker puait. Martine était une énigme pour tous. Ses collègues la surnommaient ‘l’erreur de casting’. Antoine se dit qu’il vaudrait mieux l’éviter à l’avenir, surtout le matin, à cause de son haleine. » (pp. 58-59) ; « Magda Sterner arborait une saharienne rouge munie de quatre poches et ceinturée d’une série d’anneaux métalliques. […] Elle avait quelque chose de froid, d’asexué. » (idem, p. 74) ; « Magda, intimidante dans son fourreau rouge sang » (idem, p. 75) ; « Magda dans sa combinaison rouge, le fouet à la main, faisant tinter sa ceinture métallique. Une dominatrice, sans doute. Une dangereuse perverse cérébrale. » (idem, p. 76) ; « Magda faillit s’étrangler avec la fumée de cigarette. Elle toussait comme une truie. » (idem, p. 82) ; « Magda s’arrachait un poil du nez quand Antoine frappa à sa porte. » (idem, p. 142) ; « la ceinture en python agressive » (idem, p. 142) ; « Magda portait un masque oriental rouge sang aux traits grossiers, épouvantables. Des yeux furieux, révulsés. Des dents tranchantes comme des couteaux. » (idem, p. 243)
Dans beaucoup d’œuvres homosexuelles, la féminité est présentée comme diabolique, monstrueuse : cf. le film « The Devil Wairs Prada » (« Le Diable s’habille en Prada », 2005) de David Frankel (avec l’odieuse Miranda), les films « La Diablesse en collant rose » (1959) de George Cukor, le film « Les Diables » (1971) de Ken Russell, le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau (avec le proviseur Madame Smelker qui est un vrai monstre qui pue), la chanson « L’Enfer et moi » d’Amandine Bourgeois, etc. Je vous renvoie à la partie sur les femmes habillées en rouge dans le code « Carmen » de ce Dictionnaire des Codes homosexuels.
La beauté de la femme n’est pas envisagée comme une force fragile, mais bien comme une arme redoutable, qui soumet et assigne un cruel destin. Pour beaucoup de héros homosexuels, une vraie femme belle est une femme jalouse, fuyante, dangereuse, peste, voleuse, bavarde, bruyante, intrusive, curieuse, parlant pour ne rien dire ou pour médire, séductrice, maléfique, manipulatrice (cf. le film « Un Mariage de rêve » (2009) de Stephan Elliot) : « Sa sœur cadette, la duchesse de Malaga, était réputée être la plus belle femme d’Espagne et avait fait tourner la tête à plusieurs couronnes jusqu’au moment où, à sa majorité, elle dût décider entre trois jeunes rois et qu’elle déclara tout simplement qu’elle entrait dans les Ordres. » (Copi, nouvelle « L’Autoportrait de Goya » (1978), p. 9) ; « Vous, les gouines, et les femmes toutes, qui venez mettre le nez dans les affaires du quartier, vous êtes des vrais gangsters ! […] Vous nous chantez des chansons pour met’ les pauvres à l’Hospice, les voleurs dans les prisons, les Arabes en Arabie et garder tout le pognon ! » (Ahmed dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) ; « Et puis les femmes avaient des cris trop stridents, alors nous sommes partis. » (cf. la dernière phrase de la nouvelle « Crime dans la cité » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 74) ; « Pour imaginer au mieux l’état d’esprit du type écrivant, il faut se figurer une immonde et très grossière Salope. Vincent Garbo se propose de la nommer Carole. Carole la Monstrueuse. » (Vincent Garbo dans le roman éponyme (2010) de Quentin Lamotta, p. 8) ; « Avec sa bouche d’anthropophage rouge carrosserie, ses cheveux façon perruque en nylon du Crazy Horse, elle aurait pu jouer dans une parodie porno de films de vampires. » (Jason, le héros homosexuel décrivant Varia Andreïevskaïa, dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, p. 56) ; etc.
Par exemple, dans la pièce Le Gai Mariage (2010) de Gérard Bitton et Michel Munz, le père homosexuel d’Henri (le héros qui feint l’homosexualité) traite Elsa, la copine de son fils, de « folle » : elle serait « une de ces tordues » qui va détourner son fils du « droit chemin de l’homosexualité ».
Pour le dramaturge argentin Copi, une femme, ça cancane, forcément ! (cf. le titre de la nouvelle « Les Potins de la femme assise », 1978) Ça tue aussi ! « T’as jamais rencontré une femme de ta vie, toi ? Une vraie femme, de celles qui te font cher jusqu’à la mort ? » (Daphnée dans la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi)
La femme est jugée maudite, quand bien même cette malédiction la rende soi-disant belle, désirable, forte : « Dalida, l’orchidée noire, la maudite, la veuve noire, le monstre à deux têtes, Luigi, Lucien, Richard, pris dans un lien inextricable. » (cf. la pièce Dalida, du soleil au sommeil (2011) de Joseph Agostini) Par exemple, dans le roman Harlem Quartet (1978) de James Baldwin, mis en scène par Élise Vigier en 2018, Crunch, l’un des personnages homos, a cogné sa femme en lui faisant l’amour parce qu’il a vu en elle le visage du diable.
e) La misogynie en actes (Toutes des martyres !) :
Une telle vision de la femme n’est pas sans conséquence dans le comportement du héros homosexuel. La misogynie se traduit en actes. D’abord une distance : les femmes sont mises à distance, abandonnée. Par exemple, dans le film « Le Refuge » (2010) de François Ozon, Paul, le héros homosexuel, abandonne Mousse. Dans le film « Los Abrazos Rotos » (« Étreintes brisées », 2009) de Pedro Almodóvar, Lena se fait pousser dans les escaliers. Dans le film « Un autre homme » (2008) de Lionel Baier, François brutalise Catherine et simule qu’il tire un coup de feu sur sa copine Christine. Dans le film « Il Compleanno » (2009) de Marco Filiberti, Francesca, la femme de Mateo, se fait écraser par une voiture après qu’elle ait découvert son mari au lit avec un homme. Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), la langue de Laurent Spielvogel, le héros homosexuel, fourche : au lieu de dire l’expression « exécution des Bar Mitsvah », il dit « exécution des Miss ».

Film « The Gay Bed & Breakfast of Terror » de Jaymes Thompson
L’homosexuel fictionnel entraîne la FAP à la mort (cf. la tante d’Angelo dans le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault ; Marie qui se suicide après que Loïc l’ait espionnée et isolée des prétendants masculins avec qui elle aurait pu faire sa vie, dans le film « Garçon stupide » (2003) de Lionel Baier, Amira Casar qui tente de se suicider dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat, etc.). Par exemple, dans la pièce L’un dans l’autre (2015) de François Bondu et Thomas Angelvy, Thomas a viré sa cuti et avoue avoir « une ex suicidaire ».
Ensuite, le personnage homosexuel passe au viol, notamment en détruisant, par le passage à l’acte sexuel, le lien d’amitié qui l’unissait à la femme. « Ça fait combien de temps que tu la supportes, l’autre folle ? » (Philippe, le personnage homosexuel de la comédie musicale La Belle au bois de Chicago (2012) de Géraldine Brandao et Romaric Poirier) Par exemple, dans le téléfilm « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, Vincent, le héros homo, brise la virginité de sa meilleure amie Noémie, avant de se résigner à une homosexualité exclusive. Dans le film « Edge Of Seventeen » (1998) de David Moreton, Éric, le personnage homosexuel, embrasse sa meilleure amie Maggie avant de la laisser tomber. Dans le film « Eating Out » (2004) de Q. Allan Brocka, Joey a couché avec sa meilleure amie Gwen pour tester s’il était gay. Dans le roman Gaieté parisienne (1996) de Benoît Duteurtre, Marianne, la FAP, est utilisée sexuellement puis jetée par Nicolas, le héros homo. Dans la pièce Son mec à moi (2007) de Patrick Hernandez, Daniel couche avec Nina pour découvrir qu’il est finalement gay. Dans le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, Carole sert de couverture sociale à son meilleur ami Laurent qui ne s’assume pas en tant qu’homosexuel ; ensuite, il la force plus ou moins à coucher avec lui pour tester sa propre « hétérosexualité », puis a une « panne » au lit. Dans la pièce Pas folle, le gay ! (2006) de Gianni Corvi, Fred teste son hétérosexualité avec sa meilleure amie avant de se découvrir « 100% homo ».
Très souvent, le personnage homosexuel impuissant finit par violer son idole féminine ou sa meilleure amie FAP (qui lui aura préalablement servie d’appât à mecs), pour se venger de sa faiblesse et de sa virilité blessée, ou bien parce que la femme convoitée ne se laisse pas posséder. « Toutes ces femmes dont il avait envie (bien que ce désir en soi lui fît horreur), jamais il ne pourrait les obtenir au moment même où il les voulait, c’est-à-dire tout de suite, car il faudrait d’abord trouver le moyen de leur être présenté, puis leur parler avec adresse, alors que dans son cœur il les méprisait. » (Emmanuel Fruges dans le roman Si j’étais vous (1947) de Julien Green, p. 169) ; « Mon plan consistait à passer une nuit avec toi. Cette nuit-là, je t’aurais baisée jusqu’à te fendre en deux. » (Victor à Helena, dans le film « Carne Trémula », « En chair et en os » (1997) de Pedro Almodóvar) ; etc. Par exemple, dans la pièce Qui aime bien trahit bien ! (2008) de Vincent Delboy, Sébastien l’homosexuel trahit sa meilleure amie Stéphanie parce qu’il lui avoue finalement qu’il veut la posséder pour lui tout seul.
J’étudie plus largement le thème du « Violeur homosexuel » dans le code du même nom, sur mon Dictionnaire des Codes homosexuels. La misogynie peut aller jusqu’à l’envie de meurtre ou le meurtre : « Vous ne savez pas le mal dont vous êtes capables. » (Amira Casar en parlant des hommes homosexuels, dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat) ; « J’t’attendais pour te violer. » (« JP », le héros homosexuel, en boutade à son amie Clara, dans la série Clara Sheller (2005) de Renaud Bertrand, l’épisode 2 « Intuition féminine »)
Par exemple, dans le film « Hable Con Ella » (« Parle avec elle », 2001) de Pedro Almodóvar Benigno, l’infirmier homosexuel, viole sa patiente Alicia, qu’il a soignée pourtant apparemment avec sollicitude, et veillée comme une idole. Dans le film « Strangers On A Train » (« L’Inconnu du Nord-Express », 1951) d’Alfred Hitchcock, Bruno tue la femme de Guy. Dans le film « ¿ Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto ? » (« Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? », 1984) de Pedro Almodóvar, le flic impuissant viole Gloria sous la douche. Dans le film « Madame Satã » (2001) de Karim Ainouz, João bat et défigure sa star-fétiche Victoria. Dans le film « Reflections In A Golden Eye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston, Williams, le héros homosexuel, viole Leonora. Dans le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, Bosco tente de violer Angela. Dans le film « Psycho » (« Psychose », 1960) d’Alfred Hitchcock, Norman Bates tue Marion après l’avoir désirée et observée à travers les murs. Dans le film « Scandale aux Champs-Élysées » (1948) de Roger Blanc, Étienne assassine plusieurs femmes. Dans la pièce La Muerte De Mikel (1984) d’Imanol Uribe, Mikel l’homosexuel mord le clitoris de Begoña pendant son sommeil. Dans le film « J’ai pas sommeil » (1993) de Claire Denis, un homo psychopathe tue des vieilles dames. Dans le film « Homme au bain » (2010) de Christophe Honoré, Emmanuel, le personnage homosexuel, maltraite physiquement les femmes.

Film « Matador » de Pedro Almodovar
Dans les fictions homo-érotiques, on nous offre régulièrement des descriptions explicites de gestes de maltraitance opérés sur les femmes : « Ayez pitié d’une pauvre femme par-dessus vieille ! J’allume la boule. Vous la voyez votre petite Delphine pendue ? Monsieur, me dit-elle, je me sens mal. Mes sels ! Je la gifle. Je l’attrape par les cheveux, lui cogne le front contre la boule de cristal, elle râle, elle s’affaisse sur sa chaise, elle a une grosse boule bleue sur le front, un filet de sang coule de son oreille. En bas on entend le bruit régulier de la caisse, je regarde par la fenêtre, le boulevard Magenta est toujours le même. La vieille continue de râler, je l’étrangle, elle meurt assise. Je me recoiffe de mon peigne de poche, j’enfile mon imperméable. » (le narrateur homosexuel assassinant la voyante extra-lucide Mme Audieu, dans le roman Le Bal des Folles (1977) de Copi, p. 89) ; « Delphine est morte ! crie l’une, Madame Audieu est morte ! crie l’autre. L’une pendue, l’autre étranglée. » (idem, p. 91) ; « Qu’est-ce que je regrette de ne pas m’être débarrassé d’elle au début, ça aurait été facile de l’empoisonner au Pim’s lui mettant de l’arsenic dans son verre de vodka-orange, qui m’aurait soupçonné ? […] Aïe, ma mère, pourquoi m’as-tu fait si misogyne ! » (idem, p. 87) ; « Mimile ramasse une pierre et frappa la Reine des Hommes sur la tête jusqu’à ce que le sang inonde ses cheveux blancs et qu’elle roule par terre. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 65) ; « Son visage et ses beaux cheveux blonds étaient couverts d’excréments. » (le narrateur décrivant la belle Truddy, dans la nouvelle « Les Potins de la femme assise » (1978) de Copi, p. 33) ; « Il a poignardé Suzanne York. » (Stephany présentant Jonathan, homosexuel, à son ami Joe, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; etc.
Le héros homosexuel réserve bien souvent à la femme qu’il met en scène les pires sévices. Par exemple, dans le roman Vincent Garbot (2010) de Quentin Lamotta, le héros balance de l’acide chlorhydrique sur l’une de ses camarades de classe, Sophie, qu’il défigure (p. 64), et fait sa fête à Adrienne (« J’ai résolu de faire mourir Adrienne Toiture. Elle mourut culbutée par une auto. », p. 125). Dans le film « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy, Dutrouz découpe en morceaux « Lola Lola » qu’il met dans une malle. Dans la comédie musicale Se Dice De Mí En Buenos Aires (2010) de Stéphan Druet, Álvaro choisit une drôle de manière de déclarer son amour à Octavia : il la frappe, la fait tomber, l’écrase contre les murs, la maltraite sauvagement ; Pedro fait de même, en ruant de coups Claudia avec sa guitare. Dans le one-man-show Raphaël Beaumont vous invite à ses funérailles (2011) de Raphaël Beaumont, Sofia est la femme-tronc qui ressemble à un tableau de Picasso après un tragique accident de moto que son mari, qui a survécu, lui a infligé. Dans la mise en scène en 2010 de Florian Pautasso et Maya Peillon de la pièce La Tour de la Défense (1974) de Copi, le personnage de Daphnée se fait particulièrement maltraiter physiquement par les héros homosexuels : Jean la jette par terre, Luc lui hurle dessus, etc. Dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afailal et Yannick Schiavone, les femmes sont souvent maltraitées verbalement et physiquement, y compris celles qui sont adulées : par exemple la vendeuse du resto japonais qui se fait insulter, la mère de Kévin (« Lâche-moi, la vieille !!! » râle Angelo en pointant son arme à feu sur elle), la figure de Carla Bruni harcelée, etc. Dans le film « Dressed To Kill » (« Pulsions », 1980) de Brian de Palma, un homme transsexuel M to F qui se déguise en blonde, tue des femmes blondes à la lame de rasoir pour leur ravir leur personne et leur sexe. Dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin), dans les vitrines du magasin de Joe, couturier homosexuel, les mannequins féminins ont les bras en croix, sont crucifiés comme des pin-up.
Dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau, Jules, le héros homo, joue au départ l’affliction, le veuve endeuillée, par rapport à son ex-femme (« La femme de ma vie s’est tuée dans un accident d’avion il y a 7 ans. »), pour ensuite révéler la vraie nature de sa relation : « Je la haïssais. C’est une grosse merde. » Par ailleurs, il se comporte très mal avec les trois femmes qui l’entourent : il gifle Michèle, domine sexuellement Lucie, et traite Martine de « morue » : « Vous êtes des bêtes sauvages ! »
Le héros homosexuel reproche finalement à la femme tout ce qu’il lui fait… et qu’il ne devrait se reprocher qu’à lui-même…
f) D’où vient cette misogynie homosexuelle ?
Cela peut paraître complètement fou que tant de héros homosexuels, qu’on persuade d’être les meilleurs amis des femmes (et qui finissent par le croire !), soient aussi ignobles avec leur entourage féminin. Les motifs rationnels semblent même leur échapper ! « Pourquoi est-ce que je la tue ? Il doit y avoir une raison mais je ne me l’explique pas. » (le roi Ferrante parlant d’Inès de Castro, dans la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant)
Comment expliquer cette décharge de haine ?
La raison la plus évidente, mais aussi la plus insuffisante si on ne l’explique pas, c’est la peur de la sexualité. La misogynie du personnage homosexuel traduit certainement chez lui une angoisse (qui se déclinera parfois plus tard en révulsion) de la différence des sexes : « J’étais lâche avec les femmes. Et j’vais vous dire une chose : les femmes m’emmerdent ! » (Érik Satie dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « J’te fais peur ? Tu voudrais me tenir dans tes bras pourtant. » (Chloé à Martin, le héros que tout le monde prend pour un gay, dans la pièce Scène d’été pour jeunes gens en maillot (2012) de Christophe Botti) ; « En fait, ils n’ont jamais compris ce qu’on était. Ils ont peur de nous comme les enfants ont peur du noir. En réalité, c’est qu’ils ont peur qu’elles ne leur appartiennent pas […] Sous prétexte de protéger les femmes d’elles-mêmes, pour conjurer le sort. » (Amira Casar en parlant des hommes homosexuels, dans le film « Anatomie de l’enfer » (2002) de Catherine Breillat) ; « Les amitiés particulières, c’est quand les filles nous font peur. » (cf. la chanson « Les Amitiés particulières » de Serge Lama) ; « Richard avait un grand respect du corps des femmes. Presque trop. Il avait toujours peur de faire mal. » (la compagne de Tanguy dans le film « L’Ennemi naturel » (2003) de Pierre-Erwan Guillaume) ; « J’espère qu’on aura un garçon, murmura-t-elle. Les filles sont trop vulnérables. » (Jane, l’héroïne lesbienne enceinte s’adressant à sa compagne Petra, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 101) ; etc.
Par exemple, dans le film « La Vie privée de Sherlock Holmes » (1970) de Billy Wilder, Sherlock Holmes dit qu’il « se méfie des femmes ». D’ailleurs, la misogynie du héros homosexuel est toujours le signe d’un irrespect des femmes beaucoup plus global, social, hétérosexuel. Dans le film « Boygames » (2012) d’Anna Österlund Nolskog, deux meilleurs amis, John et Nicolas, âgés de 15 ans, sont intéressés par les filles mais redoutent la première expérience sexuelle, alors ils décident de s’entraîner d’abord entre eux.
Mais nous pouvons également lier la misogynie homosexuelle à l’inceste. Car en effet, elle est un mécanisme instinctif de résistance que le personnage homosexuel met en place pour gérer/étouffer tant bien que mal un inceste opéré par une mère abusive, une star de télévision indécente, une femme intrusive. Par exemple, dans le film « Maigret tend un piège » (1958) de Jean Delannoy, Marcel Maurin, homosexuel, tue des femmes car il est doté d’une mère castratrice.
Il est possible que la misogynie homosexuelle vienne aussi de l’excès de proximité du héros homosexuel avec les femmes de son entourage, y compris celles qu’ils présentent comme ses amies d’enfance ou ses « meilleures amies ». La fusion précoce et incestueuse avec le monde féminin, notamment dans l’enfance, entraîne en général une rupture progressive à l’âge adulte, une distance, un agacement : « Non que les études de lettres lui déplussent, ni la compagnie des filles, qui avaient toujours constitué la majeure partie de ses relations et amitiés ; mais l’absence de tout visage masculin sur qui poser son regard pendant les cours finissait par lui peser, et lui donnait parfois quelque accès de misogynie […]. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « Cœur de Pierre » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 47)
En outre, je crois que la misogynie homosexuelle repose surtout sur le rapport réifiant et idolâtre (qu’on pourrait appeler aisément « fanatisme ») qui s’instaure entre les femmes et le personnage homosexuel. Aux femmes réelles, celui-ci leur préfère les femmes-objets, ces poupées qu’il peut manipuler, et vider du mystère qui lui fait tellement peur : « Jamais les femmes ordinaires ne donnent l’essor de notre imagination. Elles ne sortent pas de leur siècle. Aucune magie ne les transfigure. Rien en elles qui ne puisse pénétrer. Pas une qui soit mystérieuse. Toutes, elles ont le même sourire stéréotypé et les belles manières du jour. Elles sont claires et banales. Mais les actrices ! Oh ! Combien les actrices sont différentes ! » (Dorian Gray dans le roman Le Portrait de Dorian Gray (1983) d’Oscar Wilde, pp. 72-73) ; « Je n’aime Lucile que lorsqu’elle se tait. » (le juge Kappus, homosexuel planqué, parlant de sa propre femme, dans le roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 60) ; « Une actrice = une pute, c’est bien ce que je dis. » (Benjamin parlant à son amant Pierre, dans la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade)

Film « Soudain l’été dernier » de Joseph L. Mankiewicz
Dans les fictions, il n’est pas rare que le héros homosexuel se serve de la femme comme un objet. Par exemple, dans le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz, Catherine est utilisée explicitement comme un « appât » par son cousin homosexuel Sébastien qui veut attirer à lui les prétendants. C’est aussi le cas des FAP des films suivants : « Le Bon Coup » (2005) d’Arnault Labaronne, « Boychick » (2001) de Glenn Gaylord, « Les Monstres » (1963) de Dino Risi, « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq, « Les Demoiselles de Rochefort » (1967) de Jacques Demy (où Maxence tombe amoureux de son « idéal féminin » pour que de la femme qu’il aime), etc. Dans la pièce Les Amazones, 3 ans après… (2007) de Jean-Marie Chevret, Martine sert de couverture à Loïc. Dans la pièce Chroniques d’un homo ordinaire (2008) de Yann Galodé, Didier utilise sa cousine-FAP comme faire-valoir : « Tu es mon public ! » lui dit-il.
C’est cette confusion dans le cœur du héros homo entre femme réelle et femme-objet qui nous fait dire que l’acte de destruction de la femme n’est pas tant une démarche misogyne qu’une démarche iconoclaste. « Moi, Dalida, je l’ai éclatée, je l’ai fracassée. » (la figure d’Élie Kakou, homosexuel, dans le one-woman-show Sandrine Alexi imite les stars (2001) de Sandrine Alexi) Il y a comme un double mouvement d’adoration/destruction. Par exemple, dans le roman Las Locas De Postín (1919) d’Álvaro Retana, Rafaelito déteste les femmes alors qu’il passe son temps à les imiter.
Le personnage homosexuel se venge en réalité de sa propre prétention à se prendre pour un objet, pour un mythe : cf. le film « El Asesino De Muñecas » (« L’Assassin de poupées », 1975) de Michael Skaife, le film « Le Refroidisseur de dames » (1968) de Jack Smight, etc.
La femme-objet est livrée, comme la Reine du Carnaval, aux flammes et à la risée générale, pour, en intentions, prouver qu’elle est bien humaine et immortelle, et intellectuellement, pour prouver qu’elle n’est qu’un objet méprisable qui a capturé l’espace psychique désirant du héros : « Les filles, ça te prend la tête, ça ne te la rend plus. » (Lennon, le héros homosexuel de la pièce Scène d’été pour jeunes gens en maillot (2012) de Christophe Botti) ; « Je hais les majorettes. » (Madame H., travesti M to F, dans son one-(wo)man-show Madame H. raconte la saga des transpédégouines, 2007) ; « Nous pendouillerons Cher. » (les protagonistes homos parlant de la chanteuse Cher, dans la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy) ; « Catherine D. est en chantier. » (l’humoriste Philippe Mistral se moquant de Deneuve, dans son one-man-show Changez d’air, 2011) ; « Moi, Dalida, je l’ai éclatée, je l’ai fracassée. » (la figure d’Élie Kakou s’adressant à sa star fétiche, dans le one-woman-show Sandrine Alexi imite les stars (2011) de Sandrine Alexi) ; « Jolie, crinière au vent, ses dessous dépassant de l’ouverture du fourreau pailleté, boitant sur une seule chaussure, traînant d’une main le renard, de l’autre son sac, elle le suivit sans rien dire. […] Son maquillage dégoulinait. Jolie de Parma, celle qui l’avait tant ému au cinéma ! réalisa-t-il tout d’un coup. Hier encore, vous étiez mon idole, mon idéal de femme. » (Silvano, dans le roman La Vie est un tango (1979) de Copi, pp. 22-23) ; « Chaque invité, après avoir déposé son cadeau dans le vagin flétri de la reine Rancie, devait s’agenouiller pour baiser l’anus royal, lequel avait mauvaise haleine. » (cf. la nouvelle « L’Apocalypse des gérontes » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 127)
Le mythe de la séduction féminine est mis à plat et sacralisé dans la noirceur camp. Par exemple, dans la nouvelle « La Mort d’un phoque » (1983) de Copi, Glou-Glou Bzz est une femme qui « sentait fort la morue et le gin » (p. 20). Dans le roman La Cité des Rats (1979) de Copi, les épouses des rats mâles Gouri et Rakä, Iris et Carina, sont particulièrement pénibles : elles se comportent en vraies harpies, geignent tout le temps, ont mauvais caractère, se plaignent de migraine, tombent enceintes, et font chier tout le monde (p. 137).
La destruction du mythe de l’Éternel Féminin trouve in extremis ses lettres de noblesse dans la figure non moins misogyne de la Diva Camp horrorifique ou du personnage de l’affreux transsexuel gothique. Par exemple, dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, le Coryphée est un homme travesti avec une perruque tombante, une canne, un maquillage coulant, un déguisement féminisé volontairement rebelle et raté. Dans la comédie musicale Le Cabaret des hommes perdus (2006) de Christian Siméon, la grande diva interprétée par Denis D’Archangelo est fortement handicapée, bardée de prothèses à la jambe, et se déplace avec une béquille… un peu comme Sarah Bernhardt avec sa jambe de bois. Dans sa pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011), Jérémy Patinier a choisi de faire jouer une Marilyn Monroe – appelée « Lourdes » – version hippopotame de « Fantasia » : « Eh oui ! Même Marilyn faisait caca. Ça casse le mythe ! » déclare la comédienne bien en chair, qui suppliera à son public qu’il la viole (« Fouettez-moi, battez-moi ! »). Dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1985) de Copi, Vicky Fantomas est une femme avec une cicatrice sur la joue gauche, et une attelle à la jambe : elle a été victime d’un attentat au drugstore (peut-être qu’elle-même portait la bombe). La féminité détruite est l’icône identificatoire préférée des personnes homosexuelles misogynes.
La femme détruite et incarnée par le héros homosexuel est en fait un personnage, un rôle, et non la vraie femme sexuée. C’est un androgyne interlope que tous peuvent incorporer (il suffit de le désirer et de le singer) : « Je suis bisexuelle. Bisexuée. Je porte les deux sexes. J’ai été envoyé par des extra-terrestres. […] N’oubliez jamais ça : en chacun d’entre vous sommeille une mémé comme moi. » (Mémé Huguette, dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013) du travesti M to F David Forgit) ; « Oui, moi aussi, je suis comme vous. Je suis une pute. Je suis une pute. Comme vous. » (Jules, le héros homosexuel s’adressant à ses deux comparses Michèle et Martine – l’une est actrice, l’autre est prostituée de profession – dans la pièce Les Sex Friends de Quentin (2013) de Cyrille Étourneau) La femme-salope est au fond un fantasme asexué et hypersexué. C’est pourquoi la misogynie homosexuelle peut tout à fait prendre la forme de l’homophobie dans certains cas. Par exemple, dans le film « Free Fall » (2014) de Stéphane Lacant, Engel traite tout le temps son futur amant Marc, initialement hétérosexuel, de « gonzesse » pour le dévaloriser et le faire basculer dans l’homosexualité.
Finalement, on voit que le héros homosexuel hait la femme de l’avoir trop aimée, de l’avoir transformée en fantasme hypersexué et asexué : « Elle que j’ai eu le malheur d’aimer à outrance. » (Didier, le héros homosexuel, par rapport à son ex-copine Yvette, dans la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia) ; « Il me respecte. Presque trop… […] Je ne veux pas anticiper… mais j’ai très peur pour ma féminité. » (Catherine par rapport à son mari homo Jean-Paul, dans la pièce Folles Noces (2012) de Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor) ; etc. Il l’a traitée comme une déesse et comme une merde, l’a détruite pour prouver qu’elle était toute-puissante, l’a adulée puis massacrée… mais pas aimée telle qu’elle est : fragile, accessible, humaine, aimante.
Derrière ce lynchage verbal/physique misogyne se cache justement la jalousie du personnage homosexuel qui reproche aux femmes de ne pas être lui. « J’aimerais être une femme parfois. Je suis jaloux de tes orgasmes. J’vois bien que l’intensité du plaisir est plus forte chez toi. J’ai entendu dire que la femme jouissait huit plus que l’homme. » (Jupiter s’adressant à Junon, dans le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré)
g) La misogynie des femmes lesbiennes envers les femmes : si si, elle existe ! On PEUT être contre soi-même
Nous aurions tort de penser que la misogynie a un sexe. La haine des femmes, on a maintes fois l’occasion de le vérifier dans les fictions traitant d’homosexualité, est exprimée autant par les personnages masculins gays que par les héroïnes lesbiennes. Le même rapport idolâtre – et donc jalousement destructeur – avec les femmes réelles, confondues avec les femmes-objets, est observable côté lesbien ! « J’en ai marre de ces femmes ! Où est le revolver ? » (Leïla dans la pièce Les Quatre Jumelles (1973) de Copi) ; « C’est des vraies salopes, ces femmes ! » (Fougère, op. cit.) ; « J’en ai marre de toutes ces femmes ! » (la psy dans la pièce Psy Cause(s) (2011) de Josiane Pinson) ; « Il faut avoir beaucoup de patience avec les femmes, n’est-ce pas ? et ne jamais croire un seul mot de ce qu’elles vous disent. » (la voix narrative lesbienne du roman La Dame à la Louve (1904) de Renée Vivien, p. 22) ; « Je lui ai arraché les yeux pour m’en faire un bilboquet. » (Doris, l’héroïne lesbienne parlant de sa rivale Truddy, l’actrice blonde, dans la pièce Doris Darling (2012) de Ben Elton) ; etc. Par exemple, dans la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali, Heïdi, l’héroïne lesbienne, traite toutes les femmes de « dindes ». Dans la pièce Un Lit pour trois (2010) d’Ivan Tournel et Mylène Chaouat, Fanny, l’héroïne lesbienne, aurait préféré un chihuahua plutôt qu’une femme comme colocataire.
Dans les phrases misogynes des héroïnes féministes (et parfois lesbiennes), pourtant en théorie pro-femmes, l’agression plaintive se mêle au constat fataliste… et on ne sait pas trop démêler les deux : elles se plaignent et pourtant donnent raison, dans la citation mimétique/ironique de leurs « ennemis les hommes », à leurs fantasmes auto-dévalorisants : « On est toutes des salopes pour les hommes ! » (Léa dans la pièce Scène d’été pour jeunes gens en maillot (2012) de Christophe Botti) ; « J’oublie que je ne suis qu’un ventre reproducteur. » (la voix narrative du roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 142)
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) La misogynie homosexuelle en mots :
À de nombreuses reprises (même si cela est très inconscient), l’homosexualité est montrée comme un moteur privilégié de la misogynie ou de la misandrie (haine des hommes : je traite plus amplement de celle-ci dans le code « Parricide la bonne soupe » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels) : « Ce drame a pour base la haine de la femme… » (Jean-Louis Chardans parlant de l’homosexualité, dans son essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 72) Et pour cause ! Si, sur la photo des manif’ des années 1970, nous voyons la communauté homosexuelle et les féministes marcher main dans la main, la réalité de leur association est beaucoup moins chantante (l’a-t-elle vraiment été un jour, d’ailleurs ?). Comme l’exprime crument mais lucidement Éric Zemmour dans son essai Le Premier Sexe (2006) : « Au fil du temps, les femmes sont devenues les otages des homosexuels. Elles ont lié leur sort à celui de leurs ennemis. » (p. 24)
La misogynie est une pratique courante dans la communauté homosexuelle. Elle a été exprimée ouvertement par des personnalités telles que César Lácar, Thomas Bernhard, Kitchener, Marcel Jouhandeau, Oscar Wilde, William Shakespeare, Henri de Montherlant, Sade, Pierre de Coubertin – qui refuse les « Olympiades femelles », selon sa propre formulation –, Yukio Mishima, André Gide, le Marquis de Vauvenargues, Jean Cocteau, John Shear, etc. « J’espère que vous êtes comme moi. J’ai horreur des femmes. Je n’aime que les garçons. » (Oscar Wilde à André Gide, cité dans l’article « L’Immoraliste et le ‘King of Life’ » de Claude Martin, sur le Magazine littéraire, n°343, mai 1996, p. 38) ; « Je méprisais les filles : comment pouvait-on comparer les corps doux, mous et bulbeux de ces créatures bêtes et inconsistantes à la beauté musculaire du corps masculin ? Leur place était au harem d’où elles n’auraient jamais dû sortir ; le vrai amour, l’amour sur un pied d’égalité et avec une compréhension mutuelle, se donnait uniquement entre hommes. » (J. R. Ackerley, Mon Père et moi, 1968) ; « C’est horrible ce que je vais dire, mais je pense que la femme est inférieure à l’homme. Elle n’a pas la même intensité. Le yin et le yang, tout ça… » (Guillaume Dustan, l’écrivain homosexuel, dans l’émission de Patrick Buisson traitant du « communautarisme gay », sur la chaîne LCI en 2003) ; « Ce qui est rejeté, c’est le genre féminin dans sa globalité. » (Sébastien Carpentier, lors de sa conférence au Centre LGBT de Paris, à l’occasion de la sortie de son essai sociologique Délinquance juvénile et discrimination sexuelle en janvier 2012) ; « J’ai horreur de moi parlant à une femme. » (Drieu La Rochelle) ; « Malheur à l’homme qui succombe à la femme ! Malheur à la civilisation qui se livre aux femmes ! … Les femmes rêvent toujours de posséder l’homme en entier. Cette trappe vers le néant, qui se cache derrière chacune d’elle, réclame sa victime… L’homme de la confrérie ne peut sombrer car il engage le meilleur de lui-même dans l’homme. » (Hans Blüher cité dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, p. 145) ; « Je suis persuadé d’être homosexuel. J’ai fréquenté de nombreuses femmes. Sans plaisir particulier, il est. Cela m’a valu trois chaudes-pisses que j’ai considérées par la suite comme le châtiment de la nature pour des relations contre-nature. Aujourd’hui, toutes les femmes me font horreur, et, plus que toutes, celles qui me poursuivent de leur amour ; elles sont malheureusement très nombreuses. En revanche, j’aime ma mère et ma sœur, de tout mon cœur. » (lettre de Ernst Röhm, à 42 ans, le 25 février 1929) ; « Les femmes ne devraient jamais régner. » (la Reine Christine, pseudo « lesbienne », dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; etc. Par exemple, Serge de Diaghilev (1872-1929), le fondateur des fameux Ballets russes, interdisait à ses danseurs de sortir avec des femmes : « Pas de femme ! Pas de femmes : La fatigue sacrée de la danse doit chasser les tentations mauvaises. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 197)
Un certain nombre de personnes homosexuelles (il suffit de les écouter, ou qu’elles prêtent elles-mêmes attention à ce qu’elles racontent) considèrent les femmes comme des godiches, des bourgeoises sans cervelle, ou bien des caricatures de féminité fatale/violée… tout cela pour les mettre concrètement à distance, et mentalement sur un piédestal. « Le corps des femmes ne m’excite guère plus que n’importe quel autre objet de première nécessité et d’usage quotidien. » (Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969) ; « Si j’aimais les femmes, j’en verrais davantage. » (idem) Par exemple, dans la biopic « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert, on apprend que Yves Saint-Laurent, le couturier, a viré comme une malpropre son ancienne mannequin-égérie, Victoire : « Tu n’es belle que sophistiquée. […] Avec des cheveux comme ça, on dirait une souillon. Tu es d’une vulgarité, ma pauvre, c’est effarant. […] Laissez-la partir. Son style, ce qu’elle est, c’est déjà dépassé. » Les paradoxes inattendus de l’idolâtrie/jalousie…
b) Toutes des guenons !
Il arrive même que les femmes soient comparées à des êtres laids, des cruches décervelées, et même des singes ! « Les femmes valent moins que des guenons. » disait le cinéaste homosexuel français Michel Simon.

Aussi surprenant et insultant que cela puisse paraître, la femme-singe est un archétype de la fantasmagorie homosexuelle. Elle peut renvoyer au reflet narcissique monstrueusement déformé par l’eau, par exemple : cf. l’autobiographie Le Ruisseau des singes (2000) de Jean-Claude Brialy. C’est une interprétation possible.
Cette animalisation de la femme est parfois aussi une vengeance secrète réservée à une incestueuse famille, réelle ou symbolique, où la différence des sexes n’a pas été respectée (le père a exploité la mère comme une guenon, ou bien a été considéré comme un singe par la mère) : « Le soir, j’étais souvent réveillé par un bruit métallique, un grincement qui augmentait peu à peu. Je croyais qu’un tramway s’était arrêté en face de chez nous et qu’il ne parvenait plus à démarrer. Le conducteur essayait en vain et son véhicule avançait et reculait de quelques mètres, dans un rythme qui devenait effréné, frénétique. C’était comme si voyageaient dans le tramway un singe et son dompteur. Je pouvais entendre les cris hystériques du singe, la voix rauque du dompteur, qui dialoguaient. D’abord ils se disputaient, ensuite ils élevaient la voix, ce n’étaient plus des mots : c’étaient des râles, des soupirs. Il y avait aussi les hurlements du singe très aigus. L’étonnant, c’est que tout s’arrêtait d’un coup. On n’entendait jamais le tramway repartir. D’ailleurs, il n’y avait pas de tramway qui passait devant chez nous. L’eau coulait dans la salle de bains. Au bout de quelques années, tu m’as dit : ‘C’étaient tes parents.’ » (Alfredo à sa grand-mère dans l’autobiographie Folies-Fantômes (1997) d’Alfredo Arias, pp. 153-154)

B.D. « Femme assise » de Copi
La figure de la femme-singe peut même être une analogie injurieuse recherchée par les personnes homosexuelles elles-mêmes ! Par exemple, le documentaire « Louise Bourgeois : l’araignée, la maîtresse, la mandarine » (2009) de Marion Cajori et Amei Wallach nous montre justement les féministes du mouvement Guerilla’s Girls déguisées en femmes-macaques au Musée Guggenheim.
En outre, beaucoup d’individus homosexuels ou gay friendly, soucieux de défendre la normalité « naturelle » de leur désir et de leurs actes amoureux, comparent les comportements homosexuels à ceux des singes, entre autres les bonobos : « On a observé un comportement homosexuel chez 13 espèces appartenant à 5 ordres de Mammifères (Beach, 1968). En voici quelques exemples. Il se produit chez la truie, la vache, la chienne, la chatte, la lionne et les femmes du singe Rhesus et du Chimpanzé. » (cf. l’article « Les Facteurs neuro-hormonaux » de Claude Aron, dans l’ouvrage collectif Bisexualité et différence des sexes (1973), pp. 161-162)
Certaines icônes de la communauté homosexuelle ont, de leur vivant, aimé s’entourer de singes : on peut penser à Mylène Farmer et ses chimpanzés, à Joséphine Baker l’amie des singes (le singe Binki fut l’un de ses nombreux protégés), etc.
Dans l’expression « femme singe », il faut surtout reconnaître qu’il y a « femme singée », caricaturée, cinématographique, hypersexuée. On voit que la résurgence symbolique de la femme-singe correspond tout simplement à la femme-objet, à la femme-potiche, à l’individu homosexuel, travesti, transsexuel : « La fille qui enseigne le dessin est un vrai singe : le visage couvert de poils. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), p. 133) ; « Tola levait la jambe, marchait à quatre pattes pour imiter un singe, puis sortit brutalement une poupée en tissu qui reproduisait grossièrement sa silhouette. » (idem, pp. 305-306) ; « Entre-temps, Tola avait entrepris son final, enveloppée dans une étole de vison. Elle aimait toujours présenter ses légendaires fourrures. » (p. 307) ; « La deuxième partie du programme montrait la vie quotidienne chez les Ricardo, une famille de chimpanzés. » (idem) Par exemple, dans la biographie La Véritable Joséphine Baker (2000) d’Emmanuel Bonini, Joséphine Baker est comparée à un « singe qui aurait fait de la gymnastique suédoise » (p. 45).
c) Toutes des putes !
Les femmes réelles ont le malheur d’être fragiles, de ne pas être des Superwomen… ce qui attise chez un certain nombre de personnes homosexuelles une déception et une méfiance croissantes à leur égard. La femme, jadis désincarnée en vierge, finit, parce qu’elle est incarnée, par être traitée de prostituée, de femme impure, de putain : « Sale pute. » (Christophe Honoré à propos de Fanny, la femme avec qui il vient de coucher, dans l’autobiographie Le Livre pour enfants (2005), p. 30) ; « J’ai d’abord imaginé que je lui faisais l’amour, à elle, Sabrina, sachant qu’une pareille image ne pouvait pas me faire bander. Puis j’ai imaginé des corps d’hommes contre le mien, des corps musclés et velus qui seraient entrés en collision avec le mien, trois, quatre hommes massifs et brutaux. J’ai imaginé des hommes qui m’auraient saisi les bras pour m’empêcher de faire le moindre mouvement et auraient introduit leur sexe en moi, un à un, posant leurs mains sur ma bouche pour me faire taire. Des hommes qui auraient transpercé, déchiré mon corps comme une fragile feuille de papier. J’ai imaginé les deux garçons, le grand aux cheveux roux et le petit au dos voûté, me contraignant à toucher leur sexe, d’abord avec mes mains puis avec mes lèvres et enfin ma langue. J’ai rêvé qu’ils continuaient à me cracher au visage, les coups et les injures ‘pédé’, ‘tarlouze’ alors qu’ils introduisaient leur membre dans ma bouche, non pas un à un mais tous les deux en même temps, m’empêchant de respirer, me faisant vomir. Rien n’y faisait. Chaque contact de Sabrina avec ma peau me ramenait à la vérité de ce qui se passait, de son corps de femme que je détestais. » (Eddy Bellegueule dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 193) ; etc.
d) Toutes des diablesses !
Chez beaucoup de personnes homosexuelles (surtout gays, mais pas uniquement), le dégoût des femmes semble presque épidermique : « J’avais vite compris que Liane était une fille extrêmement jalouse : une vraie tigresse cette nana ! Sa paranoïa m’excédait ; j’étais constamment épié et cela m’exaspérait. » (Ednar, le personnage homosexuel ayant tenté de sortir avec une femme, dans le roman semi autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 157) Je l’ai beaucoup observé et entendu chez mes amis homosexuels, hommes et femmes confondus.
Pour ma part, ce dégoût physique pour les femmes, je ne le méprise pas… Au contraire. Je ne le justifie pas, mais je le comprends complètement puisque je le ressens aussi en moi, de manière inexplicable, dans mon corps et dans mon cœur. Il me dépasse pour l’instant. Comme une blessure énigmatique, invisible mais réelle. Les femmes, même si je les trouve belles, ne sont pas, à mes yeux, désirables. Je les trouve sensuelles à distance, à partir du moment où elles ne me touchent pas et n’éprouvent pas de sentiments amoureux à mon encontre. Dès qu’elles s’approchent ou jouent la séduction, je débande, me glace. Et leurs tentatives de proximité excessive m’exaspèrent, me dégoûtent, et surtout me laissent complètement indifférent. C’est très étrange. Je vois les femmes, c’est vrai (et c’est terrible) comme des êtres collants, ventouse, un peu pieuvre, et j’en suis le premier navré, car l’effet repoussoir, même si je me refuse à le définir comme uniquement physiologique, a pourtant tout l’air d’être naturel et imposé par des lois antérieures à ma conscience de mon attrait physique pour les hommes.
Pour revenir aux personnes homosexuelles en général, j’ai l’impression que, de leur point de vue, La beauté de la femme n’est pas envisagée comme une force fragile, mais bien comme une arme redoutable, qui soumet et assigne un cruel destin. Pour beaucoup d’entre elles, une vraie femme belle est une femme jalouse, fuyante, dangereuse, peste, voleuse, bavarde, bruyante, intrusive, curieuse, parlant pour ne rien dire ou pour médire, séductrice, maléfique, manipulatrice. Par exemple, dans son roman L’Hystéricon (2010), Christophe Bigot se centre souvent sur les femmes manipulatrices, diaboliques, capricieuses, inaccessibles.
Dans l’esprit d’un certain nombre de personnes homosexuelles, la féminité se réduit à la possessivité de la mère cinématographique étouffante : une femme, ça cancane, forcément ! ça jalouse ! ça tue aussi ! La femme est jugée maudite, quand bien même cette malédiction la rende soi-disant belle, désirable, forte.
Par exemple, Marc Cherry, le créateur homosexuel de la série Desperate Housewives (2004-2012), en même temps qu’il propose des portraits diversifiés de (sa vision de) l’émancipation de la femme, caricature très négativement les femmes en croqueuses d’hommes, en bourgeoises réactionnaires, en femmes hystériques, etc. D’ailleurs, en ses fonds, l’idée originale de la série s’appuie sur un fait divers glauque, où la féminité est dangereuse : Marc Cherry explique en effet qu’il s’est inspiré en 2002 de l’infanticide qu’une femme, Andrea Yates, a opéré sur ses cinq enfants qu’elle a noyés dans une baignoire…
e) La misogynie en actes (Toutes des martyres !) :

Film « Mathilda Paradeiser » de Lisa Aschan
Une telle vision de la femme n’est pas sans conséquence dans le comportement des personnes homosexuelles. La misogynie se traduit en actes. D’abord une distance : les femmes sont laissées de côté en amour, et, par une logique compensatoire, on leur décerne quand même le trophée précaire et aléatoire de « meilleures amies ».
La misogynie peut aller jusqu’à l’envie de meurtre, ou carrément l’assassinat : « Je hais les femmes, il n’y a que des esprits malins qui tirent de ce dégoût de quoi me faire plusieurs crimes… » (le Marquis de Vauvenargues, Maximes posthumes, 1746) ; « Je l’ai frappée. Je l’ai saisie par les cheveux et j’ai claqué sa tête contre la tôle du car du collège qui stationnait là, avec violence, comme le grand roux et le petit au dos voûté dans le couloir de la bibliothèque. Beaucoup d’enfants nous voyaient. Ils riaient et m’encourageaient, ‘Vas-y défonce-la, défonce-lui la gueule.’ Amélie qui pleurait me suppliait d’arrêter. » (Eddy Bellegueule, le garçon homosexuel efféminé, dans le roman autobiographique En finir avec Eddy Bellegueule (2014) d’Édouard Louis, p. 106) ; etc. On connaît les violences conjugales que des Paul Verlaine ou des Nijinski ont infligé à leur femme. « Nijinski avait déjà frappé sa femme, allant même jusqu’à la pousser violemment dans l’escalier de la villa. » (Christian Dumais-Lvowski, dans l’avant-propos de Vaslav Nijinski, Cahiers (1919), p. 11) Je vous renvoie à mon étude plus approfondie du meurtre de la femme dans les codes « Matricide », « Violeur homosexuel », et la partie sur la « Prostituée tuée » dans le code « Prostitution », de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Finalement, on se rend compte que les personnes homosexuelles misogynes reprochent à la femme tout ce qu’elles lui font (iconographiquement/concrètement)… et qu’elles ne devraient se reprocher qu’à elles-mêmes…
f) D’où vient cette misogynie homosexuelle ?
Cela peut paraître complètement fou que tant d’individus homosexuels, qu’on persuade d’être les meilleurs amis des femmes (et qui finissent par le croire !), soient aussi ignobles avec leur entourage féminin. Les motifs rationnels semblent même leur échapper !
Comment expliquer cette décharge de haine ?
Il est important de souligner, avant de commencer mon listing d’hypothèses, que, même si elle est très marquée dans les rangs homosexuels, la misogynie n’est évidemment pas exclusivement homosexuelle. D’un point de vue extérieur, à bien des égards, ce code pourrait sembler un peu impitoyable et accablant pour l’ensemble des personnes homosexuelles. Mais à leur décharge, j’aimerais dire qu’il ne faudrait pas leur jeter trop vite la pierre : d’une part, leur misogynie est toujours le signe d’un irrespect des femmes beaucoup plus global, social, hétérosexuel ; d’autre part, elle est bien souvent un mécanisme instinctif de résistance (une résistance bien légitime) mis en place pour gérer/étouffer tant bien que mal un inceste opéré par une mère abusive, une star de télévision indécente, une femme intrusive : « Au départ de presque toutes ces lamentables existences, il y a les mères. Les petites vies étriquées de ces êtres qui vivent à deux ou se contentent des sordides aventures d’urinoirs sont les résultats de la bonne éducation, les fruits de leçons trop bien suivies sur la crainte du péché, les dangers de la femme, tout ce qui fait la honte d’une religion mal comprise. Cette haine de la femme et cet excessif attachement à la mère, je les ai connus et je sais qu’ils peuvent, par instants, atteindre à la véritable névrose. Encore aujourd’hui, je ne suis pas tout à fait habitué à l’absence de ma mère et, lorsque je suis loin d’elle, je cherche à la joindre par téléphone et lui écrits tous les jours. C’est elle, cependant, qui est en grande partie responsable de mon état misérable, par la façon dont elle m’a obligé à vivre constamment dans son sillage. » (Jean-Luc, homosexuel, 27 ans, cité dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 104) ; « La fixation haineuse ou crainte vis-à-vis de sa mère devient, par suite du sentiment de culpabilité, de l’amour et le malade transfère la haine qu’il avait pour sa mère sur les femmes dont, en réalité, il a peur. L’impression de domination, acceptée de sa mère, devient, devant les femmes, un sentiment de révolte, de haine et de dégoût. Très souvent même, d’angoisse. Ces observations expliquent l’exécration des homosexuels à l’égard des femmes. Bien des observateurs ont remarqué qu’une grande partie des homosexuels avait été élevée dans des pouponnières ou au contact exclusif des femmes. Devenus par le caractère des femmes, ils en sont des rivaux et, tout naturellement se comportent comme tels. » (Jean-Louis Chardans, op. cit., p. 107) ; etc.
La raison la plus évidente de l’existence de la misogynie proprement homosexuelle, mais aussi la plus insuffisante si on ne s’en tient qu’à elle seule, c’est la peur de la sexualité, angoisse qui se déclinera parfois plus tard en révulsion : « Je faisais croire que j’étais branché sur les filles ! En réalité, elles me faisaient très peur. Dès qu’elles étaient trop proches, je reculais. » (Brahim Naït-Balk, Un Homo dans la cité (2009), pp. 29-30) ; « Sur le plan de l’amitié, je m’entends très bien avec les femmes. Je les considère comme des êtres précieux, intouchables, c’est le cas de le dire en ce qui me concerne. Un je-ne-sais-quoi en elles me fait peur, je ne sais pas comment m’y prendre et je sens bien que je ne les rendrai pas heureuses, et que je ne serai pas à la hauteur. » (idem, p. 41) ; « Une fille, après tout, ça ne sert à rien et ça ne fait que se plaindre. D’un autre côté, elle me fait peur. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 9) ; « J’ai eu quelques relations sexuelles avec des filles. J’ai essayé avec une fille vers 22 ans : je n’ai pas réussi à être en érection donc pas de pénétration. À 28 ans, je sors à la mer avec une fille. Le premier soir, c’est la panne assurée. Ensuite en réessayant avec elle et en me disant que j’étais un homme, j’ai réussi à être en érection correcte et à me dépuceler. Mais pas une érection pleine, comme si la douceur d’une femme m’effrayais, y’avait un jugement, une pression de performance et de fragilité accompagnée d’insécurité pour ma part. Comme si mon énergie est une énergie féminine. Mon énergie masculine est quasiment inexistante, et deux énergies féminines ne peuvent s’unir. Je suis sorti il y a un mois avec une fille mais elle n’a pas aimé ma manière de faire l’amour. Comme si je l’avais violée dans son être. Elle me disait que y’a eu aucune douceur comparé aux autres garçons et que je ne pensais qu’à moi. Comme si le fait de la sauter était primordial. » (cf. le mail d’un ami homo, Pierre-Adrien, 30 ans, reçu en juin 2014) ; etc.
La misogynie homosexuelle dit surtout un rejet de la différence des sexes dans son ensemble, de la sexuation, et du Réel, bref, une misanthropie et une haine de soi reportée sur les autres : « J’aime pas les filles. J’aime que les garçons. » (Pascal lors du débat « Toutes et tous citoyen-ne-s engagé-e-s », organisé le samedi 10 octobre 2009, à la Salle des Fêtes de la Mairie du XIème arrondissement de Paris) ; « Misogynie ? Mettons que je sois très sensible à un certain côté étroit et borné, superficiel et pesamment matériel tout ensemble, chez la plupart des femmes. […] Le mot misanthropie me semblerait plus juste, dans le découragement qu’il implique vis-à-vis des êtres humains quel que soit leur sexe, et souvent sans s’excepter soi-même. » (Marguerite Yourcenar, Le Coup de grâce, 1938) ; « Pour Michel Ange, la femme était contre nature. » (Philippe Simonnot dans son essai Le Rose et le Brun (2015), p. 185)
La misogynie homosexuelle est aussi une rébellion (mal gérée) face aux menaces de réification, aux privations de liberté, aux viols, aux lois du marché capitaliste : « Après, toutes les nanas, je les prenais pour des choses bizarres, elles avaient des choses que je trouvais superflues, des passions complètement débiles : le vernis à ongle. » (Gaëlle, femme lesbienne de 37 ans, dans l’essai Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010) de Natacha Chetcuti, p. 57)
L’exclusion des femmes dit également une conscience identitaire déplacée, un orgueil mal placé, une jalousie inavouée : « Quand les hommes critiquent les femmes, cela vient souvent de leur dépit de n’avoir pas la possibilité d’être eux-mêmes une femme. » (cf. l’article « Le Complexe de féminité chez l’homme » de Félix Boehm, dans l’ouvrage collectif Bisexualité et différence des sexes (1973), p. 444) ; « La jalousie des hommes à l’égard des femmes n’est ni plus rare, ni moins profonde que celle des femmes à l’égard des hommes, mais elle est moins bien reconnue et comprise. » (Mélanie Klein, Joan Riviere, L’Amour et la haine (1936) ; « On reconnaît les homosexuels masculins au mépris qu’ils professent pour la femme en général (très souvent en proportion de leur manque de virilité propre). » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 260) ; « Je ne suis pas née dans le bon corps et j’ai toujours su que j’étais une femme. Je n’étais pas dans le bon corps. J’étais jalouse des filles. » (Kellie Maloney, homme transsexuel M to F, et ex-manager de Lennox Lewis, interviewé dans cet article de la revue Têtu) ; etc.
Il est possible que la misogynie homosexuelle vienne de l’excès de proximité avec les femmes, y compris celles qui sont présentées comme des amies d’enfance, des « meilleures amies », d’adorables substituts maternels. La fusion précoce et incestueuse avec le monde féminin, notamment dans l’enfance, entraîne en général une rupture progressive à l’âge adulte, une distance, un agacement, une déception. Les femmes ont eu le malheur d’être fragiles, de ne pas être des despotes, et certains individus homosexuels ne le leur ont pas pardonné : « C’est ça que je n’aime pas chez la femme : c’est cette fragilité. » (Alain, un témoin homosexuel dans le reportage « Jeune homme à louer » (1992) de Mireille Dumas) Par exemple, dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, on érige en déesses les « scums », à savoir la nouvelle race de « femmes indépendantes, arrogantes, dominantes, violentes, qui s’estiment faites pour régner sur l’univers » ; en revanche, « les gentilles fillettes, passives, soumises, ternes, cultivées, dépendantes, au ‘caractère mâle’, mariées, connes » sont mises plus bas que terre.
En outre, je crois que la misogynie homosexuelle repose surtout sur le rapport réifiant et idolâtre – qu’on pourrait appeler aisément « fanatique » – qui s’instaure entre les femmes et le sujet homosexuel. Aux femmes réelles, celui-ci leur préfère en général les femmes-objets, ces poupées qu’il peut manipuler, et vider du mystère qui lui fait tellement peur. Si l’on en vient à rejeter la femme, c’est surtout parce que l’on fait la confusion (non intellectuelle… encore que… mais surtout la confusion dans l’intimité du cœur) entre fiction et réalité, entre intentions et actes : « Il nous faut d’abord tuer le mythe de la femme. » écrit par exemple Monique Wittig dans son pamphlet La Pensée Straight (1979-1992).
En effet, la misogynie homosexuelle se traduit paradoxalement par une sacralisation de la femme et une tentative de réification de celle-ci. Un certain nombre de créateurs homosexuels prouvent d’ailleurs régulièrement qu’ils tentent de transformer les femmes en bibelots pour les garder pour eux seuls : « La mode et la décoration restent leurs deux plus grands fiefs : ce sont eux qui, par haine de la femme, la coiffent en éphèbe, la vêtent en sac de pralines ou en cylindre de drap et la couronnent de n’importe quel échafaudage de paille ou de feutre. Dans ces ‘créations’, au travers de ces élucubrations, que chaque femme est obligée d’interpréter considérablement si elle ne veut pas perdre le sommeil à sa propre vue, on perçoit la jalousie du pédéraste devant cette créature qu’il voudrait intensément imiter. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 20) ; « La nature féminine se transforme sous le crayon des créateurs de mode. […] Ils entraînent l’humanité consentante vers des corps de femmes sans seins ni fesses, sans rondeur ni douceur, des corps de mec, longs et secs. Ce sont leurs fantasmes que les créateurs de mode imposent à l’humanité, leurs fantasmes d’homosexuels (puisque l’énorme majorité d’entre eux le sont), qui rêvent davantage sur le corps d’un garçon que sur celui d’une femme. […] Aujourd’hui, les jeunes filles, toujours au bord de l’anorexie, se fabriquent un corps de garçonnet pour plaire à des créateurs homosexuels qui n’aiment pas les femmes, qui les considèrent comme de simples ‘portemanteaux’, et les terrorisent pour quelques grammes de trop. » (Éric Zemmour, Le Premier Sexe (2006), pp. 19-20)
Aux femmes réelles, beaucoup de personnes homosexuelles leur préfèrent les femmes-objets, ces femmes dont elles peuvent se servir, puis jeter une fois usées, des hommes à la féminité caricaturale et forcée : « Des transsexuelles me prirent sous leur coupe, persuadées qu’elles avaient la solution à mon chagrin. Amour divin, amour profane, nous entretenions les sentiers d’une relation juste et sensible. Mais, ces ébats qui ne me procuraient aucun plaisir, ne faisaient qu’aggraver le trouble existant de la scène de violence vécue avec mon frère. Cette scène qui me hantait et réveillait ces horribles douleurs au ventre. Et puis pour moi, c’était des filles ; et les filles, franchement, ne m’attiraient pas. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 119) ; « Plus le temps passe, plus je trouve Natacha collante. Je suis juste content d’être avec elle quand nous allons en boîte et que tout le monde la regarde avec envie. […] Natacha, la blonde pulpeuse à robe blanche, […] c’est juste un faire-valoir. » (Alexandre Delmar, Prélude à une vie heureuse (2004), p. 111) ; « J’avais des couvertures. J’avais beaucoup de filles qui venaient à la maison. » (Denis, un témoin homosexuel, dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 68) La femme est utilisée comme une couverture, un appât, une « bonne copine » qui tient compagnie : on ne lui donne pas de rôle valorisant. « Laura, c’est ma copine la dodue qui vient me voir, elle est gentille. » (Kamel dans l’autobiographie Parloir (2002) de Christian Giudicelli, p. 67) ; « C’est ma voisine Ariane. Elle est folle. » (André à son amant Laurent, dans le docu-fiction « Le Deuxième Commencement » (2012) d’André Schneider) ; etc. L’expression « Fag-Hag », traduction de « fille à pédés » en anglais, si on la traduit littéralement, signifie « vieille sorcière de pédales », ce qui n’est évidemment pas très flatteur… L’union entre le sujet homosexuel et la FAP est souvent une union de misère(s) fondée sur des échecs amoureux successifs, une union d’intérêts individuels, une fascination pour le viol : « Le monde de mon enfance était un monde peuplé de femmes abandonnées. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1992), p. 20)
Plus une femme est médiatisée, connaît un destin tragique, un succès fulgurant et malheureux, plus elle a des chances d’être élue une icône gay ! Cela se vérifie presque à tous les coups. Les femmes auréolées par les personnes homosexuelles se sont parfois fait avorter ou ont subi des fausses couches, ont vécu l’inceste ou le viol, se sont fait battre (Dalida, Marilyn Monroe, Mylène Farmer, Maria Callas, Édith Piaf, Judy Garland, Whitney Youston, etc.), bref, représentent la féminité fatale. Il y a clairement dans la misogynie homosexuelle l’expression d’un fantasme de viol (qui dit, dans certains cas, l’expérience d’un viol réel) : d’ailleurs, que ce soit dans les films de Josef von Sternberg, les pièces de Copi, ou les intrigues de Tennessee Williams, le thème de prédilection est la femme violée.
Le paradoxe de la misogynie homosexuelle repose sur une forme d’inversion, un tour de passe-passe, une substitution entre désirs et Réalité : on assiste à la destruction/disparition de la femme réelle par la glorification de la femme-objet. Plus que le féminisme (qui reconnaît les spécificités des femmes sans les opposer systématiquement à celles des hommes), c’est la femme en tant que « caractère », « personnage », « personnalité », donc en tant que fantasme individualiste, qui est célébrée par la population homosexuelle.
C’est cette confusion dans le cœur des personnes homosexuelles entre femme réelle et femme-objet qui me fait dire que l’acte de destruction de la femme n’est pas tant une démarche misogyne qu’une démarche iconoclaste. Il y a comme un double mouvement d’adoration/destruction : la femme-objet est livrée, telle la Reine du Carnaval, aux flammes et à la risée générale, pour, en intentions, prouver qu’elle est bien humaine et immortelle, et intellectuellement, pour prouver qu’elle n’est qu’un objet méprisable qui a capturé leur espace psychique désirant. Par exemple, lors du concert Météor Tour du groupe Indochine à Paris Bercy le 16 septembre 2010, on nous montre sur les écrans géants une Miss Italy sur un bûcher embrasé. Dans son film « Serial Mother » (1994), John Waters s’amuse à détruire le mythe de la mère au foyer bien sous tous rapports. Certains groupes musicaux homosexuels se baptisent de nom dédiés précisément au meurtre de la femme-objet : le groupe lesbien français Barbieturix, le groupe nord-américain Destroy All Blondes (créé par le cinéaste Gus Van Sant), etc. En quelque sorte, le sujet homosexuel semble se venger sur sa poupée fétiche de sa propre prétention à se prendre pour un objet, pour un mythe.

Film « Salò ou les 120 Journées de Sodome » de Pier Paolo Pasolini
Le plus paradoxal dans la relation des personnes homosexuelles aux femmes, c’est que ce sont les créateurs qui ont le mieux construit le mythe de l’Éternel Féminin et qui se sont entourées des plus belles femmes du monde, qui ont aussi le plus méprisé les femmes réelles, et ont finalement le plus cherché à les détruire à l’écran ! Par exemple, en 1966, Francis Bacon détruit iconographiquement Isabel Rawsthorne, une belle femme qu’il aime pourtant beaucoup. Le poète argentin Néstor Perlongher, de son côté, va cultiver tout au long de son œuvre son étiquette d’« unique poète à avoir osé violer poétiquement Eva Perón », une femme que néanmoins il adore et qui restera la passion de sa vie. Dans ses films, le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini est capable de transformer les femmes en divas magnifiques… ou en chiens coprophages et en prostituées (cf. les films « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » « Salò ou les 120 Journées de Sodome » en 1975, « Teorema » « Théorème » en 1968, etc.). Russ Meyer est un bon exemple de ces créateurs homosexuels et pères de la « femme libérée » : il a transformé la femme en tigresse, en poupée gonflable, en star du porno, en femme-amazone « pour machos un peu malades… car lui-même est un peu comme ça » (cf. le documentaire « Pin-Up Obsession » (2004) d’Olivier Megaton). Je vous renvoie à ses films « Faster, Pussycat ! Kill ! Kill ! » (1985) et « Beyond The Valley Of The Dolls » (1969). Federico García Lorca, qui dans toute son œuvre élève la femme au panthéon des anges stériles et des matrones toutes-puissantes, fait quand même dire à ses personnages féminins : « Maudites soient les femmes ! » (Magdalena à la scène 4 de l’Acte III, dans la pièce La Casa De Bernarda Alba, La Maison de Bernarda Alba, en 1936). Ses héroïnes sont toutes condamnées à vivre mal mariées, et à être seules. Marcel Jouhandeau aime beaucoup les femmes (il a beaucoup honorer sa mère, ou bien encore Élise, et Véronique Pincengrain) et les traite pourtant de « monstres » (cf. l’émission Apostrophe, sur la chaîne Antenne 2, le 22 décembre 1978). George Cukor est présenté comme « l’homme qui aimait les femmes » (cf. l’article « George Cukor, l’homme qui aimait les femmes… (jusqu’à un certain point !) », sur le site suivant). Seulement voilà : comment les dépeint-il ? Comme des caricatures de féminité ! (On pensera à Judy Holliday dans le film « The Women » en 1939, à Ingrid Bergman dans le film « Hantise » en 1944). Il les associe purement et simplement à des créatures diaboliques (cf. les films « La Diablesse en collant rose » (1959), « La Femme aux deux visages » (1941), « No More Ladies » (1935), etc.). Quant au réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder, il passe pour un amoureux de la femme (il a immortalisé Lola, Lili Marleen, Veronica Voss, Petra von Kant, etc.) alors qu’il leur réserve un traitement particulièrement odieux à l’écran : il n’y en a pas une actrice fassbindérienne qui ne se fasse pas gifler ou battre dans ses films (cf. l’exposition Rainer Werner Fassbinder au Centre National Pompidou, à Paris, en avril-juin 2005). L’image de la femme est à nouveau mise à mal par un autre réalisateur homo qui est pourtant connu pour être un ami des femmes : Werner Schroeter. Par exemple, son film « Willow Springs » (1973) reprend le thème du danger féminin : un cercle de femmes tenant une auberge rouge tue tous les voyageurs masculins qui s’y arrêtent. Jetons maintenant un œil sur la filmographie de Pedro Almodóvar, le réalisateur espagnol souvent présenté comme le pygmalion majuscule des stars féminines du cinéma ibérique : ses actrices sont brûlées au quatrième degré par une tasse de café renversée (cf. le film « ¿ Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto ? », « Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? » en 1984), soumises ou putains (cf. les films « Pepi, Luci, Bom Y Otras Chicas Del Montón » en 1980, « Entre Tinieblas » « Dans les ténèbres » en 1983, « Mujer Al Borde De Una Crisis De Nervios » « Femme au bord de la crise de nerfs » en 1988, etc.), théâtrales et meurtrières (cf. les films « Todo Sobre Mi Madre » « Tout sur ma mère » en 1998, « Tacones Lejanos » « Talons aiguilles » en 1991, « Matador » en 1985, « Volver » en 2005, etc.). Dans un registre similaire, même s’il ne s’agit pas du tout de la même époque, le peintre français Gustave Moreau (1826-1898) traite les femmes de « folles, perverses et diaboliques » dans son Journal, alors que paradoxalement il a sublimé sur ses toiles les plus grandes héroïnes des mythologies humaines (Salomé, Hélène de Troie, Cléopâtre, Hérodiade, Andromède, Léda, etc.). Le portrait que le réalisateur français François Ozon dresse de la féminité dans son film « Huit Femmes » (2002) n’est pas plus tendre. On a l’impression qu’il sacralise la femme : en réalité, ses héroïnes ne sont que des caricatures de féminité. Il dépeint la soi-disant capacité des femmes à broder des tas d’histoires mesquines autour d’un homme et d’un crime qui n’existent pas. Toutes les attitudes étiquetées « négativement féminines » y sont : le romantisme naïf, la nunucherie, la moralisation, la superstition, les commérages, la jalousie paranoïaque, le cynisme, les coups bas, le respect hypocrite des traditions, la tempérance lâche, l’espièglerie, la manipulation froide, la séduction courtisane, etc. D’ailleurs, ses huit femmes finissent par conduire l’unique homme de l’histoire au suicide. Dans son one-man-show Jérôme Commandeur se fait discret (2008), Jérôme Commandeur ne se gêne pas pour détruire les (caricatures des) femmes (réelles/médiatiques) qui l’entourent, et qui composent pourtant l’essentiel de son spectacle : il traite par exemple son personnage de Pénélope de « buffle ». Dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ! (2012), l’humoriste Samuel Laroque n’y va pas de main morte avec les femmes : à la fois il semble visiblement adorer ses actrices et ses chanteuses préférées, et pourtant il les détruit, tout en niant son fantasme de transfert d’identité (« Moi ?!? Être une femme ?!? Oh quelle horreur ! ») ; par exemple, il traite la bourgeoise Liliane Bettencourt d’« Horreur de Loréale » (cf. jeu de mots avec l’aurore boréale), ridiculise le vagin des femmes (« Et il paraît qu’il y en a qui s’en serve comme un ventriloque ! »), singe Mylène Farmer ou encore Chantal Goya. Bref, il vénère les femmes dans la destruction/dans la simulation de destruction. Ses meurtres misogynes ne seront principalement qu’iconographiques et symboliques. Dans le one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013), le travesti M to F David Forgit défonce la présentatrice télé Sophie Davant, « cette perruche peroxydée », sans cacher sa propre jalousie. Dans son one-man-show Les Bijoux de famille (2015), Laurent Spielvogel passe son temps à détruire les femmes (réelles et fictionnelles) par l’imitation caricaturale : mère possessive, tante, actrices, chanteuses…
C’est plus le mythe de la femme (la femme-objet en l’occurrence) qui est massacré que la femme réelle. Mais le problème de la majorité des personnes homosexuelles est que la différence entre les deux femmes n’est pas souvent faite ! … si bien que leur misogynie est probable, prioritairement iconographique, sans pour autant devenir automatique ou effective.
Cette confusion inconsciente entre les femmes-objets hétérosexuelles et les femmes réelles, c’est en réalité le fruit d’une inversion entre les bonnes intentions et les actes. Parfois, on peut lire de la part de certains membres de la communauté homosexuelle une défense des pratiques qui concrètement ne respectent pas les femmes, même si en théorie elle se fait au nom de leurs droits et de leur liberté : l’avortement (cf. le documentaire « Regarde, elle a les yeux grand ouverts » (1978) de Yann Lemasson), la sodomie pratiquée sur les femmes (« La sodomie peut apporter du plaisir à une femme » soutiennent Daniel Borillo et Dominique Colas dans leur essai L’Homosexualité de Platon à Foucault (2005), p. 169), la prostitution (Alberto Mira, Roland Barthes, et tant d’autres, osent présenter la prostitution comme un acte libre et d’émancipation de la femme), etc.
La misogynie homosexuelle se pare souvent des meilleures intentions : c’est pour cela qu’elle est efficace, et invisible aux yeux de celui qui la pratique. Par exemple, lors de sa conférence « L’Homoparentalité aux USA » à Sciences Po Paris, le 7 décembre 2011, Darren Rosemblum, qui, avec son compagnon, a fait appel à une mère porteuse en GPA (Gestation Pour Autrui) pour « obtenir » sa petite fille, joue la proximité avec la mère à qui ils ont payé/volé le bébé : « On est devenus très très proches de la femme qui a porté notre enfant. » La proximité va jusqu’à l’identification et la substitution à cette génitrice : « Je me sentais enceinte. » On voit bien ici que les deux parties – le couple gay d’un côté, la mère porteuse de l’autre – s’utilisent mutuellement sans scrupules. D’ailleurs, Darren Rosemblum avoue bien tard que la femme qui a accepté de collaborer avec eux lui a dit explicitement que ce qu’ils venaient de faire ensemble était de « l’exploitation mutuelle ».
La femme détruite et incarnée par certaines personnes homosexuelles est en fait un personnage, un rôle, et non la vraie femme sexuée. C’est un androgyne interlope que tous peuvent incorporer (il suffit de le désirer et de le singer). La femme-salope est au fond un fantasme asexué et hypersexué. Beaucoup de comédiens homosexuels (souvent travestis) traitent de « salopes » ou de « copines » non pas toutes les femmes mais tous les gens (et notamment les hommes) qui désirent se prendre pour la femme-objet cinématographique. Signe provocateur (et presque tendre) de connivence fraternelle de fantasmes schizophréniques, de folie, d’orgueil mégalomaniaque assumé. Par exemple, dans son one-(wo)-man show Désespérément fabuleuses : One Travelo And Schizo Show (2013), le travesti M to F David Forgit s’en va en laissant un message mi-agressif mi-communionnelle destiné à son public : « Mes sœurs salopes ». Dans son spectacle Charlène Duval… entre copines (2011), le travesti M to F Charlène Duval nous convie précisément à passer un petit moment « entre copines », en féminisant parodiquement son public (principalement mâle et homosexuel).

Film « Liebe Ist Kälter Als Der Tod » de Rainer Werner Fassbinder
Si les individus homosexuels mesuraient que ce n’est pas contre les femmes aimant vraiment leur mari (qu’ils appellent à tort « hétérosexuelles »), mais bien contre les femmes-objets hétérosexuelles sans désir (pléonasme), donc bisexuelles voire homosexuelles, que leur misogynie se déchaîne, ils seraient sûrement moins inconsciemment misogynes !
C’est la féminité forcée, singée, en gros le travestissement sexué, qui est haï et qui est facteur de haine.

Planche « Le Miroir » de la B.D. « Le Monde fantastique des gays » de Copi
Quand on lit les mots d’une écrivaine comme Paula Dumont dans son autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), on décèle bien que la haine de la bisexualité, ou la lutte contre « l’homophobie intériorisée », font écran, dans l’esprit de beaucoup de personnes homosexuelles, à leur propre misogynie : « Nous autres, les goudous à cent pour cent, c’est à ça qu’on est bonnes, elles viennent se faire baisouiller un moment, et tout à coup, elles reprennent leurs esprits et elles nous proposent d’être leurs amies ! […] Ces femmes nous méprisent. Elles se servent de nous quand elles sont en manque et le premier argument leur suffit pour tirer l’échelle quand elles ont eu ce qu’elles voulaient. » (p. 123) La misogynie homosexuelle vient prouver nettement quelque chose d’ahurissant aux yeux des personnes homosexuelles : que leur désir homosexuel est par nature misogyne et homophobe : « Paradoxalement, son homophobie affichée rimait avec sa misogynie. » (Ednar parlant de son grand frère homophobe, dans le roman semi autobiographique Un Fils différent (2011) de Jean-Claude Janvier-Modeste, p. 34) Toutes les haines humaines sont liées, je le dis bien.
En fin de compte, la misogynie – d’autant plus quand elle est homosexuelle – me révolte. Car elle se fait sous couvert d’esthétisme et de recherche de beau, de lutte contre l’hétérosexisme, d’« affirmation de soi » et de l’« Amour », de droit d’exister, d’authenticité, de victimisation, de résistance héroïque et légitime à « l’envahisseur hétérosexuel »… alors qu’elle marche pourtant au diapason des diktats hétérosexuels du machisme ! J’ai pour le prouver un très bel exemple : ma dernière soirée à la boîte gay et lesbienne Le Tango à Paris, une discothèque que je vous invite d’ailleurs à boycotter, même si elle reste, vue de l’intérieur, un petit paradis de convivialité interlope, où on peut danser sur des chansons rétros et actuelles très sympas. L’illusion d’amitié et d’amour à l’intérieur est inversement proportionnelle à la dictature extérieure qui la permet. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis cela. C’était le 20 janvier 2008. Je fêtais l’anniversaire d’une amie, Eva, en compagnie de ses amis, et nous avions « naturellement » décidé de faire la deuxième partie de soirée en discothèque. Nous formions un groupe de dix personnes, dont trois garçons homos (moi + un couple), et sept filles (plusieurs très bisexuelles). En tout cas une bande particulièrement gay friendly et habituée à fréquenter les lieux d’homosociabilité, les locaux associatifs, les Gay Pride. C’était le début de soirée. Nous étions rue au Maire. Et le videur a refusé que nous rentrions dans la boîte. Pour nous prouver le bien fondé de son scepticisme, il a demandé aux filles de mon groupe de s’embrasser sur la bouche pour « prouver qu’elles étaient bien lesbiennes ». Magnifique… Les filles n’ont pas obtempéré. Par conséquent, nous avons été obligés de débarrasser le plancher. Scénario regrettable mais peu grave, et très classique si l’on suit la « logique » exclusive du monde de la nuit, me direz-vous… Et pourtant, derrière la banalité de l’incident, nous avons trouvé, mes amis et moi, la réaction de ce gérant du Tango d’une grande violence. Et elle l’était. Sinon, nous n’aurions jamais pété un pareil scandale à l’entrée de la boîte, et Eva ne serait pas allée prévenir les flics (qui ont été bien impuissants pour réparer l’injustice, d’ailleurs…). Les raisons de notre expulsion invoquées par le videur – avec qui j’ai échangé sur l’instant, puis après par mail – étaient les suivantes (d’ailleurs, elles se succédaient les unes après les autres sans lien, tellement aucune ne tenait debout !) : d’abord, la boîte était soi-disant pleine et ne pouvait pas nous accueillir (gros bobard puisqu’on était arrivés à une heure tout à fait normale si l’on s’en réfère aux habitudes du lieu ; d’ailleurs, tous les mecs qui faisaient la queue derrière nous sont rentrés ! Ça alors… cette boîte, c’est comme le sac de voyage de Mary Poppins !) ; ensuite, selon notre cerbère, il était hors de question que notre groupe puisse rentrer (« Pour vous, c’est mort » nous a-t-il sorti froidement, après avoir réussi à décourager le groupe de 6 filles qui nous devançait, et qui ont quitté la file d’attente sans discuter). Puis, suite à mon mail dénonçant les faits – un mail largement diffusé à mes contacts Internet, et qui était arrivé entre les mains de notre cher videur, j’ai reçu d’autres justifications encore plus bidons quelques jours après sur ma boîte mail : comme quoi d’une part mon groupe se devait de respecter la spécificité identitaire « gay et lesbienne » de la boîte (spécificité qu’en plus je ne remets pas du tout en cause, bien au contraire ! L’étiquette « boîte gay et lesbienne » a sa raison d’être. Je m’oppose uniquement à ce que cette spécificité devienne totalement excluante !), et d’autre part à chaque fois qu’il y aurait des problèmes et que notre cher videur aurait fait l’objet d’insultes homophobes pendant les soirées, cela viendrait majoritairement des « femmes hétérosexuelles » ! (je demande à voir ça…) Si encore, il m’avait dit que les agressions qu’il a subies venaient « des hétéros » (tous sexes confondus), j’aurais encore pu le croire… mais là, sa focalisation sur les femmes hétérosexuelles m’a estomaqué ! Si l’on suit sa logique jusqu’au bout, ce videur n’a pas de problème avec les hommes, y compris ceux qui sont « hétéros ». Tiens tiens, comme par hasard… En réalité, il n’a de problème qu’avec les êtres qu’il ne pourra jamais « détourner » ni baiser, et qui ne le font pas fantasmer sexuellement. Logique sexiste s’il en est ! Étant donné qu’il m’a parlé d’actions que je ne peux pas vérifier (je n’étais pas là quand « les hétérosexuelles » l’ont/l’auraient agressé), et que lui même n’a même pas pris le temps de décrire ces méfaits, je me suis retrouvé bien désarmé pour lui prouver ses mensonges. Mais j’ai juste compris que cet homme, bien plus qu’hétérophobe, était au fond misogyne. Dans son mail de réponse, il a enrobé sa mauvaise foi de fleurs et de jolies formules polies, mais au final, il n’a jamais formulé la moindre excuse. Je n’ai même pas pris la peine de lui répondre. Cette affaire m’a dissuadé de ne jamais plus mettre les pieds dans cette boîte où pourtant j’aime beaucoup danser. Quelques mois après, cependant, nos chemins se sont à nouveau croisés sans que nous le programmions. J’allais à une pièce de théâtre, et j’ai reconnu avant d’entrer un pote dans la foule. Il attendait patiemment trois autres amis à lui. Quand j’ai vu débarquer les amis en question, le videur du Tango en tête, on n’a pas eu le temps de s’éviter : il a fallu tous les deux qu’on se salue oralement. Et j’ai compris qu’il m’avait tout de suite identifié. Il a fait semblant de ne pas me reconnaître, et on n’a pas eu d’autre choix que de se retrouver placés à deux mètres de distance l’un de l’autre dans la petite salle de spectacle où nous allions voir le one-man-show. Le plus amusant, c’est qu’avant le lever de rideau, je l’entendais très distinctement dire à ses amis « qu’au bout du compte, c’était un garçon blasé, vraiment blasé ». C’était presque touchant tellement il avait fait exprès de parler bien fort pour que je puisse l’entendre de loin, et qu’il n’y avait rajouté aucune ironie ou provocation. Blasé… Oui, tu l’as dit, Bouffi… Blasé.
g) La misogynie des femmes lesbiennes envers les femmes : si si, elle existe ! On PEUT être contre soi-même
Nous aurions tort de penser que la misogynie a un sexe. La haine des femmes, on a maintes fois l’occasion de le vérifier dans les discours et les attitudes, est exprimée autant par les hommes gay que par les femmes lesbiennes. Le même rapport idolâtre – et donc jalousement destructeur – avec les femmes réelles, confondues avec les femmes-objets, est observable côté lesbien ! « Je hais les femmes d’ici ! Je hais les femmes d’ici ! Je hais les femmes d’ici ! » (Martha Jane Canary, alias « Calamity Jane », à sa fille Janey Hickok, dans Lettres à sa fille, 1877-1902) ; « Quand nous étions ensemble, Martine et moi, nous étions seules. […] Nous étions deux vieux garçons misogynes, mais à qui était-ce la faute ? » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 134) ; etc.
Beaucoup de femmes lesbiennes adoptent une vision catastrophiste de la condition féminine (vie de couple et de famille, maternité, coït sexuel, appartenance à un mari, rôle social soi-disant pré-défini, taches ménagères, etc.) : « Elles ont subi la double malédiction biblique : leurs désirs les ont portées vers leurs mecs et elles ont enfanté dans la douleur. Moi, j’ai échappé à cette malédiction. […] Bref, la moitié de l’humanité, celle qui a le pouvoir de donner la vie, reléguée au statut de bête de somme, voire de morceau de viande. » (Paula Dumont, Mauvais Genre (2009), p. 17)
On peut d’ailleurs interpréter le rejet d’endosser l’image et l’apparence des femmes réelles – et je parle ici des images bien éloignées des poncifs marchands et déshumanisants de la mode – comme une misogynie lesbienne voilée (et très tenace !). L’anticapitalisme sert de mauvais alibi, dans ce cas précis, pour nier sa propre sexuation. D’ailleurs, les femmes lesbiennes se travestissant en homme (ex : la comtesse de Morny, Colette, et tant d’autres), « les Jules », « les Butch » ou « les camionneuses » comme on les appelle usuellement, les dragkings, ne sont pas spécialement connues pour leur sympathie envers la gent féminine. C’est le moins que l’on puisse dire…
La misogynie de ces « femmes qui (soi-disant) aiment les femmes » étonnera certainement. Et pourtant, il n’y a qu’à observer la violence prédominante dans les rapports relationnels sapphistes (et pas seulement de drague ; déjà simplement amicaux) pour mesurer combien la misogynie lesbienne est forte. Les femmes bisexuelles, qui sont à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de ces cercles, sont les premières à le constater : « J’ai eu beaucoup plus de problèmes avec les femmes qu’avec les hommes. Les mecs m’ont toujours accepté à 85% avec mon penchant pour les filles. Les filles ne m’ont pas accepté à 85% avec mon penchant pour les mecs. » (Christine, femme bisexuelle qui s’est fait huer par le public de l’émission Ça se discute, sur la chaîne France 2, le 18 février 2004)
Fait curieux et en apparence paradoxal : dans les phrases misogynes des femmes lesbiennes, pourtant en théorie féministes et pro-femmes, l’agression plaintive se mêle au constat fataliste… et on ne sait pas trop démêler les deux. Elles se plaignent et pourtant donnent raison, dans la citation mimétique/ironique de leurs « ennemis les hommes », à leurs fantasmes auto-dévalorisants : « Les femmes seront toujours à côté de l’espace public. » (cf. propos de Michèle Riot-Sarcey, pour la sortie de son essai De la différence des sexes, à la Librairie Violette & Co de Paris, le 2 février 2011) Par exemple, dans son essai King Kong Théorie (2006), la très féministe Virginie Despentes énonce que le commun des femmes est « une imbécile quelconque » (p. 121). Mais comment faire comprendre que la victimisation excessive des femmes, loin de rendre service aux vraies femmes et d’exprimer un amour sain, est l’instrument idéal de la misogynie inconsciente ?
Par exemple, dans le documentaire « Debout ! » (1999) de Carole Roussopoulos, on voit clairement que les femmes féministes, lesbiennes ou non, sont attirées par la « femme violée du bout du monde », afin de se servir d’elle comme « opportunité » pour prouver l’oppression machiste qui les domine/dominerait. Dès qu’un fait d’actualité concernant le malheur des femmes se présente (par exemple les mères célibataires dans les hôpitaux, les femmes qui veulent se faire avorter, les femmes talibanes, etc.), le MLF accoure vers ses victimes pour les instrumentaliser à leurs fins : « Les femmes battues, c’était parfait ! Parce que si les femmes étaient battues, c’est bien parce qu’il y avait quelqu’un pour les battre. » (Annie Sugier)
Dans son autobiographie Mauvais Genre (2009), Paula Dumont dénonce ce « monde misogyne où toutes les femmes sont emprisonnées » p. 116), tout en se montrant agressivement solidaire à ses semblables sexuées : « Je tiens à mon genre, je mesure ce qu’il m’a coûté et ce dont je lui suis redevable. » (p. 116) ; « Aujourd’hui, je considère que j’ai eu de la chance d’être ce que je suis, femme et homosexuelle. Que soient donc bénis mon genre, qui n’est mauvais que pour les imbéciles, et mon amour des femmes. Amen. » (p. 117). Celle qui demanda à sa maman pourquoi elle n’était pas dotée d’un pénis comme les garçons, et qui s’habillera en cow-boy à l’âge adulte, défend, comme par amnésie, qu’elle n’a jamais détesté son identité sexuée de femme, et jalousé les hommes : « En aucune façon j’aurais voulu être un homme. » (p. 117) Quel incroyable fossé entre intentions et actions !
Le rapport des femmes lesbiennes à la femme lesbienne proche de la femme-objet ou de la beauté est souvent idolâtre, c’est-à-dire destructeur dans la convoitise. « Être fem n’a jamais été une expérience simple, ni dans les anciens bars lesbiens des années 1950, ni maintenant. Les fems étaient profondément chéries mais aussi dévalorisées. » (Joan Nestle parlant des femmes féminines – lesdites fem – , dans Attirances : Lesbiennes fems, Lesbiennes butchs (2001) de Christine Lemoine et Ingrid Renard, p. 26) Il apparaît donc clair aux femmes lesbiennes défendant les femmes et leur amour des femmes qu’elles ne peuvent pas être misogynes ni contre elles-mêmes, alors que pourtant, beaucoup de faits et paroles montrent l’excès destructeur et misogynes de leurs bonnes intentions !
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.