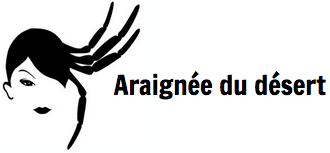Église catho et personnes homos : l’absurde opposition ; l’absurde confusion
Dans la tête de beaucoup de gens, homosexualité et foi catholique ne peuvent pas aller ensemble. Un catho homo est soit un extra-terrestre, un maso, une « honteuse », une « folle bourgeoise »… ou alors carrément un prêtre ! Dans les profils dressés par les internautes gay sur les sites de rencontres homosexuels, quand l’appartenance religieuse est spécifiée, il est massivement écrit « Je suis athée » ou bien « croyant mais non pratiquant ». Il est extrêmement rare de trouver parmi la population homosexuelle des individus catholiques pratiquants et fiers de l’être, et surtout réconciliés avec l’institution catholique. La poignée de catholiques homos se revendiquent solidaires de Dieu mais non de son Église, dont ils se disent injustement rejetés. Cette frontière entre homosexualité et foi n’est pas uniquement le fait des personnes homosexuelles, croyantes ou non. Elle est aussi construite par les croyants catholiques dits « hétérosexuels » qui affirment défendre la famille et ne pas manger à la même table des êtres « au penchant mauvais ».
Les dissensions entre la grande majorité des personnes homosexuelles et l’Église catholique ne datent pas d’hier. Lorsque les artistes homosexuels abordent iconographiquement le sujet religieux, ils choisissent presque toujours en toile de fond la perte de la foi et le blasphème. Mais parfois, la frontière entre agression picturale envers le clergé et agression réelle est franchie, et ceci, de plus en plus ouvertement et impunément (c. f. l’interruption de la messe de Notre-Dame de Paris en 1991 par Act Up, le mépris quasi systématique des ecclésiastiques ou des théologiens moralistes lors des débats télévisés ; l’altercation entre des catholiques intégristes et les participants au récent « kissing » devant Notre-Dame de Paris ; etc.). Beaucoup de personnes homosexuelles dénigrent la religion, alors que leur désir de foi occupe paradoxalement une part importante de leur identité de femmes et d’hommes. Seul ce que nous idolâtrons et aimons mal en croyant l’aimer follement peut nous trahir, et donc mériter à nos yeux notre vengeance. Ce qu’écrit Marguerite Radclyffe Hall dans Le Puits de Solitude (1928) est, pour cette raison, d’une étonnante actualité : « De nombreux invertis étaient profondément religieux et c’était sûrement l’un de leurs plus amers problèmes. »[1]
L’Église catholique en veut-elle vraiment aux personnes homosexuelles ? Vu ce qu’en montrent certains media, elles ont apparemment toutes les raisons de le croire. Et dans les faits, quelques-unes ont fait l’objet de réels rejets de la part d’ecclésiastiques et de certains fidèles à une époque où elles cherchaient une main tendue. Par conséquent, elles en déduisent que foi et homosexualité sont totalement incompatibles. Du côté des Évangiles, rien ne sert d’euphémiser. Le peu que dit la Bible sur les actes sodomites est sans appel : les actes génitaux et érotiques homosexuels ne sont pas acceptés[2], et depuis 2000 ans, l’Église n’a pas changé d’un iota son discours les concernant. Le Pape actuel, Benoît XVI, a bien écrit, lorsqu’il était encore cardinal, que les actes homosexuels étaient « intrinsèquement désordonnés »[3]. Tout semble donc indiquer que l’Église actuelle ne changera pas d’orientation quant à l’homosexualité pour les années à venir.
Cependant, si l’on prend un peu le temps de s’y intéresser, on découvre que la plupart des exclusions de personnes homosexuelles au sein de l’Église catholique, quand elles ont réellement eu lieu et qu’elles ne sont pas le fruit de projections farfelues, de susceptibilités et de paranoïas en tout genre (ce qui est plutôt rare !), restent des cas très isolés. S’il y a rupture entre l’Église et la communauté homosexuelle, elle est due dans son ensemble à certains croyants et ecclésiastiques qui n’en méritent même pas le nom parce qu’ils utilisent la foi plus pour haïr les autres que pour les aimer, et à des personnes homosexuelles qui s’écartent de l’Église en se prenant pour leurs actes et en partant du principe qu’elles seront jugées avant même de vérifier concrètement si cela serait vraiment le cas.
Par ailleurs, il est très exceptionnel d’entendre un prêtre ou un fidèle catholique encourager une personne homosexuelle à se convertir à l’hétérosexualité ou à refouler ses penchants homosexuels « mauvais » et « transitoires ». Parmi les prêtres que nous sommes amenés à rencontrer (et qui se disent parfois ouvertement homosexuels, mais ces derniers sont plus rares que les media ne le croient), certains encouragent même à la conjugalité homosexuelle. La seule réaction négative qu’on peut parfois trouver n’est pas le rejet mais la déception ou la tristesse, surtout de la part de vieux prêtres peu à l’aise avec la question. Cette réaction s’explique en partie par le choc culturel ou générationnel : il n’est pas toujours facile pour certains clercs de s’adapter aux réalités d’un monde en mutation accélérée… En plus, ils ne voient pas beaucoup de jeunes croyants dans leurs églises occidentales. Quand ces derniers leur annoncent la bouche en cœur qu’ils sont homos, alors même que ces curés âgés les accueillaient avec un enthousiasme juvénile, d’un coup d’un seul, la baraque s’écroule à cause d’un petit mot, « homosexualité », qui leur évoque à la fois une réalité qu’ils ignoraient il y a encore cinquante ans de cela et qu’ils ne veulent pas, à juste titre, valider en tant qu’« identité profonde de l’individu », ou bien qui les renvoie directement à leur propre expérience – parfois vacillante – de la sexualité et aux curieux scandales de pédophilie qui secouent l’Église catholique (je dis « curieux » car en proportion, il y a très peu de prêtres pédophiles comparé d’une part à la population masculine dans sa majorité, et d’autre part à l’ensemble des prêtres qui fait aujourd’hui un travail admirable de par le monde et dont les media ne parlent jamais. Les religieux, par leur choix de vie particulier et leur expérience souvent heureuse de la chasteté et du célibat continent, rappellent à leur société ses propres frustrations et son enchaînement à la génitalité, … donc forcément, ils ne sont pas souvent appréciés à leur juste valeur).
Concernant plus particulièrement les textes évangéliques, il semble démesuré de dire qu’ils sont homophobes. Ils ne se réfèrent pas une seule fois à l’identité homosexuelle, aux personnes homosexuelles, ni à l’homosexualité – dans le sens où la société l’entend aujourd’hui, à savoir une union d’amour entre deux personnes adultes identitairement déterminées par leur orientation sexuelle –, mais uniquement à un certain désir et aux actes qu’il implique parfois ; et encore… La mention de ceux-ci est perdue dans une liste de pratiques répertoriées comme peccamineuses par saint Paul, dans le contexte très particulier des persécutions des premiers chrétiens. Les lignes traitant directement des actes sodomites dans un ouvrage aussi gigantesque que la Bible ne se comptent même pas sur les doigts d’une main. Il est donc erroné de croire que la Bible parle d’homosexualité. Les paroles de Jésus, d’ailleurs, n’en font jamais mention.
Beaucoup de personnes homosexuelles ne retiennent que les passages bibliques où les actes homosexuels sont lourdement condamnés. Mais elles délaissent ceux qui leur offrent des perspectives plus larges, car elles ont réellement le désir d’être maudites par le Ciel[4]. Manque de chance : la Bible n’est pas aussi dure avec elles qu’elles ne le voudraient. Dans sa lettre aux Éphésiens (3, 2-3), saint Paul révèle ce qu’il appelle « le mystère du Christ » : « Ce mystère, c’est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. » La Bible n’a jamais énoncé que toutes les personnes homosexuelles grilleraient en enfer, ni qu’elles seraient sauvées à la condition de revenir sur le droit chemin et d’arrêter d’être homosexuelles. Elle dit carrément qu’elles sont déjà les premières sur le chemin de la sainteté, puisque la sainteté est d’abord don de Dieu avant d’être une question d’actes et de mérites personnels : « En vérité je vous le dis, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au Royaume de Dieu »[5] déclare Jésus (J’aurais pu également vous citer Gen, 18, versets 20-32). Les prostituées évangéliques précèdent les justes dans le Royaume des Cieux, non parce qu’elles sont réellement exemplaires, mais parce qu’elles espèrent le Salut tout en sachant que leurs actes n’y donnent pas droit. Elles attendent avec plus de foi la miséricorde reçue de Dieu que de bons croyants pétris de certitudes, qui n’espèrent rien de Lui, et qui se font auteurs de leur propre rédemption. Dans la Bible, il est marqué noir sur blanc que Dieu ne choisit pas des gens parfaits pour annoncer son Royaume, mais des fous. Je crois personnellement que ce sont elles, les « folles », qu’Il élit pour le révéler. « Ce qui est folie dans le monde, Dieu l’a choisi pour confondre les sages. »[6]Toute personne homosexuelle est donc, selon les Saintes Écritures, élue par Dieu pour l’annoncer, au même titre que tous les Hommes. À entendre le discours biblique, il n’y a donc aucune incompatibilité entre sainteté et homosexualité !
De même pour le discours officiel de l’Église catholique, je ne pense pas que la présomption d’homophobie pesant sur la Curie romaine soit valide. Le Pape Jean-Paul II est considéré par certains militants gay comme « l’une des voix les plus clairement homophobes de notre temps »[7], alors qu’il n’a jamais prononcé une seule fois le mot « homosexualité » de son vivant, ni condamné les personnes homosexuelles. Trois petits articles du Catéchisme de l’Église Catholique de 1997[8] abordent le sujet directement, en des termes certes explicites mais qui ne se dirigent pas contre les personnes homosexuelles, et encore moins contre « les homosexuels », mais simplement contre les actes homosexuels.
L’Église catholique n’a jamais dit que les personnes homosexuelles étaient pécheresses du fait d’être homosexuelles. Au contraire, Elle est désireuse d’accueillir les personnes qui se disent « homosexuelles », en prenant soin de dissocier les actes des individus qui les posent, ou bien les individus de leurs désirs de surface. Selon Elle, la parole graciante de Dieu reçue dans la foi justifie le pécheur, jamais le péché. Il ne peut pas y avoir d’état de péché de l’homosexualité pour la bonne et simple raison que le péché réclame la liberté et que les personnes homosexuelles n’ont pas choisi d’être homos. Nous ne pouvons pécher qu’en actes et en désir ; pas en tant que personne humaine, étant donné que l’Humanité a été rachetée en Jésus. Toute la difficulté est dans cette distinction apparemment limpide entre être et faire. À une époque où les media nous invitent à définir l’individu par ses actes – surtout génitaux – et ses désirs violemment actualisés, il apparaît en effet complètement hypocrite de faire la distinction entre les actes homosexuels et la personne homosexuelle. Mais en réalité, c’est le fait d’opérer l’amalgame entre l’être et le faire qui enferme l’individu, et non la distinction entre les deux. Démêler l’être et le faire, c’est reconnaître l’existence de notre liberté, nous sauver du déni et de la diabolisation de nous-mêmes. Certes, nous sommes toujours un peu le reflet de nos actes dont nous avons à porter la responsabilité. Mais aux yeux de l’amour et de la foi, un Homme reste toujours plus grand que les actes qu’il a commis, si graves et honteux soient-ils. Pour l’Église catholique, ce qui compte d’abord, ce sont les personnes. Il me semble qu’Elle a tout à fait raison de dissocier la pratique sexuelle de l’identité sexuelle : c’est son entêtement à marquer la frontière qui crée le lien entre foi et homosexualité, qui dit que les personnes homosexuelles ont tout à fait leur place dans l’Église en tant qu’Hommes habités par un désir homosexuel réel et reconnu comme tel, et non simplement en tant qu’Hommes comme les autres ou en tant qu’« homosexuels ». Les personnes homosexuelles ne sont pas comme les autres, et l’Église ne tient absolument pas à ce qu’elles changent foncièrement. Elle souhaite simplement qu’elles mettent leur identité la plus profonde, celle d’Enfants de Dieu, avant leur identité secondaire de personnes homosexuelles.
Par ailleurs, à travers tous les motifs iconographiques mis en exergue dans mon livre pour montrer que le désir homosexuel est davantage un désir déstructurant qu’un désir humanisant[9], il nous est possible de mesurer l’intelligence et l’étonnante modernité du message ecclésial sur l’homosexualité. L’Église catholique a tout à fait raison de reconnaître le couple homosexuel comme une réalité fantasmée plutôt que comme une réalité positive à promouvoir universellement. Quand le Pape Benoît XVI énonce que les actes homosexuels sont « intrinsèquement désordonnés », j’abonde dans son sens. L’inclinaison homosexuelle tend en effet vers des comportements par nature unifiants-dispersants. C’est son essence. Il a osé le dire, ce qui est courageux de sa part.
Nous pourrions penser que le conflit entre la communauté homosexuelle et l’Église s’origine sur une accumulation complexe de débats concernant une infinité de sujets (et surtout ceux qui ne se rapportent qu’aux points de morale sexuelle : virginité avant le mariage, contraception, célibat des prêtres, ordination des femmes, préservatif, avortement, etc.). En réalité, c’est plus simple que cela. Il n’y a qu’un seul point doctrinal créant le litige entre la communauté homosexuelle et l’Église catholique : il s’agit de la divergence de compréhension du péché originel[10], et plus radicalement de la foi – ou le manque de foi – en la primauté du Bien sur le mal, en l’originalité-finalité radicale de Dieu. Pour l’Église catholique, le péché est postérieur à la création de l’Homme – il est secondaire et non-essentiel à l’être humain puisque Dieu, l’alpha et l’oméga de l’existence du monde, l’a vaincu –, alors que pour la grande majorité des personnes homosexuelles, il est antérieur et donc essentiel à l’Homme. Comme le souligne à juste raison Flora Leroy-Forgeot à propos du désir homosexuel, « la dualité entre inné et acquis ainsi qu’entre primaire et secondaire est sous-tendue par la référence culturelle au péché originel : pour l’Église, le bien est primaire et le mal est secondaire. »[11] En posant l’existence de Dieu et du Désir avant l’existence de l’Homme et de ses désirs humains mi-bons mi-mauvais, l’Église catholique affirme que le désir homosexuel n’est ni totalement inné ni totalement acquis – il est peut-être les deux –, mais en plus, qu’il n’est pas le désir profond qui a aimé l’Homme en premier, à savoir le Désir divin, ce qui ne manque pas de gêner la communauté homosexuelle qui voudrait diviniser le désir homosexuel et l’Homme qui le ressent pour les rendre totalement innés/auto-créés ou totalement acquis/objets, complètement bons ou complètement mauvais. L’Église catholique ne veut pas d’une part confondre l’Homme avec ses désirs de surface, ni d’autre part le considérer comme un fétiche. Elle souhaite au contraire lui reconnaître son identité profonde d’Enfant de Dieu, et insister sur le fait que le Bien est plus fort que le mal et que les désirs duels, chose qui paraît inconcevable à beaucoup de personnes homosexuelles qui pensent que le péché originel a séparé à jamais l’Homme de Dieu, et a fait de l’être humain un dieu tout-puissant divisé et un diable. La majorité des personnes homosexuelles postulent que le mal est premier et le Bien est second – ou, ce qui revient presque au même, qu’ils sont deux forces équivalentes s’annulant l’une l’autre[12] –, contrairement à l’Église qui place Dieu aux extrémités de l’existence humaine et qui ne parle pas du désir homosexuel en termes de mal ou de Bien, mais de désir secondaire par rapport au grand Désir qui a habité l’Homme en premier et qui, si l’être humain l’accepte, le consumera éternellement à la fin des temps. Là où l’Église dit qu’à l’origine est le Verbe de Dieu, c’est-à-dire la Parole de vie, la communauté homosexuelle réplique, comme Didier Éribon dans Réflexions sur la Question gay, qu’« au commencement il y a l’injure ». Seul le regard sur l’origine de la vie change.
Généralement, les personnes homosexuelles ne font que dresser sur le véritable visage de l’Église la toile de leurs propres fantasmes. Pour se venger de celle qu’elles ne connaissent que de loin ou trop mal, elles en constituent des clichés à la sauce libertine. Nous voyons toujours dans leurs fictions les mêmes personnages : les nonnes violées, les prêtres pervers ou rétrogrades, les gamins pissant dans les bénitiers, les femmes bigotes, leurs maris frustrés et angoissés, les croyants fondamentalistes illuminés, les papes homos, les Christs transsexuels, etc.. Ces portraits se veulent ultra-corrosifs et inédits, alors qu’en réalité, elles seules, avec la petite nébuleuse des catholiques intégristes dont elles pourraient gonfler (ou gonflent) sensiblement le nombre, arrivent encore à les trouver réalistes et à s’en offusquer. Nous les entendons figer l’Église à une époque virtuelle (médiévale… ou carrément futuriste, avec un Dieu-businessman !) par des abus de langage complètement caricaturaux et des anachronismes qui seraient risibles s’ils traduisaient une provocation lucide/utile. Seulement, les guerres de religion, les commandos anti-IVG, l’Inquisition, la colonisation sauvage, la misogynie de certains clercs, la collaboration aux régimes fascistes, le massacre de la Saint Barthélemy, le silence sur les camps de concentration, la période d’appât du gain et du pouvoir de l’Église-institution, l’interdiction absurde de certains ecclésiastiques sur le préservatif, les violations de la dignité humaine au nom de l’annonce de l’Évangile, les scandales au sujet des prêtres pédophiles (dont on entend énormément parler en ce moment), l’insupportable et racoleuse « papemania » JMJiste, la condamnation religieuse « des homos », certaines missives assassines de Tony Anatrella, le christianisme stigmatisant les plaisirs corporels, ne sont que des détournements de l’Église, qui ne disent rien de l’Église elle-même.
Seules certaines personnes homosexuelles, aux côtés de la poignée de croyants (méritent-ils de s’appeler « catholiques » ?) intolérants voulant envoyer la communauté homosexuelle en enfer à cause de leur interprétation littérale de la Bible, construisent la mystique catholique homophobe. En effet, qui, je vous le demande, se focalise sur le lien entre homosexualité et péché, avant d’attribuer leurs propos mensongers à l’Église réelle, sinon elles ?[13] L’Église catholique ne considère pas le péché comme originel – pour elle, seul l’amour est originel ! – ni comme proprement homosexuel. De même, jamais l’Église catholique n’a fait l’association du Sida à une punition divine, à un châtiment de Dieu bien mérité, comme cela est par exemple montré dans le documentaire « L’Homophobie, ce douloureux problème » (2000) de Lionel Bernard. Il n’y a que les sectes millénaristes et certains membres de la communauté homosexuelle qui ont transformé la maladie en matraque céleste destinée spécifiquement aux personnes homosexuelles.
Actuellement, la confusion qu’opèrent beaucoup d’individus homosexuels entre l’Église catholique et les sectes « chrétiennes » de souche protestante (ou catholique intégriste), particulièrement prolifiques aux États-Unis et dans le reste du monde, relève d’une profonde méconnaissance de la réalité religieuse actuelle[14]. Dans leurs films, un certain nombre de réalisateurs homosexuels tracent le portrait de membres complètement illuminés de ces protestantismes frelatés, cultivant ainsi les amalgames les plus caricaturaux dans l’esprit des spectateurs européens non-avertis qui, en mettant toutes les religions dans le même panier, sont tentés de les confondre avec les croyants catholiques. Les groupes Exodus, Homosexual Anonymous, Ex gay, Focus on the family, l’association mormone Evergreen, apparus aux États-Unis dans les années 1970, avec leurs télévangélistes, leurs grandes messes émotionnelles, et leurs thérapies collectives pour « soigner les homos », n’ont rien à voir avec l’Église catholique ni l’Église protestante traditionnelle. Quant aux associations homosexuelles chrétiennes actuelles en France – Devenir Un en Christ, David et Jonathan –, elles ne sont pas des associations d’Église, c’est-à-dire commanditées par le Vatican, mais simplement des confédérations créées à côté de lui pour bien souvent le contester. Quand on sait en plus qu’actuellement, elles ont tendance à se diriger massivement vers l’agnosticisme et le protestantisme, nous comprenons très vite qu’elles ne méritent même pas le titre d’« associations homosexuelles catholiques ».
Au lieu de se désintéresser de l’Église, beaucoup de personnes homosexuelles sont obsédées par elle, ou plutôt par l’image diabolisée ou sacralisée qu’elles s’en font et qu’elles cherchent à incarner. Comme elles ne veulent pas s’attacher à une institution ecclésiale en particulier, elles se plient à un fondamentalisme athée – elles disent « humaniste » –, à une religion qui n’est pas encore clairement cataloguée socialement comme telle, mais qu’elles pensent être la seule juste. Nous pourrions la baptiser comme on veut : « Home-made Gay Religion », ou bien « Culte de l’Être suprême (= l’androgyne) », « Spiritualités plurielles et cosmiques », « Religion désincarnée », « Individualisme hédoniste et universaliste », « Secte des Cultures homosexuelles », « Gay Church », etc. Elles sont assez portées sur l’ésotérisme, les spiritualités de supermarché, la religion à la carte. Ce qui les attire dans la foi, c’est en général l’émotionnel collectif, la sensiblerie, la superstition, la magie, le spectaculaire, la sensation de bien-être, le refuge contre les épreuves de la vie, le recentrement sur soi… bref, tout ce que la foi authentique n’est pas mais qu’elles prennent pour la foi réelle et qu’elles attribuent aux « mauvais croyants » (parce que le pire, c’est que beaucoup d’entre elles se prennent pour les seuls bons croyants !). Leur fascination pour la religiosité-loisir, l’occultisme, le paranormal, les bondieuseries, les miracles, les philosophies New Age, les messes noires, etc., est connue[15]. Le plus sérieusement du monde, elles composent une parodie ecclésiale censée faire contrepoids à la réalité religieuse qu’elles ne connaissent pas – ou de trop près –, et qu’elles ont diabolisée à force de l’idéaliser. Loin de parler de rejet par rapport à l’Église catholique, on pourrait dire qu’il s’agit plutôt d’une adoration inversée. Beaucoup de personnes homosexuelles construisent une version transversale de la religion pour se convaincre ensuite que la caricature nouvellement créée est fidèle à la vraie religion, et pour rejeter ouvertement devant les autres et la vraie religion et sa caricature… comme cela, elles se gargarisent de faire d’une pierre deux coups.
Cette passion inavouée pour l’« Ennemi catholique » se traduit en général chez elles par une imitation inconsciente et volontaire des caricatures qu’elles se sont faites de lui. Elles adoptent souvent de l’Église une version kitsch en ne choisissant de portraiturer que des grenouilles de bénitiers frustrées et superstitieuses auxquelles elles s’identifient, parce que ces grenouilles, ce sont partiellement elles quand elles obéissent à leur désir homosexuel : la bourgeoise-prostituée pénétrant dans une église après s’être fait violée est une icône gay classique[16]. Elles reprennent dans leurs écrits les thèses libertines traditionnelles – telles que l’union homosexuelle de Jésus et de saint Jean, la liaison entre Marie-Madeleine et Jésus, l’amitié biblique entre David et Jonathan, ou entre Ruth et Noémie, l’homosexualité de saint Paul, etc. –, utilisent abondamment les symboles christiques, fondent des congrégations – notamment les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence –, suivent fidèlement le Pape dans tous ses déplacements (l’Europride à Paris en 1997 juste après les Journées Mondiales de la Jeunesse ; la première Worldpride à Rome, toujours après les JMJ de Rome en 2000 ; la Worldpride de Jérusalem en 2005 ; la présence d’un groupe de militants homosexuels aux JMJ de Cologne en 2005 ; etc.), font de leurs rassemblements ou de leurs concerts de grandes messes-show. Elles réemploient (sans s’en rendre compte ?) le langage étiqueté religieux de leurs supposés ennemis, pour le détourner à leurs fins (on peut entendre des sujets transgenres dire avec une conviction grave qu’il nous faut « suivre le Droit Chemin de l’homosexualité »[17]). Elles ne font que reproduire ce qu’elles jugent aliénant chez les croyants pratiquants. La preuve qu’elles sont dans la projection par rapport au clergé, c’est qu’elles pensent que tous les prêtres catholiques sont des personnes homosexuelles refoulées[18]. Nous les entendons parfois dire avec assurance que 30 % des prêtres seraient « de la jaquette »[19]. Cette légende sur l’homosexualité refoulée des prêtres[20], parfois actualisée chez les ennemis des personnes homosexuelles ou chez leurs adorateurs, n’est majoritairement effective que sur les écrans, même si elle est relayée par les quelques figures cléricales médiatiques qui ont fait des coming out tapageurs (Salvador Guasch, José Montero, Jacques Perotti, Franco Barbero, Jacques Laval, Michel Bellin, Antonio Roig, Ernesto Jiménez, etc.)et qui se présentent comme les prophètes d’une nouvelle Église, plus « ouverte » et plus « tolérante » que l’Église de Rome[21]. Visiblement, beaucoup de personnes homosexuelles se sont confondues avec la caricature d’Église qu’elles ont créée…
Maintenant, concernant l’Église catholique – qui reste une masse humaine très hétéroclite, je le rappelle –, il faut reconnaître qu’il Lui reste aussi beaucoup de chemin à parcourir sur la question de l’homosexualité (… c’est peu de le dire !). Des penseurs catholiques comme Véronique Margron, Xavier Thévenot, Xavier Lacroix, ont fait énormément avancer la réflexion chrétienne sur le désir homosexuel par leurs écrits et leur douceur. N’en déplaisent à leurs détracteurs qui ne les ont même pas écoutés du simple fait qu’ils sont catholiques ou ecclésiastiques, ces intellectuels sont d’une ouverture étonnante[22]. Mais il reste des exceptions malheureusement.
Il ne faut cependant pas trop vite condamner les croyants catholiques. Je crois que leur fermeture et leur méfiance viennent plus d’une ignorance peureuse (qui repose parfois sur une croyance homophobe selon laquelle la connaissance de l’homosexualité n’appartiendrait qu’aux seuls « homosexuels ») que d’une fermeture ou d’une mauvaise volonté. Il faut reconnaître que la définition du désir homosexuel est objectivement difficile à faire (y compris la communauté homosexuelle la fuit ou l’empêche), car il ne s’agit ni d’un désir mauvais ni d’un désir pour autant idéal… donc avec ça, on a plutôt intérêt à tourner plusieurs fois la langue dans notre bouche avant d’en parler ! Personnellement, il m’aura fallu 6 ans pour définir ma gêne concernant l’homosexualité… alors je comprends aisément qu’une personne néophyte ou peu plongée dans la culture homosexuelle se sente démunie pour se positionner rapidement sur la thématique du désir homosexuel. Pour autant, je constate sur le terrain, étant moi-même une personne homosexuelle catholique-pratiquante, une frilosité et un retard considérable d’une grande partie de la population catholique, y compris de personnes éclairées et vivant dans des pays occidentaux. Il est, à mon avis, désolant d’entendre encore de la bouche de la majorité des personnes catholiques des arguments aussi simplistes que : « L’homosexualité, ce n’est pas dans le projet de Dieu car c’est dit dans la Bible. » ; «L’homosexualité n’est pas normale et le couple homosexuel rejète fondamentalement l’altérité. » ; « Dieu a créé l’homme ET la femme. Ce n’est pas par hasard. » Plus inaudibles encore sont les formules compassionnelles du genre : « L’Église, à la suite du Christ, nous apprend à toujours haïr le péché, mais à aimer les pécheurs. »J’ai l’impression qu’on est restés encore à l’âge de pierre quand j’entends ce type de discours. Intellectuellement, je les comprends, et parfois je pourrais les justifier. Mais je trouve qu’ils sont dénués de réflexion sur le désir homosexuel, sur les liens entre désir homosexuel et désir hétérosexuel, sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et viol. Ce sont des arguments formulés par des individus qui se planquent derrière la Bible, derrière de beaux principes (la différence des sexes, l’accueil du pécheur, la guérison, etc.), pour ne considérer ni les personnes ni les drames qu’elles ont pu vivre. À propos de l’homosexualité, c’est comme si l’Église catholique arrivait au bon résultat par un mauvais chemin, un raisonnement bancal (… donc finalement, on n’est plus vraiment sûr de la justesse du résultat). Globalement, je trouve qu’Elle n’a pas encore trouvé ses mots pour parler d’homosexualité[23]. Par exemple, on ne sait pas ce qu’elle met derrière le terme flou et fourre-tout d’« actes homosexuels » (Pour moi, il n’y a pas qu’une seule manière de vivre son homosexualité ; tous les « actes homosexuels » ne sont pas mauvais : cela dépend de notre manière de vivre notre désir homosexuel, et celui-ci ne se vit pas qu’en termes génitaux ou violents). Autre exemple d’imprécision lexicale : l’Église fait trop souvent la grossière erreur d’employer le terme « hétérosexuel » comme synonyme de l’amour femme/homme alors qu’à la base, l’hétérosexualité est historiquement une défense de la bisexualité voire de l’homosexualité (Rappelons-le, le désir homosexuel et le désir hétérosexuel sont jumeaux ; et les couples hétérosexuels sont l’inverse des « couples femme/homme aimants »[24]) Et que dire des dérapages du Père Tony Anatrella, qui a pourtant beaucoup de mots justes, mais qui fait l’erreur de transformer l’amour homosexuel en parfaite antithèse de l’amour femme-homme en sacralisant la différence des sexes (« L’amour conjugal est le propre d’un couple formé entre un homme et une femme. L’attachement homosexuel est aux antipodes de ce type d’amour qui implique d’être dans l’altérité sexuelle. »[25]) ? … alors que chacun sait que d’une part il ne suffit pas que la différence des sexes soit là pour qu’elle soit respectée (bien des couples homosexuels s’aiment d’un amour plus fort que des couples composés d’une femme et d’un homme), et d’autre part que la différence entre couple homo et « couple femme/homme aimant » (je n’ai pas dit « hétérosexuel ») ne se dit pas en termes manichéens de « mal » et de « bien » mais se joue plutôt entre le « bien » et le « meilleur » (le bien ou le convenable – et quelques rares couples homosexuels de notre entourage sont « bien et convenables » – ne se convertit pas en « mauvais », en « laid » au contact du meilleur… même si la préférence pour le « meilleur », encouragée par l’éthique et la morale, hiérarchise forcément.)
Oui, parfois, j’ai mal à mon Église. Si imparfaitement humaine. Celle qui est formée des premiers pécheurs. Celle qui me suspecte parfois de « prosélytisme » ou de « relativisme » uniquement parce que j’évoque l’homosexualité sans la défendre. Celle qui ne parle que très rarement de nous, les « hommes homosexuels »… sauf pour nous dire qu’Elle nous accueille à la condition que nous changions, que nous nous taisions, que nous guérissions. J’aimerais que certains paroissiens que je connais n’aient pas peur d’appeler un chat « un chat », que par exemple ils ne remplacent pas la mention des personnes homosexuelles dans les intentions de prière universelle par des phrases passe-partout où la minorité homosexuelle a du mal à s’identifier (« Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Apporte-leur ta lumière… »).
J’aime mon Église. Je l’aime à tel point que je comprends même qu’Elle se méfie du désir homosexuel, de son essentialisation sous forme d’« identité homosexuelle éternelle » ou d’« amour équivalent à l’amour femme/homme aimants ou à l’amour homme/Dieu ». Je comprends par exemple, non qu’Elle refuse, mais bien qu’Elle soit prudente concernant l’accueil des personnes homosexuelles dans les séminaires[26] (moi-même, je suis réticent à ce qu’une personne ayant une structure homosexuelle relativement fixe s’engage dans la prêtrise : pour qu’un homme soit un bon prêtre, bien dans ses baskets, il doit être suffisamment réconcilié avec son corps, son passé, avec les autres… et le désir homosexuel témoigne davantage d’un déséquilibre, d’une fermeture à la différence et au monde que d’une ouverture, en effet. Le désir homosexuel est le signe d’une blessure/fragilité qu’il convient de reconnaître, tout en privilégiant le cas par cas). Par ailleurs, je comprends que l’Église qualifie certains actes homosexuels d’« intrinsèquement désordonnés » (j’ai moi-même étudié dans mon livre la notion de désordre dans les œuvres homosexuelles et dans la vie des personnes homosexuelles). Et je cautionne l’appel ecclésial lancé aux personnes homosexuelles à la continence et à l’abstinence sexuelle (un appel pourtant scandaleux aux oreilles de beaucoup de personnes homosexuelles). Et c’est parce que j’aime mon Église, que je partage sa gêne concernant le désir homosexuel et que je La veux en voie de sanctification, que j’accepte encore moins l’idée qu’Elle puisse avoir raison sans savoir encore pourquoi, sans trouver les mots justes. Elle ne peut pas se permettre d’être peureuse face aux personnes homosexuelles. Elle ne peut pas fuir constamment le sujet et les individus homosexuels sous des prétextes fallacieux.
Je reprendrais pour finir les mots du jeune prêtre de 31 ans Pierre-Hervé Grosjean (un prêtre versaillais, pourtant… personne n’est parfait…^^) qui, lors d’une conférence sur l’affectivité en décembre 2006 à Saint Augustin à Paris, avait répondu à des questions tirées au chapeau… et il était tombé sur mon papier où j’avais écrit ce mot provocateur : « Est-ce qu’on peut trouver l’amour même quand on est homosexuel ? ». Il avait répondu de manière très juste à la question (je ne développerai pas ici sa réponse : autant lui demander directement), puis avait fortement encouragé l’assistance de jeunes petits bourgeois cathos (pas si « coincés » que ça…) à faire venir les personnes homosexuelles dans les églises : « Mais amenez-les-nous ! Invitez-les ! Si vous connaissez des personnes homosexuelles dans votre entourage, amenez-les-nous ! ». J’avais adoré. Moi, je n’attends qu’une chose : c’est qu’on nous invite, en effet ! J’attends toujours le carton d’invitation…
[1] Marguerite Radclyffe Hall, Le Puits de Solitude, Éd. Gallimard, Paris, 1928, p. 589.
[2] Pour ceux qui veulent aller vérifier, les seuls passages qui traitent de ces actes « homosexuels » sont Gn 19, 4-11 ; Lv 18, 22, 20, 13, et Jg 19, 22-30 ; 1 Sam 18-20 ; Rm 1, 26 ; 1 Cor 6, 9 ; et 1 Tm 1, 10.
[3] Joseph Card. Ratzinger, Déclaration Persona Humana sur certaines questions d’éthique sexuelle, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 29 décembre 1975, n. 8.
[4] * Voir également la partie « Je suis maudit » de homosexualité noire et glorieuse et se prendre pour le diable dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[5] Mt 21, 31.
[6] Paul, 1 Cor. 1, 27.
[7] Pierre Albertini, « France », dans Louis-Georges Tin, Dictionnaire de l’Homophobie, Éd. PUF, Paris, 2003, p. 184.
[8] Jean-Paul II, Lettre apostolique Laetamur Magnopere : 15 août 1997, La Documentation Catholique 94, 1997.
[9] * Voir également désir désordonné dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[10] * Voir également la partie « péché ‘originel’ » de innocence dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[11] Flora Leroy-Forgeot, « Décadence », dans Louis-Georges Tin, Dictionnaire de l’Homophobie, op. cit., p. 121.
[12] Je vous renvoie aux pages sur le manichéisme dans le chapitre II de mon livre Homosexualité sociale. * Voir également se prendre pour le diable et focalisation sur le péché dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[13] Michel Dorais, Mort ou Fif, VLB éditeur, Québec, 2001, p. 75.
[14] * Voir également la partie « églises ‘protestantes’ » de attraction pour la « foi » dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[15] * Voir également attraction pour la « foi » dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[16] * Voir également la partie « bourgeoise-prostituée dans une église » de bourgeoise dans le Dictionnaire des codes homosexuels.
[17] C. f. la phrase de conclusion de l’exposé de l’homme transsexuel Natacha aux Journées Annuelles de Réflexion (JAR) de l’association David et Jonathan au Mont Dore, en 2004.
[18] Je ne suis pas en train de dire que cette légende est totalement infondée : il n’y a pas de cliché sans feu, et j’ai été amené à rencontrer quelquefois dans le « milieu homosexuel » des personnes homos qui exerçaient le métier de prêtre ou de diacre. Comme le dit Thévenot, « Il n’est pas rare, quoique cela ne soit pas systématique (comme on l’a parfois affirmé), que l’homosexualité soit une des composantes de la prêtrise. » (Xavier Thévenot, Homosexualités masculines et morale chrétienne, Éd. du Cerf, Paris, 1985, p. 181)
[19] * Voir également curés gay dans le Dictionnaire des codes homosexuels. L’idée des prêtres gay ou du séminaire comme « repaire d’homosexuels » était déjà un des arguments avancés par les nazis pour persécuter les personnes homosexuelles : « J’estime qu’il y a dans les couvents 90 ou 95 ou 100 % d’homosexuels. (…) Nous prouverons que l’Église, tant au niveau de ses dirigeants que de ses prêtres, constitue dans sa majeure partie une association érotiques d’hommes, qui terrorise l’humanité depuis mille huit cents ans. » (Heinrich Himmler, discours du 18 février 1937, cité dans Jean Boisson, Le Triangle rose, Éd. Robert Laffont, Paris, 1988, p. 73)
[20] En plus de cela, l’homosexualisation systématique des prêtres dénote d’une certaine homophobie, y compris chez les apparents défenseurs gay friendly de la cause homosexuelle (amalgame entre homosexualité et pédophilie par exemple, ou bien association, chez les personnes qui ne voient dans le prêtre qu’un homme intolérant et mal dans sa peau, entre homosexualité et frustration, homosexualité et vice).
[21] On entend souvent de leur part l’idée selon laquelle Dieu les aurait voulu/créé homosexuels, qu’Il leur aurait donné leur petit copain, et qu’Il bénirait quand même leur union quoi qu’en dise l’Église officielle « poussiéreuse » de Rome. Autrement dit, ils font parler Dieu à sa place.
[22] Pour ne prendre qu’un seul exemple éloquent, je citerai le théologien moraliste catholique Xavier Lacroix qui non seulement défend un large accueil des personnes homosexuelles, mais qui va jusqu’à conseiller parfois le couple homosexuel, comme en témoigne l’extrait d’un mail qu’il m’a adressé personnellement le 4 juillet 2007 : « Pourquoi désespérer d’un amour avec un homme ? Et s’il y a des passages sexuels dans la relation, qui pourraient ensuite être dépassés ou sublimés, serait-ce une catastrophe ? Comparer les biens en présence. Vous êtes bien averti des écueils et des limites d’une fascination par l’érotisme. Mais le passage par une expression charnelle de la tendresse vous est-il vraiment interdit ? Toutes les amours homosexuelles ont-elles l’aboutissement négatif que vous semblez évoquer ? C’est possible, je pose seulement la question. Vous êtes mieux placé que moi pour y répondre. » Lacroix se fait pourtant sabrer lors des émissions de télévision où il passe… mais beaucoup se leurrent totalement à son sujet.
[23] C’est d’ailleurs pour cela que dans mon livre, j’ai mis un point d’honneur à justifier ma gêne concernant le désir homosexuel autrement que par des arguments religieux. Je voulais être le plus humain, le plus terrestre, le plus cartésien, le plus homosexuel possible – c’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai fait que citer les personnes homosexuelles elles-mêmes !. Je voulais donner des mots nouveaux à mon Église. L’aider à être plus « dans le monde ».
[24] Plutôt que de désigner une norme sexuelle universelle, le mot « hétérosexualité » venait initialement défendre une sexualité non-normative et dissidente, une bisexualité naturelle, un « troisième sexe » posé comme « normal ». Jonathan Katz, dans son essai L’Invention de l’hétérosexualité (2001), nous montre qu’au départ, l’hétérosexualité était classée au rang des perversions au même titre que l’homosexualité : « En dépit de ce qui nous a été dit, l’hétérosexualité n’était pas synonyme de relation à visée reproductrice. Elle n’était pas, non plus, assimilable à la différence sexuelle et à la distinction de genre, pas plus qu’elle n’étaye l’équivalent de l’érotisme entre hommes et femmes. » Elle pouvait aussi bien qualifier une attirance pour les deux sexes qu’une pratique érotique (masturbation, sodomie, bestialité, adultère, etc.) excluant la procréation, le mariage, et la famille. Le terme « hétérosexuel » a été créé sous l’impulsion d’hommes et de femmes libertaires de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe et du XVIIIe siècles, partisans de l’« amour vrai et libre », soucieux de justifier scientifiquement un érotisme en deçà du rapport sexuel et extérieur à toute institution d’État ou d’Église. « L’hétérosexuel » ne rentrait pas dans le cadre de la sexualité dite « normale » étant donné qu’il était jugé coupable d’ambiguïté. « On attribuait à ces hétérosexuels une disposition mentale appelée ‘hermaphrodisme psychique’. Les hétérosexuels éprouvaient une prétendue attirance érotique masculine pour les femmes et féminine pour les hommes. Ils ressentaient périodiquement du désir pour les deux sexes. » Que ce soit les mots « hétérosexuel » (synonyme à l’époque de ce qu’on appelle aujourd’hui « un bisexuel » », et qui était en 1892 un homme attiré par les deux sexes) ou « homosexuel » (personne qui devient après 1892 un individu attiré exclusivement par les individus de même sexe que lui), ils étaient tous les deux les expressions d’une absence de désir de se tourner exclusivement vers les membres du sexe opposé … donc bien loin de ce que nous assignons actuellement, surtout au premier ! Par la suite, le théoricien Krafft-Ebing a interprété le terme « hétérosexuel » à travers la grille de la différence sexuelle des partenaires. Il en détourna le sens initial pour le rendre synonyme de « sexualité normale entre un homme et une femme » et l’opposer à « homosexuel », même si paradoxalement, dans sa Psychopathia Sexualis (1886), le « Manifeste de l’hétérosexualité » pourrait-on dire, le terme « hétérosexuel » continua de signifier « instinct sexuel contraire », « hermaphrodisme psychique », « homosexualité » et « fétichisme ».
[25] Tony Anatrella, Documents Épiscopat, Éd. Secrétariat Général de la Conférence des évêques de France, Colombes, 2004, p. 12.
[26] Je vous renvoie au texte du Vatican, écrit par le Saint-Siège en 2002, dans lequel le cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, présidée par le cardinal Joseph Ratzinger (l’actuel pape Benoît XVI), avait déclaré que « les personnes ayant une inclination homosexuelle ne devraient pas être admises au séminaire ». Cette décision avait fait parler d’elle en 2005.