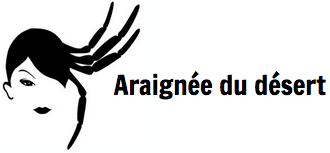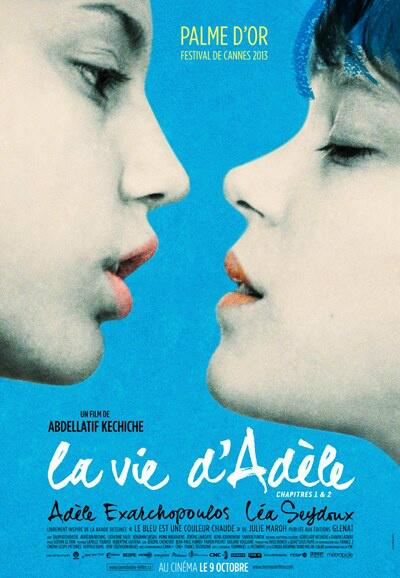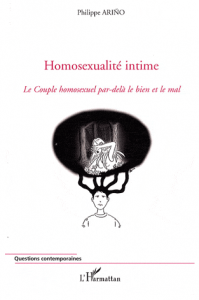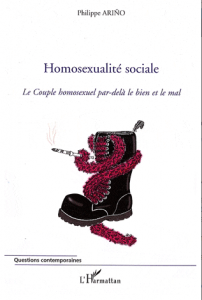Décryptage symbolique du film « La Vie (narcissique) d’Adèle »
LE FILM « LA VIE D’ADÈLE », PASSÉ AU CRIBLE DU « DICTIONNAIRE DES CODES HOMOS »
Plutôt que de blablater sans fin sur la valeur de « La Vie d’Adèle », le 5ème film d’Abdelatif Kechiche qui a reçu en mai dernier la Palme d’or au Festival de Cannes et qui est sorti hier au cinéma en France, plutôt que de jouer les offusqués d’un tel scandale (car OUI c’est une honte qu’une « palmette » bobo d’aussi mauvaise qualité et avec un message aussi pauvre soit applaudie, OUI c’est très inquiétant qu’une « œuvre de crise » comme celle-là, où le viol et la maltraitance sont à tous les étages – y compris lors du tournage et pour les actrices qui avouent « s’être senties filmées comme des prostituées » – soit encouragée), plutôt que de rentrer dans le concert stérile des opinions de goûts « Méritée/Pas méritée/J’ai aimé/J’ai pas aimé/Ça m’a choqué/Ça ne m’a pas choqué » qui fait écran à l’analyse et qui finalement donne raison à la démarche narcissique et puérile de beaucoup de nos cinéastes pseudo « sulfureux et avant-gardistes » actuels (pour eux, en effet, ce qui compte n’est pas la qualité d’un film mais juste qu’on « en parle » ; ce n’est pas l’œuvre en elle-même mais ce qu’elle symbolise et comment elle est reçue ; ce n’est pas l’action mais ses « bonnes » et ses « mauvaises » intentions), je me suis dit qu’il serait plus constructif de passer directement à la phase de la description. Ben voui. Avant de dire « J’ai détesté » ou « J’ai adoré » ou « J’ai ressenti », c’est vraiment tellement plus intéressant de se demander « Qu’est-ce que j’ai vu et qu’est-ce que ça signifie ? ». Et même avec une daube comme « La Vie d’Adèle », il y a énormément de choses à voir, à analyser, au-delà de la qualité et des intentions de l’auteur et des comédiens (il suffit de les écouter pour comprendre qu’ils n’ont rien à dire et qu’ils n’ont pas compris ce qu’ils ont fait). On va maintenant les aider, non pas à dire que leur création est géniale parce qu’elle est truffée de symboles, mais juste qu’elle est signifiante et non-libre/non-libérante de regorger précisément d’autant d’inconscient !
Je vais dresser froidement la liste de ce que j’ai vu hier lors de la projection de « La Vie (narcissique) d’Adèle » (comme je l’appelle ironiquement), en passant le film au tamis de mon Dictionnaire des Codes homosexuels, pour vous montrer combien même la merde a sa logique, combien le retour du refoulé humain a sa lisibilité et sa part de génie, combien ma grille d’analyse est géniale (car je doute que l’égocentrique et imbuvable Abdelatif Kechiche ait pris connaissance de mes écrits et ait décidé de plein gré de coller aussi précisément aux codes symboliques de mon Dictionnaire).
Code « Eau » ou « Amant narcissique » ou « Miroir » ou « Fusion » :
– Tout le film est mis sous le signe de la couleur bleue et de l’eau (Adèle à la mer et qui fait la planche, Adèle sous la douche, les cheveux bleus d’Emma, les vêtements bleus, etc.).
– Pendant 3 heures de film, on n’a quasiment que des gros plans très resserrés sur les visages… quand ce ne sont pas des plans carrément flous d’être trop proches, ni des scènes filmées en caméra subjective (avec les tremblements qui vont avec, et qui font « trop naturalistes »). Il n’y a pas d’espace : ni entre les personnages (qui passent leur temps à s’embrasser), ni entre le réalisateur et ce/ceux qu’il filme. Cela montre bien que « La Vie d’Adèle », même dans sa forme, est un film égocentrique, narcissique, fusionnel et oppressant.
– Adèle se masturbe.
– L’importance des miroirs dans le film.
– « J’adore la couleur bleue ! » (une amie bobo beaux-ardeuse d’Emma)
– Lors d’un cours de français sur la pesanteur, il est question d’« un vice intrinsèque à l’eau ».
– Dans un musée, Emma et Adèle s’extasient devant des toiles représentant des baigneuses nues dans des bains, ou bien sur des Ophélie aquatiques et inanimées dans l’eau.
– « Tout ce qui vient de la mer, c’est vrai que j’ai un peu de mal. » (Adèle)
– À la fin du film, Adèle est le Narcisse qui s’est noyé : elle pleure dans le resto au décor bleu.
Code « Éternelle jeunesse » :
– Les deux amantes vivent une idylle d’adolescence. L’une d’elle, Adèle, est en classe de première au lycée.
Code « Liaisons dangereuses » ou « Violeur homosexuel » ou le sous-code « Mélodrame » du code « Emma Bovary « J’ai un amant ! » » :
– Dans le discours des personnages, il est très souvent question de la défense de la « prédestination » dans les rencontres amoureuses. Celles-ci seraient déjà écrites d’avance, ne se choisiraient pas, et devraient obligatoirement se vivre. Ce film offre une vision de l’amour comme un destin tragique.
– Le premier regard lesbien que Adèle porte à Emma (quand elle se croise dans la rue) est teinté de peur, pire encore, de terreur.
– Thomas, le copain furtif de Adèle, dit que le seul roman qu’il a lu et aimé de sa vie, ce sont Les Liaisons dangereuses de Laclos.
– « La tragédie, ça touche à l’essence même de l’être humain. On ne peut y échapper. » (un des profs de littérature d’Adèle)
– « Il n’y a pas de hasards. » (Emma à Adèle)
Sous-code « Regards » dans le code « Amant diabolique » :
– Le regard désirant est désigné comme déterminant et est impérieux.
Code « Viol » ou « Poids des mots et des regards » :
– Le lesbianisme d’Adèle naît de la pression sociale à « niquer », à « faire couple » obligatoirement (les amies d’Adèle la poussent dans les bras de Thomas).
Sous-code « Descentes aux enfers » du code « Milieu homosexuel infernal » :
– Pendant le jeu télévisé Questions pour un champion, Julien Lepers pose la question suivante : « Quel est le nom de la femme d’Orphée qui descend aux enfers ? » (réponse : Eurydice)
Code « Milieu homosexuel infernal » :
– Le milieu lesbien est montré comme un milieu hostile, moqueur, narquois, grippe-fesses, puéril.
Code « Déni » :
– Pendant le jeu télévisé Questions pour un champion, Julien Lepers pose la question de la définition de l’« omerta », la fameuse « Loi du silence ».
– « De toutes façons, tu le sais. » (une amie lycéenne, parlant à Adèle de l’amour alors que cette dernière croit qu’il s’agit de son homosexualité : vieux quiproquo)
Code « Sommeil » ou « Femme allongée » :
– Les personnages du film sont souvent filmés endormis ou ensommeillés.
– L’un des tableaux que fait Emma de son amante Adèle est justement une femme allongée.
Code « Voyage » :
– On voit tout le temps Adèle dans les transports en commun, pile au moment où elle « se lesbianise ».
– « C’est bien de voyager : ça ouvre l’esprit. » (la phrase « profonde » de Samir)
Code « Amant triste » :
– Adèle et Emma sourient très rarement, et pendant tout le film, ce sont des pleureuses qui sont montrées, parce qu’elles se font énormément souffrir ensemble (après s’être bien consommées et après avoir esthétisée leur « idylle »).
Code « Bovarysme » ou « Poids des mots et des regards » ou « Élève/Prof » :
– Adèle est en classe de 1ère L (Littéraire) et vit à travers les livres. Elle dira elle-même qu’elle « les adore ». Elle croit quasiment tout ce que ses profs de lettres lui disent, et essaie de transposer ce qu’elle entend ou lit sur sa vie réelle et sentimentale.
– Adèle lit La Vie de Marianne, le roman à l’eau de rose de Marivaux.
– Depuis qu’Adèle sort avec Emma, elle aurait fait des progrès spectaculaires en classe.
– Ce n’est pas un hasard qu’Emma s’appelle Emma (comme Bovary).
Code « Faux révolutionnaires » :
– Adèle défile avec la CGT contre la privatisation de l’enseignement public, et chante « On lâche rien ». Puis, une fois en couple, elle s’excite à la Gay Pride parisienne.
– Dans l’histoire, Emma incarne la lesbienne assumée et qui a assurée alors qu’Adèle est celle qui a trahi par sa bisexualité (cf. le sous-code « L’homo combatif face à l’homo lâche »).
Code « Faux intellectuels » :
– Adèle, qui est en filière littéraire (waou !), qui écrit un peu et qui prétend adorer les grands chefs-d’œuvre de la littérature, se révèle être pourtant une lycéenne très passive et nonchalante en cours, une fille visiblement sans conversation (l’actrice Adèle Exarchopoulos ne semble pas faire mieux que son personnage…), une piètre institutrice.
– Adèle à la fenêtre, en train d’écrire (cf. le code « Femme au balcon »).
– Dialogues du film absolument nuls, uniquement centrés sur les goûts et sur le ressenti des héros. Aucune poésie ou philosophie là-dedans.
– Mention à l’existentialisme de Jean-Paul Sartre, montré comme le fin du fin de la pensée contemporaine… alors qu’il est juste instrumentalisé pour justifier un discours ET relativiste ET volontariste sur l’amour (le « pro-choix » déterministe et individualiste d’une Caroline Fourest, par exemple) : « On peut décider soi-même de sa vie. » dit Emma la « peintre-philosophe ».
– Adèle considère Bob Marley et Sartre comme le summum de l’engagement existentiel, comme des « prophètes » (au moins ça, oui…).
– Soi-disant Adèle aurait fait des progrès pharamineux en cours de philo grâce à ses discussions amoureuses avec Emma : en réalité, on voit que la philo dont parlent les deux filles suit l’arithmétique du plaisir sexuel (elles se moquent d’ailleurs d’elles-mêmes, en se donnant des « notes de philo » au lit et en enchaînant les métaphores filées : « Je jouis du savoir ! » s’esclaffent-elles à poil).
– Vincent (le beau-père d’Emma) confond la culture avec le simple hédonisme épicurien, puisqu’il se définit comme un « amateur de bonne chair, de bons vins… et de culture ! ».
Sous-code « Amant miniature » du code « Amant comme modèle photographique » :
– L’insistance sur la place de l’adjectif « petit » dans la pièce classique Antigone.
Code « Fan de feuilletons » ou « Jeu » :
– Les parents d’Adèle passent leur temps devant la télé à comater devant des jeux.
Code « Parricide la bonne soupe » :
– L’image des hommes dans ce film est pathétique : ils sont montrés comme des bourrus qui n’ont que la réussite financière en tête (exemple avec le père d’Adèle), de gentils beaufs ignorants et incultes (Thomas), des ennuyeux ou des terre à terre, des profiteurs et des tentateurs (le collègue instit). Les seuls qui trouvent grâce aux yeux du réalisateurs sont soit homos (Valentin), soit « artistes » bisexuels (Joachim), soit rebeux et volontairement instables (Samir).
Code « Lune » :
– Lorsque Adèle s’homosexualise, elle perd tellement pied avec le réel que sa mère, à table, lui fait gentiment remarquer qu’elle est dans la lune : « Dans la lune, Adèle… »
Code « Amant narcissique » ou « Bobo » ou « Plus que naturel » :
– Tous les bruitages (l’eau des canalisations dans les toilettes, le chant des oiseaux, les effleurements de peau, la salive des baisers échangés) sont décuplés… pour emprisonner le spectateur dans la sensation ou l’émotion, et donc finalement pour prouver de manière naturaliste et « sobre » à la fois, que l’amour homo est « naturel ». Il n’y a d’ailleurs pas de musique de fond dans le film (sauf pour les moments officiels de chansons, où là le réalisateur se fait plaisir en transformant son film en grand vidéo-clip).
– On joue sur le quotidien, le côté « ressenti », « tranche de vie » prise sur le vif.
– Le couple lesbien est toujours filmé dans des cadres bucoliques (parcs, jardins, mer, etc.).
– « C’est ce qu’il y a de meilleur, la texture. » (Emma la « peintre-philosophe »)
– Ce film se veut un bal de sensations « Nature et Découverte » : Je me ressens fumer. Je me masturbe verbalement, sensiblement. Je touche les peaux. J’écoute la Nature, le vent dans les arbres. Je raconte mon bien-être, carpe diem et hédonisme de bas étage : « On est bien, là, hein ? » dit Emma étendu dans l’herbe. « Un peu trop, même… » lui répond Adèle.
– Confusion (typiquement bobo) entre les goûts et l’amour, entre la simplicité et l’amour : « Elles sont délicieuses, vos pâtes, en tous cas. C’est simple mais c’est très bon. » (Emma au père d’Adèle) (Pour moi, la plus belle réplique du film. LOL)
– « Tu veux toucher ? » (Liz, la femme lesbienne enceinte avec son ventre rond, et présentant la maternité comme une sensation)
Code « Bobo » :
– Adèle et son bonnet péruvien (premières images du film) ou ses cours de professeur des écoles « cools Africa » (elle fait danser ses petits de maternelle sur une chorégraphie de danse africaine pour la kermesse de l’école).
– Les effets de caméra vacillante.
– Adèle est filmée en train de cuisiner.
Code « Duo totalitaire lesbienne/gay » :
– Valentin, le meilleur ami d’Adèle, est homo lui aussi. Ils vont dans les bars gays ensemble, mais finissent par draguer chacun de leur côté.
– Quand, au lycée, la relation amoureuse entre Adèle et Emma est devinée, Adèle engueule Valentin d’avoir cafté qu’ils étaient allés dans des établissements LGBT, le traite de traître.
Sous-code « Cousin » du code « Inceste entre frères » :
– Lors de leur première rencontre, dans le bar lesbien, Emma fait passer Adèle pour sa « cousine » auprès de ses camarades lesbiennes, pour mieux lui mettre le grappin dessus et se la réserver.
Sous-code « Lesbienne alcoolique » du code « Drogues » :
– Emma boit beaucoup de bières, et elle dit qu’elle les « adore ».
– En boutade, Emma rebaptise la bière Gulden : « Gulden : la Bière des goudous ! »
Code « L’homosexuel = L’hétérosexuel » :
– Emma qualifie Adèle comme l’archétype de « l’hétéro qui serait plutôt curieuse [de l’homosexualité] », de l’extérieur.
Code « Icare » :
– Pour draguer poétiquement et faire semblant de « se la péter » humoristiquement, Emma veut traduire le prénom « Adèle », et le premier mot qui lui sort, c’est « Soleil ».
– L’un des baisers lesbiens entre Emma et Adèle se fait sur fond solaire.
Code « Peinture » :
– Emma est en 4e année de Beaux-Arts, et exerce le métier de peintre (…révoltée par le « système » capitaliste qui transforme l’art en business).
– Joachim (bisexuel) est galleriste.
– On a droit, pour la fin du film, au vernissage de l’expo d’Emma avec son cercle d’artistes bobos.
Sous-code « Coiffeur homo » du code « Pygmalion », ou bien le code « Maquillage » :
– Adèle, pour déconner, soupçonne Emma d’être « coiffeuse » à cause de sa teinture de cheveux de celle-ci, qui est bleue.
Code « Pédophilie » :
– Emma sort avec Adèle, qui est mineure (au fur et à mesure de l’intrigue, cette dernière passera le cap des 18 ans : ‘ttention, c’est une film vachement moral…).
Code « Tout » :
– « Avec toi, c’est tout ou rien. » (Emma parlant à Adèle)
Code « Cannibalisme » ou « Vampirisme » :
– Dans ce film, la conception de l’amour repose uniquement sur les goûts. Elle est gustative et sensitive.
– « Je mange toutes les peaux. » (Adèle à Emma)
– « À quel âge t’as goûté une fille ? » demande Adèle à Emma. Cette dernière la corrige pour atténuer le lapsus consumériste : « ‘Goûter une fille’ ou ‘embrasser’ ? »)
– Au lit, Emma mord vraiment Adèle, et celle-ci se laisse faire… ce qui étonne Emma : « Tu m’as fait peur. J’ai cru que tu allais crier. » Adèle lui répond avec malice : « Heureusement que tu t’es arrêtée. »
Sous-code « Caméléon » du code « Homme invisible » :
– « La peau du caméléon, c’est pour se cacher des autres animaux. » (Prune, en lecture de classe à l’école primaire)
Code « Frère, fils, père, amant, maître, Dieu » :
– « J’ai une infinie tendresse pour toi. Qui durera toute la vie. » (Emma à Adèle) La relation amoureuse sans forme…
Sous-code « Amant-objet » du code « Pygmalion » ou code « Amant comme modèle photographique » :
– Emma tire le portrait d’Adèle dès leur deuxième rencontre.
– « Je touche du bois ! » dit, en boutade, Emma, en claquant les fesses d’Adèle au lit.
Sous-code « Paradoxes du libertin » du code « Liaisons dangereuses », ou bien code « Bobo » :
– Le réalisateur du film nous fait croire qu’Emma et Adèle sont patientes, ont la sagesse de ne pas s’embrasser sur la bouche dès la deuxième rencontre, et que cette mesure prouverait la force de leur « amour ».
Sous-codes « Fatigue d’aimer », « Ennui » et « Infidélité » du code « Manège » :
– Tout le message du film consiste à laisser croire que « l’amour vrai ne dure pas » et que ça ce serait magnifique.
– Emma est déçue que Adèle soit une amante sans ambition, sans créativité. On voit très vite le manque de communication dans leur « couple ». D’ailleurs, elles finissent chacune par aller voir ailleurs.
Code « Désir désordonné » :
– Emma se qualifie « d’un peu bizarre » comme fille.
Code « Homosexuel homophobe » :
– La lycéenne et « pote » d’Adèle, pro-gay et indifférente à la pratique homosexuelle, insulte Adèle de « sale goudou » et l’imagine en train de se faire mater/tripoter salement par elle.
– Adèle dément qu’elle est lesbienne : « Puisque je vous dis que je ne suis pas lesbienne ! » (cf. le code « Déni »)
Code « Milieu homosexuel paradisiaque » ou « Mère gay friendly » ou « FAP la « fille à pédé(s) » » :
– Les amies d’Adèle la harcèlent pour qu’elle fasse son « coming out » (« Juste assume ! »), pour ensuite lui reprocher qu’elle n’obtempère pas et se retourner contre elle.
Code « Blasphème » :
– Pendant le cours de français, les catholiques sont associés à la bien-pensance et à une censure de la pensée. (gros LOL)
Code « Obèses anorexiques » ou « Drogues » :
– Tous les personnages du film sont filmés en train de manger.
– « Je mange de tout. Je pourrais manger en continu toute la journée. » (Adèle)
– Tout le monde est filmé en train de manger, en train de consommer (des pâtes et des spaghettis plusieurs fois, de la boisson alcoolisée, du tabac, du sexe, de la sensation naturelle, etc.). C’est un film sur la consommation et destiné à des consommateurs bobos.
Code « Humour-poignard » :
– La blague (la seule du film) potache sur les huîtres (symboles saphiques cousus de fil blanc et graveleux. Adèle, qui n’aimait pas les huîtres, finit par les aimer : ha ha ha, qu’est-ce qu’on rigole… Les bobos se payent le luxe d’être triviaux, et ça ne fait rire qu’eux.)
Code « Putain béatifiée » ou « Coït homo = viol » :
– Le réalisateur veut, au final, prouver l’Orgasme entre femmes, l’Orgasme sans l’homme, l’Orgasme au féminin exclusif. Il filme la jouissance, avec la crudité du porno mais sans les techniques et les cadrages caméras propres au porno (belle hypocrisie, là encore…). On voit tout. Quelle humiliation pour les actrices, qui sont à la fois obligées (et libres, pourtant) de dévoiler leur intimité profonde, sommées de jouer les putes en orgasme ou se masturbant pendant tout le film (il y a au moins 4 scènes de « pur » cul… sans compter la scène de masturbation du début, et le commencement de la scène de cul dans le restaurant). Les deux actrices soi-disant « consentantes » sont instrumentalisées comme des preuves vivantes et vibrantes que « l’orgasme est possible entre deux femmes » (au cas où le spectateur l’ignorerait ou n’aurait pas compris… C’est sûr, nous sommes d’éternels « gros prudes » judéo-chrétiens qui nous offusquons d’un rien). On a droit à assister au coït pendant près de 10 longues minutes, et malheur à celui qui trouverait ça insoutenable et avilissant. C’est de la provocation et de l’esthétisme à deux balles, d’accord, mais n’oublions pas que c’est surtout une violence faite à tout le monde.
– Emma et Adèle, pendant l’« amour », se donnent des fessées. Le spectateur a honte pour elle (ou bien rit pour masquer sa honte).
– Emma insulte Adèle de « sale pute », de « traînée », de « prostituée ».
– On voit s’instaurer entre les deux protagonistes une relation de prostitution (même si la monnaie d’échange est le sexe et les sentiments) : quand Adèle dit qu’elle veut acheter une toile à Emma, elle lui propose sérieusement de « la payer en nature ».
Sous-code « Princesse orientale » du code « Femme étrangère » :
– Sur un char de Gay Pride, un homme homosexuel est filmé déguisée en danseuse orientale voilée.
Sous-code « Parents divorcés » du code « Orphelins », ou bien code « Mère gay friendly » :
– Emma, dont les parents sont divorcés, a une mère très « open ».
Code « Appel déguisé » ou « Manège » :
– Lorsque Emma trinque avec sa mère, son beau-père et Adèle, « à l’Amour ! », Vincent (le beau-père) rajoute spontanément « Tout de suite les grands mots… », réaction spontanée qui fait rire jaune tout le monde.
Code « Haine de la famille » ou « Parodies de mômes » :
– Adèle fuit ses collègues de travail et prétexte qu’elle a des « dîners de famille » pour cacher qu’elle passe toutes ses soirées avec sa compagne.
– « Ça fait deux enfants à la maison. Ça fait beaucoup. C’est la famille. » (Emma disant qu’elle s’entend très bien avec la gamine de sa compagne Liz, et qu’elles font des conneries ensemble).
Code « Petits Morveux » :
– L’enfant est considéré comme un objet. « Vous jouez avec le bébé ? » (Joachim s’approchant du couple Emma/Adèle qui touche le ventre arrondi de Liz)
Code « Artiste raté » ou « Bobo » ou « Faux intellectuels » :
– Guirlande d’ampoules dans le jardin, et projection d’un film des années 1920 en noir et blanc (avec Louise Brooks et sa coupe au carré) en pleine nature, avec le cercle de bobos « artistes » amis d’Emma, qui s’écoutent parler de ce qu’ils ressentent et de ce qu’ils aiment esthétiquement. Une amie beaux-ardeuse d’Emma fait une thèse sur « la morbidité chez le peintre Egon Schiele ». Joachim, le galeriste bisexuel, tient un discours soi-disant érudit (il fait référence à la bisexualité « artistique » de Tirésias, le personnage mythologique grec) et prône « l’orgasme au féminin » (qui n’aurait rrrrien à voir avec la présence des mâles : « Je suis persuadé que l’orgasme féminin est mystique » ; selon lui et les autres invités bobos-bis-féministes, l’extase sexuelle serait réservé aux femmes). Emma dit qu’elle aime chez Egon Schiele la « noirceur », le côté « artiste écorché ». Discussions pseudo « intellectuelles » et pseudo « expertes » sur la différence entre Schiele et Klimt (quel haut niveau !), qui reposent sur un échange de goûts et de sensations, et qui finissent par une conclusion complètement plate et relativiste : « Des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas : tout est une affaire de points de vue ! ». Merci. C’est hyper profond. Adèle se sent inculte devant tant d’esbroufe. Ça veut dire que même le réalisateur du film pense nous proposer de la culture de haute volée. Nan mais allô quoi ! 😉
– La scène finale : le vernissage de l’expo d’Emma (avec les interprétations psychologisantes nullissimes des Beaux-ardeux).
Code « Emma Bovary « Oh mon Dieu ! » » :
– L’arrêt sur image du visage expressionniste et inquiet de Louise Brooks dans le film des années 1920.
Sous-code « Solitude à deux » du code « Île » :
– « J’me sentais toute seule [‘avec toi’, ou ‘dans notre couple’]. » Phrase que répète plusieurs fois, éplorée, Adèle à Emma, pour se justifier de lui avoir été infidèle.