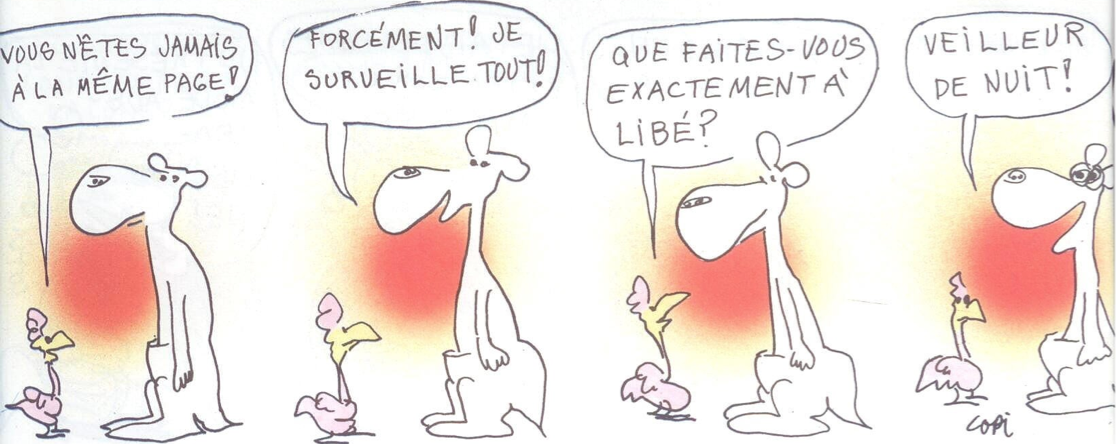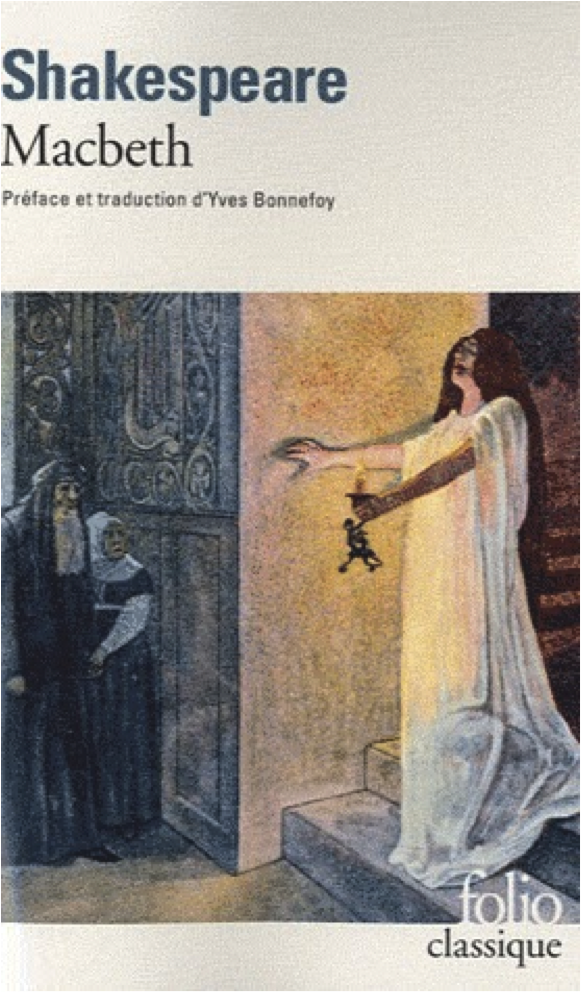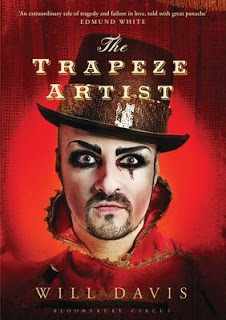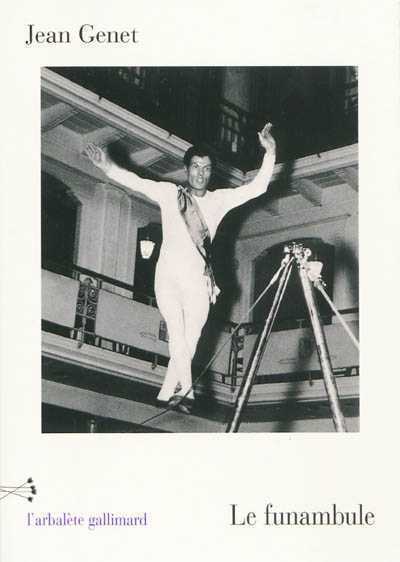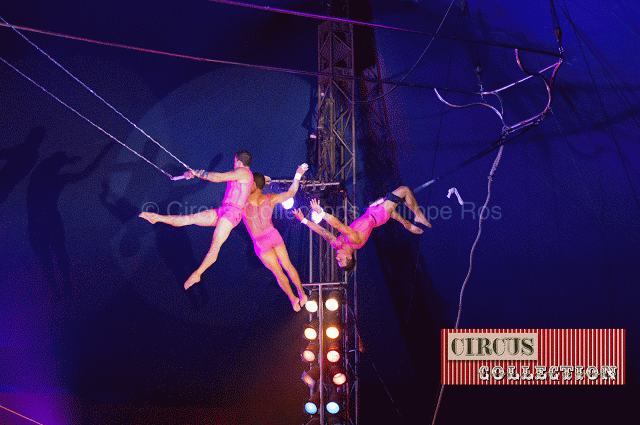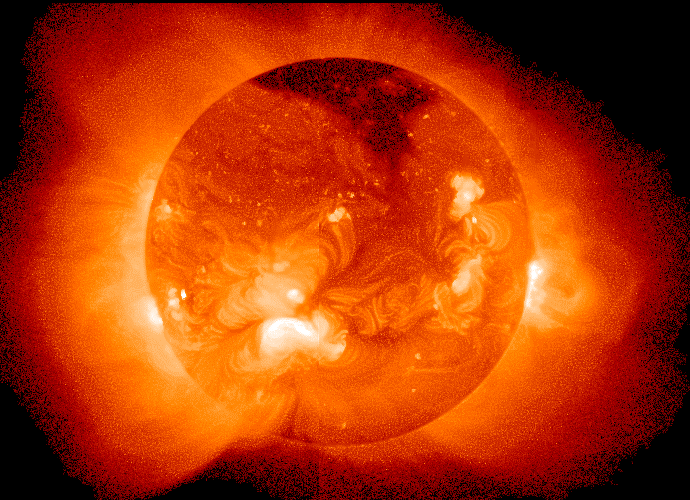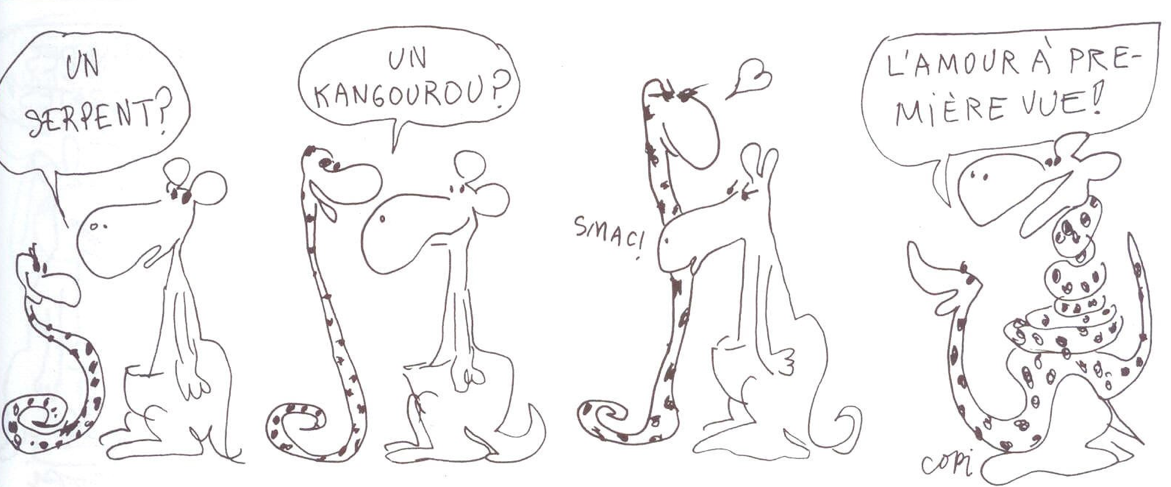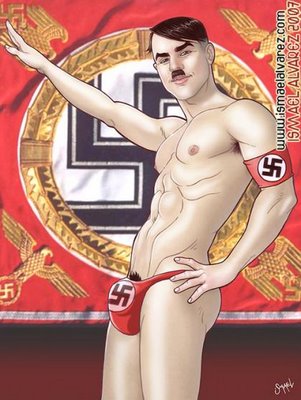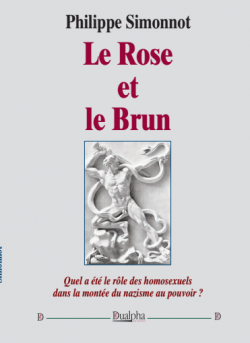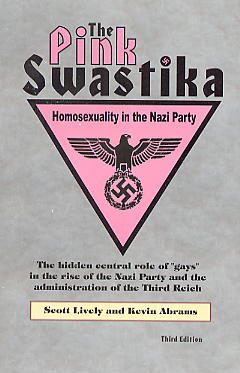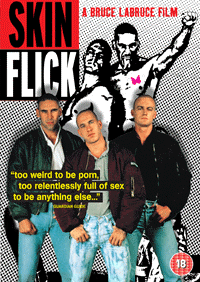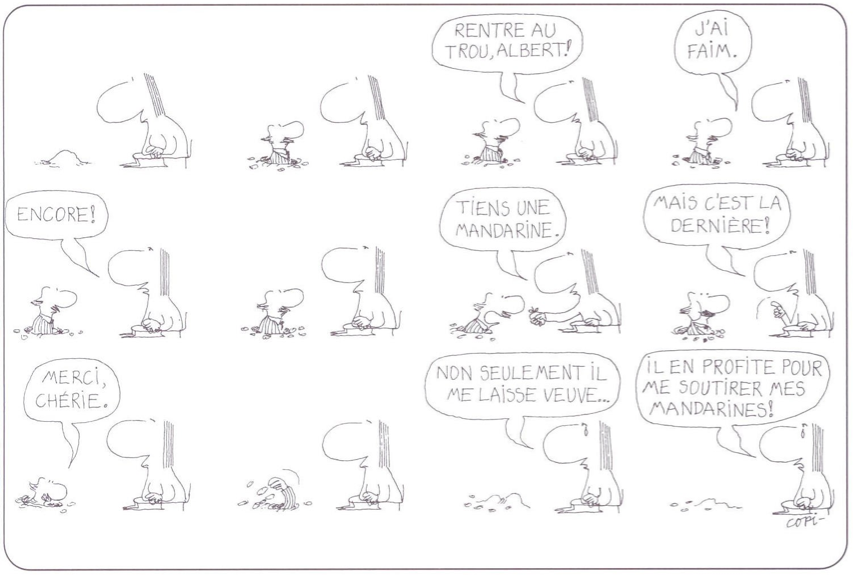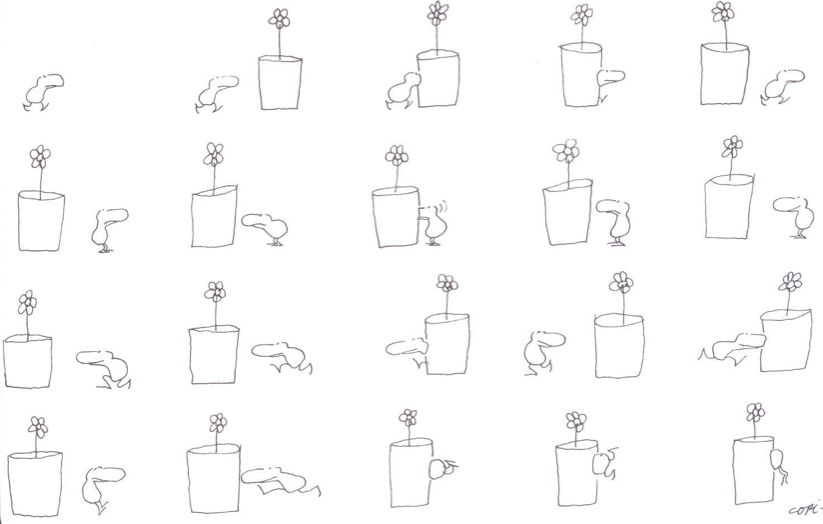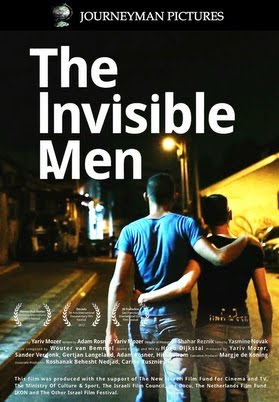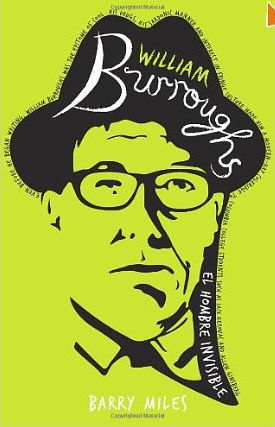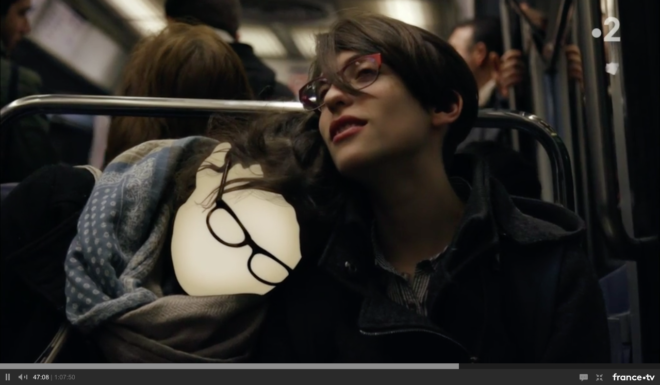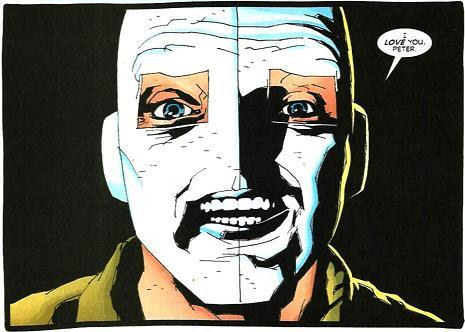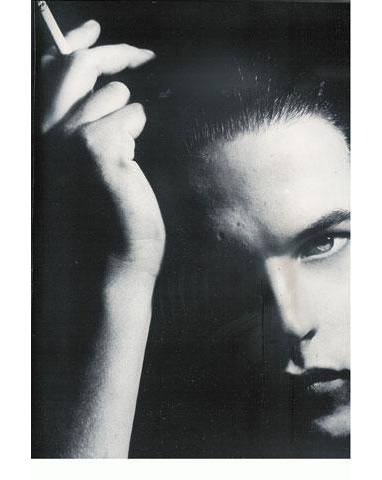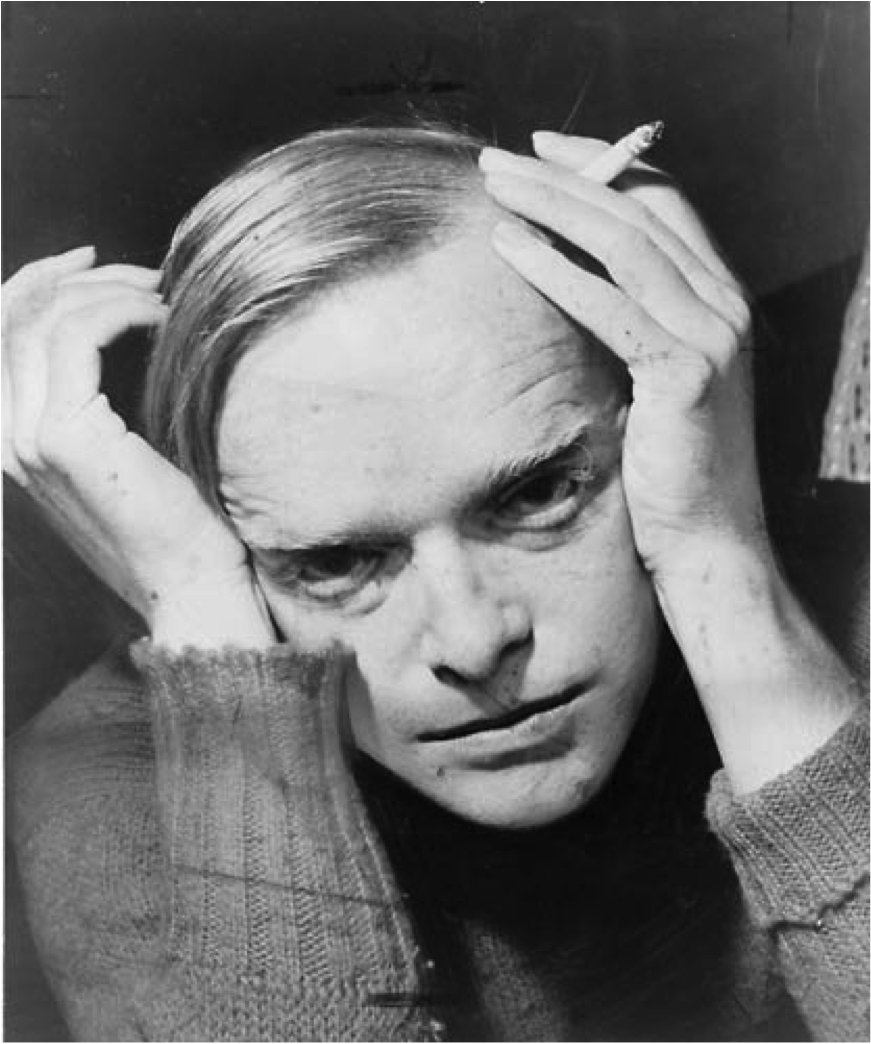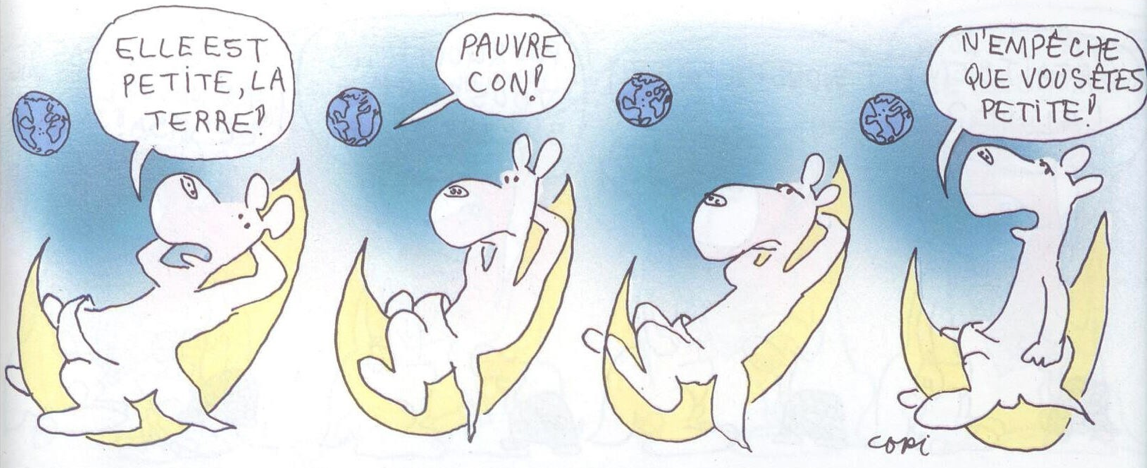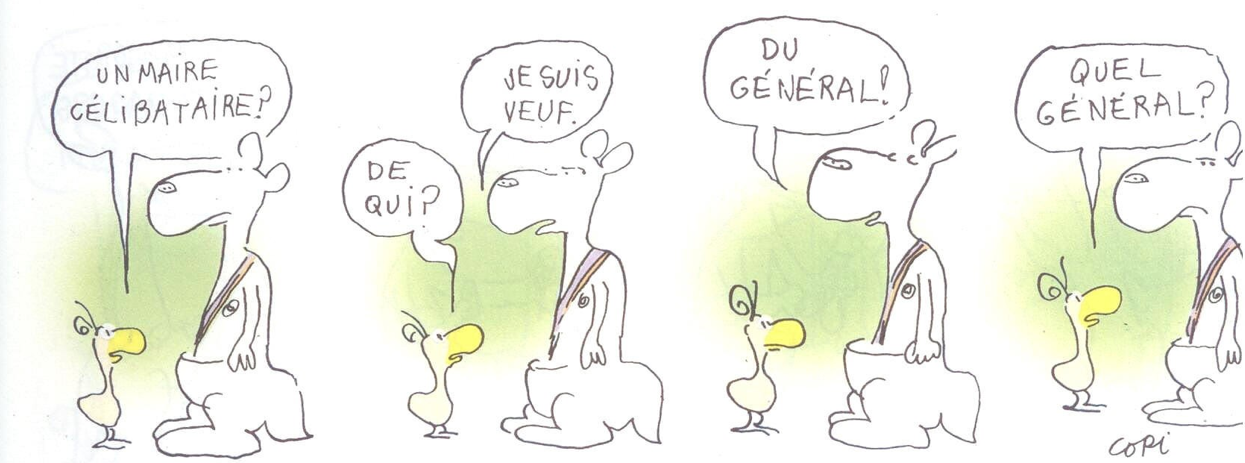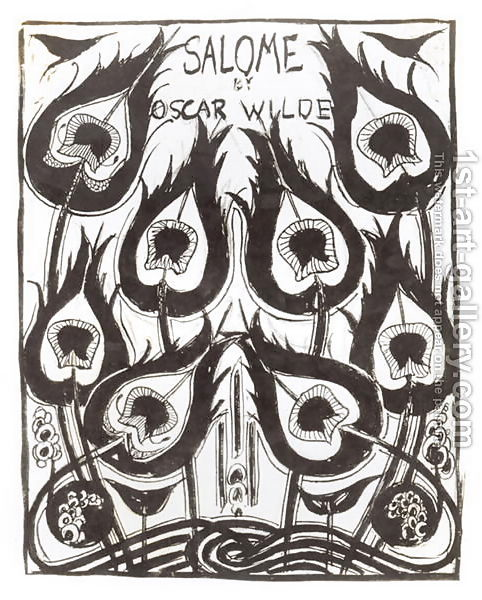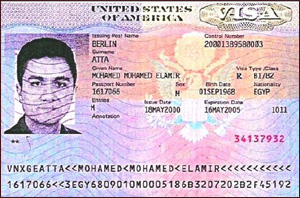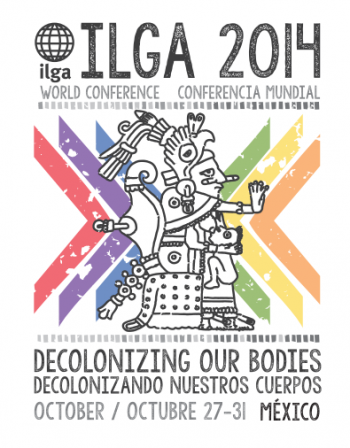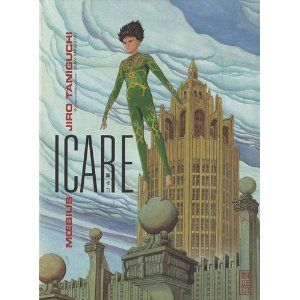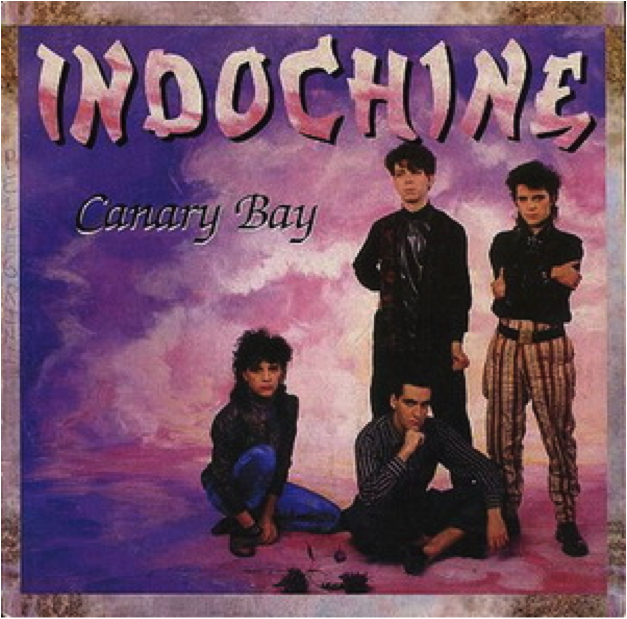Homosexuels psychorigides
NOTICE EXPLICATIVE :
Le fascisme homosexuel… ou la discordance entre la fin et les moyens

Les entendez-vous, ceux que la haine d’eux-mêmes a parfois transformé en agressifs révoltés ? Moi, oui. Je les vois même très clairement. Ils arrivent, les dictateurs homosexuels et le totalitarisme arc-en-ciel, trônant sur des chars peinturlurés en rose (mais des chars quand même !), sous la bannière de la démocratie égalitiste (mais, je vous le demande, quel fascisme, tout au long de l’Histoire humaine, ne s’est pas valu de la « nature », de l’« amour », de la « différence », de la « tolérance », de l’« égalité », du « progrès », de la « fête », des « discriminations », pour s’imposer avec une incroyable violence ?), se plaçant sincèrement en éternelles victimes d’une société qu’ils haïssent et qu’ils cherchent à détruire, assoiffés de vengeance d’un faux/vrai viol qu’ils auraient/ont subi, mais surtout qu’ils ne dénoncent pas en tant que tel.
Ces despotes d’opérette plumés sont-ils une réelle menace pour la société ? Je ne le crois pas. Des haut-parleurs ne font qu’amplifier un message qui ne vient pas d’eux. Ils sont d’abord et surtout une menace pour eux-mêmes (c’est bien là le drame de leur fausse révolution). Et ensuite, pas de quoi diaboliser le fameux « lobby gay » non plus. Ce ne sont que les désirs homosexuel et hétérosexuel actés qui constituent une menace pour l’Humanité ; pas les personnes homosexuelles en elles-mêmes. Leur existence n’est que le signe d’une dictature qui les dépasse et qu’elles alimenteront comme des moutons si et seulement si elles s’adonnent à leur désir homosexuel. La communauté homosexuelle, qu’on peut aisément qualifier actuellement de mini-dictature (quand bien même elle soit composée de membres très variés), n’est que le voyant rose d’un totalitarisme social beaucoup plus étendu et dangereux que lui : l’idéologie homophobe, angéliste, asexualisante, matérialiste, individualiste, athée, sentimentaliste, désincarnée, de la bisexualité universelle obligatoire.
N.B. : Je vous renvoie également aux codes « Parodies de mômes », « Homosexuel homophobe », « Androgynie bouffon/tyran », « Douceur-poignard », « Tout », « Hitler gay », « Reine », « Se prendre pour Dieu », « Se prendre pour le diable », « « Je suis différent » », « Différences culturelles », « Promotion « canapédé » », « Faux révolutionnaires », « Patrons de l’audiovisuel », « Bourgeoise », « Entre-deux-guerres », « Violeur homosexuel », « Milieu homosexuel infernal », « Parricide la bonne soupe », « Liaisons dangereuses », à la partie « Misanthropie » du code « Solitude », à la partie « Laverie » du code « Innocence », et à la partie « Fantasme pour le uniformes et les militaires » du code « Défense du tyran », dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.
1 – PETIT « CONDENSÉ »
La métamorphose de la victime innocente en bourreau révolté

Pierre et Gilles
Quand les êtres humains n’arrivent pas à se retrouver sur un relatif pied d’égalité, ce qui arrive toujours un jour ou l’autre, chacun tient à l’égard des autres à la fois le rôle de bourreau et celui de victime. S’ils ne prennent pas conscience de ces deux masques qu’ils peuvent endosser du fait de leur liberté, et qu’ils choisissent de se vouloir éternellement victimes, ils ne se confesseront ni bourreaux ni finalement victimes, étant donné que leurs tendances de bourreaux leur interdiront d’élire pour destin une communion à celui de leurs victimes. C’est ce qui arrive à beaucoup de personnes homosexuelles, qui présentent les tyrans comme de gentils agneaux à prendre en pitié, et les victimes (qu’elles défendaient à l’origine) comme une impitoyable foule de monstres ricanants à ignorer/mépriser. Leur anti-conformisme de principe les amène à sacraliser ce qui est horrible, non parce qu’elles l’aiment vraiment, mais parce qu’elles s’imaginent que c’est diabolisé par les autres, donc désirable. La compassion homosexuelle pour le méchant, poussée à l’extrême, peut les conduire à la fascination des figures d’autorité qu’elles prétendent par ailleurs haïr. Dans leur adolescence, elles ont été très souvent éblouies par les leader de leur classe, ou bien par des grands hommes historiques (Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Néron, Charles de Gaulle, etc.). Elles sont les premières à être profondément touchées par la blessure d’amour du mythique dictateur que tout le monde devrait éthiquement mépriser mais aussi saluer pour sa sincérité maladroite et blessée.
Comme les Hommes ne sont pas de la perfection dont elles avaient rêvée, elles préfèrent se rabattre sur celui qui est entier (quitte à ce que ce soit dans le mal !). Le mensonge sur la pureté est pour elles encore pire que la méchanceté affichée du tyran, qui, lui, a le mérite de jouer courageusement son rôle jusqu’au bout sans retourner sa veste. Elles vont donc très souvent vénérer/mépriser la trahison, en se montrant à elles-mêmes qu’elles peuvent héroïquement choisir pour modèle une personne qu’elles n’auraient (comme la « majorité ») a priori pas élu non plus, parce qu’elles se persuadent qu’elles se doivent d’être ouvertes, infidèles et anti-conformistes, y compris avec elles-mêmes ! Ainsi, à propos des nazis trahis en 1944 pendant la Libération par le peuple français qui avait auparavant collaboré avec eux, Jean Genet écrit en 1947 dans Pompes funèbres : « Ils ne furent pas seulement haïs mais vomis. Je les aime. » (cf. l’article « Physique de Genet » de Philippe Sollers dans le Magazine littéraire, n°313, septembre 1993, p. 41)
Si les personnes homosexuelles sont tentées de soutenir le tyran et de s’y identifier, c’est bien parce qu’inconsciemment et en fantasmes, elles se reconnaissent dans les drames personnels qu’il a/aurait vécus (despotisme parental, solitude de cour d’école, non-reconnaissance des talents, profonde déception du monde, etc.). Elles savent très bien qu’avant de devenir ce qu’il est, il a été victime (à commencer de lui-même !). Malheureusement, elles gardent souvent une vision figée et révolue du dictateur quand il était encore beaucoup plus victime que bourreau, sans la connecter à ce qu’il est devenu par la suite : une version plus dommageable du bouc émissaire.
Généralement, le tyran incarne le mal qu’elles désirent mais qu’elles détestent assez pour ne pas l’imiter : le louvoiement avec le totalitarisme ou le terrorisme ne restera qu’un jeu ironique « second degré ». Par exemple, dans le roman À la recherche du temps perdu (1913-1927) de Marcel Proust, le baron Charlus se fait passer pour un espion allemand souhaitant passionnément la victoire de l’Allemagne, plus pour provoquer le chauvinisme ambiant que par conviction personnelle. Mais le problème, c’est que beaucoup de personnes homosexuelles ne maîtrisent pas autant leur jeu auto-parodique qu’elles le souhaiteraient, car elles ont pris le tyran en sincérité et en esthétique. C’est la raison pour laquelle elles vont parfois défendre concrètement les tyrans modernes. « Redevenir gendarme, chasser le voleur, consoler la victime. Subitement, je voudrais pratiquer l’abus de pouvoir par personne ayant autorité. » (la narratrice lesbienne du roman Mathilde, je l’ai rencontrée dans un train (2005) de Cy Jung, p. 44)
Le soutien mutuel entre homosexualité et dictature n’est pas toujours qu’une mise en scène sortie des cerveaux soucieux de cultiver l’amalgame entre homosexualité et monstruosité. Parfois, elle a été réalité. Comme le signale très justement Reinaldo Arenas, écrivain cubain incarcéré en tant qu’« homosexuel » dans les prisons de Fidel Castro, s’il y a bien une chose qui a développé la répression sexuelle à Cuba, ce fut précisément la libération homosexuelle : « Je crois franchement que les camps de concentration homosexuels et les policiers déguisés en jeunes hommes obséquieux pour débusquer et arrêter les homosexuels ne contribuèrent qu’à un développement de l’activité homosexuelle. » (Reinaldo Arenas, Antes Que Anochezca (1992), pp. 132-133)
L’amour entre le monarque et son mignon efféminé est historiquement connu (Edward II et Piers Gaveston, Louis XIII et son favori Charles Albert de Luynes, Hitler et Ernst Röhm ou bien Arno Breker, Napoléon Bonaparte et sa « Tante Urlurette » Cambacérès grâce à qui l’homosexualité ne fut jamais condamnée par le Code Civil, Pétain et sa « Guestapette » Abel Bonnar, Nelson Mandela et son chauffeur Cecil Williams, Louis II de Bavière et son mignon Ludwig, Staline et le frêle Arménien Mikoyan, etc.). Les tyrans qui ont le plus persécuté la communauté gay étaient particulièrement entourés de personnes homosexuelles. Dans le cercle politique proche de Fidel Castro, par exemple, Reinaldo Arenas atteste qu’il y a eu de nombreux hommes homosexuels (Armando Valladares, Alfredo Guevara, etc.). Rien que si nous regardons le gouvernement de Tony Blair en 1998, nous pouvions compter sur seize ministres quatre hommes homosexuels (Chris Smith, Ron Davies, Nick Brown, et Peter Mendelson), ce qui n’est pas une petite moyenne ! Beaucoup de personnes homosexuelles font partie de l’entourage proche des puissants. Fréquemment, homosexualité et Jet Set ne font qu’un. « Nous sommes un peu comme le Dom Juan de Molière : nous avons développé une morale progressiste, mais nous, nous sommes toujours du côté des maîtres. » (Patrice Chéreau cité dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 109)
Beaucoup de personnes homosexuelles connaissent mieux que quiconque les mécanismes des systèmes dictatoriaux. Le seul problème, c’est qu’au lieu de les dénoncer, elles les adorent. Elles sont ces enfants des « démocraties » actuelles, qui, par manque de combats, cautionnent des systèmes répressifs qu’elles vomissent et pourtant attendent. « L’homo democraticus entretient vis-à-vis du despotisme un rapport ambigu : il l’exècre mais regrette aussi sa disparition. À la limite, il semblerait presque inconsolable de ne pas être opprimé : alors, faute d’ennemis réels, il s’en forge des imaginaires ; il se délecte à l’idée qu’il vit peut-être vraiment sous une dictature, que le fascisme va lui tomber du ciel, perspective qui le remplit de crainte autant que d’espoir. » (Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence (1995), p. 135) Tout ce qui fait le décorum à paillettes dissimulant l’horreur du totalitarisme les époustoufle, les captive et les désarme. Par exemple, elles soutiennent artistiquement le kitsch, l’art totalitaire par excellence. Certaines se sont concrètement agenouillées devant les beaux soldats allemands, ce paquet cadeau doré de la dictature nazie – nombreux sont les intellectuels et les artistes homosexuels à avoir rempli les rangs des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale –, et expriment parfois leur amour-répulsion pour le régime nazi, à la fois dans l’humour camp, mais aussi très sérieusement : « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir pour Hitler une admiration pleine d’angoisse, de peur et de stupeur » déclarera André Gide dans son journal au 20 août 1940. Par exemple, au générique de son film « Passion » (1964), Yasuzo Masumara écrit le mot passion à côté d’une énorme croix gammée rouge : difficile d’être plus clair…
Dès que la corrélation entre homosexualité et totalitarisme est faite, cela provoque généralement un tollé dans la communauté homosexuelle. « Problème sociologique : pourquoi tant de pédérastes chez les collaborateurs ? » s’interroge Jean Guéhenno (cf. l’article « Écrivains et collaboration » d’Emmanuel Pierrat, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, p. 123). Certains intellectuels évacuent presque systématiquement le lien de coïncidence par le rejet pourtant justifié du lien de causalité. « Il est évident qu’il y avait des homosexuels parmi les nazis ou, inversement, des nazis parmi les homosexuels, mais cela ne signifie rien en soi. L’idée d’un lien intrinsèque entre adhésion au nazisme et orientation homosexuelle est si paradoxale… » (cf. l’article « Nazisme » de Michel Celse, op. cit., pp. 334-338) Ils s’imaginent qu’ils fuient l’extrémisme d’où ils viennent, en choisissant celui qui lui est opposé. En réalité, ils passent souvent d’un fondamentalisme à un autre, de l’extrême droite à l’extrême gauche. Nous ne serons pas étonnés de lire André Gide écrire dans Morceaux choisis (1921) que « les extrêmes le touchent ».
Il y a quelque chose d’incompréhensible dans le soutien homosexuel au totalitarisme, une attitude de défense/déni comparable à celle du personnage de Molina dans le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) face au film nazi « Destino », ou au refus de Manuel Puig de prendre connaissance du contenu du livre de Susan Sontag sur le camp (« C’est comme si j’en avais peur, ou peur de prendre conscience de certaines choses dont j’ai seulement l’intuition, ou peur de ne pas être d’accord et de sentir qu’elle tripote des choses que j’aime. », Manuel Puig à Emir Rodríguez Monegal, « El Folletín Rescatado, Entrevista A Manuel Puig » (1972), dans la Revista De La Universidad de México, vol. XXVII, n°2, octobre 1975, pp. 25-35) : une curieuse fascination qui refuse de se rendre intelligible. Cette attraction homosexuelle vers la dictature suit majoritairement une logique esthétique et intentionnelle plus qu’une dialectique d’amour et de Réalité. Vous connaissez sûrement la fameuse citation de Pascal : « Qui veut faire l’ange fait la bête ». Quand les personnes homosexuelles ne prennent pas conscience de la nature totalitaire et idolâtre de leur désir homosexuel, parce qu’elles confondent l’humilité avec l’humiliation, la Vérité avec la sincérité, ou bien l’autorité avec l’autoritarisme, il arrive qu’elles cherchent à imiter en actes l’image du tyran qu’en intentions elles prétendent sincèrement combattre. Ainsi, une minorité d’entre elles peut passer insensiblement de la douceur à la violence, autrement dit de « pédale douce » à « pédale dure », comme l’a filmé Gabriel Aghion.
Les Dictateurs homosexuels : César, Néron, Hitler, Mao, Fidel, Staline, Oussama, and Cie
Au départ, on donnerait le bon Dieu sans confession à ces crèmes d’Hommes ultra-sensibles homosexuels qu’un rien ne semble ébranler. Et voilà qu’au bout d’un moment, en vivant avec eux, nous les voyons parfois se transformer en petits despotes insupportables. Ceci est illustré dans l’iconographie homo-érotique par la présence des personnages homosexuels psychorigides, exerçant quelquefois le métier d’architecte, détestant ce qui n’est pas carré, rangé, propre ou absolument pur. Certaines personnes homosexuelles deviennent ces « dames de fer » que décrit Yongyooth Thongkonthun, qui nous font bien rire sur le moment alors qu’elles devraient plutôt nous inquiéter sur la durée. Marguerite Duras n’avait pas tort de dire qu’elle voyait « dans l’apparente douceur de l’homosexualité une provocation à la violence » (Marguerite Duras citée dans l’article « Marguerite Duras » de Louis-Georges Tin, sur le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin., p. 137). Il n’est pas anodin d’observer au théâtre qu’une des astuces pour incarner au plus près un rôle de délicieux méchant est de cultiver une préciosité masculine, donc une homosexualité. Iconographiquement, l’homme-paon caressant, le versant masculin de la femme-paon – personnage de cabaret très présent dans la fantasmagorie homosexuelle – symbolise parfois le dictateur. Sur scène et au cinéma, les artistes homosexuels interprètent souvent des rôles de dictateurs ou de méchants crapuleux. Les dictateurs à l’écran sont à maintes reprises montrés comme homosexuels.
Ces images rejoignent une certaine réalité fantasmée. Souvent dans l’histoire humaine, le dictateur et la personne homosexuelle ont fusionné concrètement. Par exemple, dans les années 1930, le régime nazi est touché de plein fouet par la découverte d’un foyer important de personnes homosexuelles au sein des Sections d’Assaut (Hitler en fait exécuter cent cinquante le 30 juin 1934 pendant la Nuit des Longs Couteaux) : leur représentant le plus connu est Ernst Röhm. Même si de fameux dictateurs ont persécuté les personnes homosexuelles, ils étaient contre toute attente eux-mêmes homosexuels. « En contradiction avec ses propres pratiques, Mao Zedong ordonna la persécution des homosexuels et instaura la peine de mort pour sodomie. » (Michel Larivière, Dictionnaire des homosexuels et bisexuels célèbres (1997), p. 236) Ceux qui ont vécu les camps de concentration sont formels : beaucoup de leurs tortionnaires nazis étaient homosexuels (Aimé Spitz cité dans l’essai Les Oubliés de la mémoire (2002) de Jean Le Bitoux, p. 93). Le goût de Benito Mussolini pour l’Antiquité et sa fascination des beaux athlètes (pensez au Stadio dei Marmi qu’il a fait construire pour le dixième anniversaire de la Marche sur Rome) ou bien d’Hitler pour les beaux sportifs ne font aucun doute. « Toute la mystique hitlérienne était fondée sur l’homosexualité. » (idem, p. 194 ; voir également l’article « Hitler était-il homosexuel ? » dans la revue VSD, du 17 au 23 octobre 2002, pp. 63-65) Lothar Machtan a consacré un ouvrage entier à l’homosexualité d’Hitler dans sa biographie La Face cachée d’Adolf Hitler (2001). Cette thèse déchaîne bien évidemment les foudres de la communauté homosexuelle actuelle (cf. l’édito « Hitler et les talibans » de Thomas Doustaly, dans la revue Têtu, n°60, novembre 2001). À quoi bon montrer qu’Hitler était homosexuel ?, s’indigne-t-elle. Cela ne rajoute rien à l’horreur du personnage, et de surcroît, ne fait que charger inutilement la barque des personnes homosexuelles et convaincre l’opinion publique que l’homosexualité produit des dictatures et des monstres. On peut difficilement soutenir une telle affirmation. À mon sens, il importe peu que l’hypothèse soulevée par le livre de Lothar Machtan soit avérée ou non, puisque, même s’il est fort probable qu’Hitler a été une personne homosexuelle refoulée (quand on lit en intégralité la longue biographie en deux tomes (1999) rédigée par l’historien Ian Kershaw – un ouvrage complètement neutre sur la question de l’homosexualité du « Führer » –, il ne fait aucun doute en effet que la vie d’Hitler comporte de nombreuses coïncidences de l’homosexualité relevées dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels), il est impossible d’assurer qu’il était l’incarnation humaine de « l’homosexuel » ou de « la personne homosexuelle » étant donné que ces deux personnages sont au mieux des mythes, au pire des réalités fantasmées que personne n’arrivera jamais à devenir complètement. C’est précisément le refus de la probabilité qu’Hitler ait pu être homosexuel, non pas parce qu’il était entièrement homosexuel mais simplement du fait de son humanité, qui est inhumain et homophobe. Comme le souligne très finement Gerald Messadié dans sa préface de la biographie La Face cachée d’Adolf Hitler (2002) de Lothar Machtan, « ce menteur dissimulait non pas un vice, mais ce qu’il était contraint de tenir pour un vice : son homosexualité. D’où son inhumanité » (pp. 7-8). Messadié soutient l’idée selon laquelle le rapport idolâtre d’attraction-haine concernant le désir homosexuel, c’est cela qui est inhumain et monstrueux, et non l’homosexualité en elle-même. Reconnaître les tendances homosexuelles d’Hitler, c’est finalement rendre l’homosexualité beaucoup plus humaine et moins monstrueuse que de la nier dans l’angélisme et la diabolisation d’un être humain historiquement figé au rang de « non-personne ». L’anti-fascisme homosexuel est une autre forme de négation du désir homosexuel. Il conduit tout autant à la dérive totalitaire et homophobe que le despotisme montré en tant que tel dans les manuels d’Histoire.
Le lobby gay :
la dictature Rainbow souriante
Qu’en est-il aujourd’hui de la communauté homosexuelle et de cette fusion entre dictature et homosexualité ? Ne concerne-t-elle que les fascismes du passé ? Bien évidemment que non, puisque le désir homosexuel, lui, ne change pas, et est indéfectiblement attiré par le viol, la violence, et le totalitarisme.
Si pendant des siècles les personnes homosexuelles rasaient les murs ou bien habitaient secrètement les palaces, maintenant, elles s’exposent de plus en plus au grand public, et se s’organisent sous forme d’un lobby conquérant, motivé, fier de ce qu’il est, soucieux de tourner la page à un passé diabolisé. Ce n’est qu’après avoir posé les bases d’une dictature communautaire minoritaire que le ghetto gay cherche à s’étendre mondialement, d’une part pour extérioriser ses embarrassants problèmes internes, et d’autre part pour assurer sa survie. Certaines personnes homosexuelles tentent de créer une nouvelle dictature, d’autant plus invisible et violente qu’elle s’affiche comme une anti-dictature.
La minorité « culturelle » homosexuelle actuelle offre une version peu ou prou similaire des anciens totalitarismes du début du XXe siècle. L’Histoire humaine nous montre que de tout temps il n’y a pas eu une seule dictature qui ne se soit pas revendiquée de la démocratie, du progrès, de la justice, de la liberté, et de l’amour, pour asseoir son redoutable humanisme. Les fascismes traditionnels des années 1920-1940 se caractérisaient idéologiquement par le paternalisme, le nationalisme, la négation du pluralisme social, le militarisme, le culte de l’unité et de l’autorité, l’interventionnisme dans la vie privée des individus, le conservatisme religieux, une politique économique d’inspiration corporatiste, etc. Mais chez les terrorismes contemporains (dont la communauté homosexuelle fait souvent partie), nous identifions exactement l’arsenal des anciens fascismes, cette fois remplacé par sa caricature inversée : le matriarcat, la toute-puissance de ceux qui s’étiquettent victimes, le culte du divertissement et de la jouissance orgasmique, l’individualisme infantilisant, l’égalitarisme uniformisant, la « contre-culture » (Michel Foucault, Dits et écrits I (2001), p. 1250) assénant comme poncifs le relativisme culturel et l’acceptation des différences (celles-ci seront généralement niées), le néo-paganisme, l’internationalisation anti-patriotique, la célébration d’un Homme nouveau (« l’homosexuel » dans le cas de la communauté homosexuelle) reposant sur la diabolisation d’un autre Homme nouveau présenté comme préhistorique (« l’hétérosexuel » ou « l’homophobe »), le remplacement des traditions par des mythologies historicistes archaïsantes, l’apolitisme encourageant le développement des extrêmes et « la tyrannie d’une majorité de minorités » (Michel Schneider, Big Mother, Psychopathologie de la vie politique (2002), p. 290), l’anti-totalitarisme moralisant (celui-ci est « le fondement de la censure d’aujourd’hui », comme l’a souligné avec pertinence Élisabeth Lévy dans son essai Les Maîtres Censeurs (2002), p. 19), le rejet systématique du personnalisme politique et du capitalisme libéral pour prescrire un capitalisme permissif et hédoniste fondé sur la libre concurrence et la compétition à outrance (avec à la tête de ce nouveau système « anti-hiérarchique » un roi/reine bourgeois invisible – l’androgyne – que les masses cherchent à imiter collectivement et à détruire symboliquement pour le rendre réel).
Afin de s’imposer, les fondamentalismes actuels font de principes humanistes tout à fait défendables quand ils sont vraiment mis en application (le respect des autres, l’acceptation des différences, la défense des victimes, le partage, la tolérance, le partage égalitaire, etc.) des mots d’ordre qui dictent le Bien et le mal, et qui permettent à ceux qui s’annoncent sous des hospices apparemment démocratiques de se ranger dans le camp qu’ils auront imposé comme « bon » pour se venger d’ennemis imaginaires diabolisés, et se transformer en petits despotes. Par exemple, à force de vouloir à tout prix, pour reprendre les termes de Bertrand Delanoë, « marteler que la diversité est une source inépuisable d’enrichissement collectif » (cf. la préface du Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 7), la communauté homosexuelle en oublie parfois que seuls le respect et la douceur et peuvent laisser aux différences reconnues leur espace d’expression et d’existence. L’accueil des différences, la promotion de la diversité : très bien. Mais à une condition : que soient respectées ces deux notions fondamentales de la Réalité qui lui sont concomitantes : l’unité et l’identité. Sinon, la défense totalitaire des différences nous entraîne vers l’uniformité, paradoxalement au nom de la lutte contre l’uniformel par la vénération poétique de différences abstraites. Nous ne reconnaissons rien et n’unissons rien si nous ne dissocions pas. Par l’emploi du terme flou d’« égalité » (mot absolutisé par les militants homosexuels qui nous parlent souvent d’« égalité totale », « absolue », « pleine »), on remarque une confusion récurrente et dangereuses entre la notion d’« égalité de droits » (légitime à demander, comme nous l’apprennent les Droits de l’Homme) et celle d’« égalité des identités » (illégitime puisque nous sommes chacun et chacune uniques, différents, et n’avons pas les mêmes besoins). C’est ce qui explique que Xavier Lacroix définisse à juste raison l’argument de l’égalité, devenu la marotte du militantisme homosexuel actuel, comme un « rouleau compresseur », un disque uniformisant et diabolisant la légitime hiérarchisation induite par nos préférences et nos distinctes réalités/besoins.
Il est clair que depuis un certain temps, les membres de la communauté homosexuelle n’arrivent pas la fleur au fusil, même si en apparence, ils annoncent les couleurs. Dans l’emblème choisi par les personnes homosexuelles pour les représenter – le fameux Rainbow Flag (le drapeau arc-en-ciel) –, nous retrouvons l’idée de fascisme, avec la décomposition colorée du spectre de la lumière blanche (rappelons que le mot fascisme provient du romain fascio qui signifie « faisceau »). Plus ça va, et plus nous percevons au loin des bruits des bottes et les roulements de tambour de leurs petits soldats de bois : les armées cinématographiques ou musicales « gay » se multiplient dans les fictions homo-érotiques. Leurs chants deviennent de plus en plus belliqueux (« Allons, allons, gays enfants de la patrie, le jour de gloire est bientôt arrivé… », cf. le slogan inscrit sur la pochette de la série de courts-métrages « Courts mais gays » tome 8, 2004) et leurs discours se radicalisent. « Uraniens de tous les pays, unissez-vous ! » (cf. le documentaire-fiction « Race d’Ep » (1978) de Lionel Soukaz et Guy Hocquenghem) Nous les entendons nous prévenir qu’« il faut se méfier des minorités silencieuses » comme la leur (Karin Bernfeld, Apologie de la passivité (1999), p. 30). Même si les militants homosexuels assurent dans un premier temps que leur démarche se situe bien « loin d’une quelconque volonté subversive et révolutionnaire » (cf. l’article « San Francisco » de Cyril Royer, dans le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2002) de Didier Éribon, p. 418), à d’autres moments, ils parlent le plus sérieusement du monde de l’extraordinaire horizon civilisationnel dont ils seraient les dignes représentants : « On voit les immenses possibilités qui s’offrent à nous et nous emportent bien loin des recherches menées en biologie sur le clonage et autres technologies de la reproduction. Nous sommes à un tournant de l’histoire. Depuis la découverte de la pilule et la maîtrise de la fécondité par les femmes elles-mêmes, plusieurs choix s’offrent à nous. Le développement des techniques reproductrices, et leurs insolubles conflits éthiques (comment refuser le ‘progrès’ ?), mais aussi la possibilité de donner d’autres buts à la sexualité que la reproduction. Aujourd’hui, ce n’est plus la survie des sociétés qui est en jeu, mais celle de la planète. Il va falloir réorienter la libido autrement, vers un nouveau rapport à la nature, aux animaux, à l’environnement. Après le matriarcat il y eut le patriarcat. Et après le patriarcat, qu’est-ce qu’il y aura ? Une nouvelle civilisation que nous pouvons déjà pressentir à travers les motivations de nos désirs profonds. » (Marie-Jo Bonnet, Qu’est-ce qu’une femme désire quand elle désire une femme ? (2004), p. 129) Dans leur discours, ils passent en deux temps trois mouvements de la victimisation à la menace expansionniste mégalomaniaque, comme l’illustrent ces propos d’un étudiant français de Sciences Po : « C’est bien de dire ‘Oui, il y en a partout’. Maintenant, on va vous montrer qu’en effet y’en a partout. Et que ces homos parfois qui vous font tant peur, ils arrivent sur le marché du travail et pas n’importe lequel. Et que c’qu’on nous a pas donné, on va peut-être le prendre. Donc s’il s’agit d’avoir un p’tit peu peur pour certains, pourquoi pas ? En tout cas, on arrive, ouais. » (Alex, un témoin homosexuel, dans l’émission Zone interdite, sur la chaîne française M6, en mai 2000) Même si c’est d’abord par l’image que se manifeste le terrorisme, l’objectif de certains est de créer une force politique intimidante dont les personnes transsexuelles seraient les « redoutables » porte-drapeaux : « Ce qu’il faut maintenant, c’est réussir à effrayer à nouveau les gens. Ils se sont habitués aux drags. C’est la seule chose qui m’inquiète. Il faut trouver de nouveaux trucs. » (John Waters dans le documentaire « God Save The Queens », à la Nuit gay de Canal +, le 23 juin 1995)
Conjointement à la demande d’indifférence mutuelle et à la consolidation souterraine, viennent l’exigence de l’ouverture internationale de la communauté homosexuelle et une évangélisation musclée. Les réunions associatives de ses adhérents s’achèvent souvent par des conclusions dignes des grands meeting politiques du Parti Communiste : « Courage mes frères ! La lutte continue ! » (cf. le slogan venant clore le débat sur l’homoparentalité organisé au barLe Cargo d’Angers en 2002) Le lexique du combat y est omniprésent. Des mots d’ordre concis font figure de programme politique. Par exemple, dans le premier numéro de la revue Têtu (juillet 1995), la consigne de l’édito est plus que claire : « Soyez têtus ! » L’appel à l’action s’accompagne de l’idée de dette patriotique : « Maintenant que nous avons fait notre travail et lancé Têtu, à vous de confirmer que la communauté gay et lesbienne existe. » L’identité homosexuelle regarderait tout le monde. Mieux : elle serait tout le monde ! La communauté homosexuelle prend appui sur la fameuse légende qui stipule qu’il y aurait forcément dans tout groupement humain au moins 10% de personnes homosexuelles, pour justifier son prosélytisme mondial. « Il ne faut pas libérer l’homosexuel ; il faut libérer l’homosexuel qu’il y a en chacun ! » (cf. le slogan du groupe Eros en Argentine, dans les années 1970) Elle insiste sur l’urgence de l’action, par exemple dans les milieux scolaires, en se rendant déjà coupable de non-assistance à personnes en danger si elle ne fait pas ce que lui ordonnent ses larmes intérieures. « Ne pas aider les jeunes gays et lesbiennes à accepter leur homosexualité, c’est les livrer à l’homophobie de leurs copains, à l’angoisse d’être différents, voire à la tentation du suicide… C’est surtout manquer gravement à l’éducation affective et sexuelle des adultes de demain. Il y a urgence : les récents actes homophobes nous le rappellent. » (cf. l’article « L’Homosexualité à l’école : Faut-il en parler ? », dans la revue DJ Actu, avril 2004, n°109, p. 3) Il est déjà trop tard pour agir (il aurait fallu prendre « les homos » au berceau…), donc à présent, il s’agit de limiter la casse… et de faire vite ! « Action = Vie » comme dirait Act-Up. Certains militants gay font de leur cas une généralité, de l’exception un exemple, une priorité politique nationale, mais paradoxalement dans une perspective non-universelle, individualiste. C’est là toute la contradiction/l’hypocrisie de leur combat. Le fait de se persuader d’être homos les pousse à en voir partout, ce qui explique qu’ils ne peuvent que penser leur combat pour l’acceptation de l’homosexualité comme juste et majoritaire, même si intellectuellement, ils restent attachés à l’idée de minorité vivant en autarcie en dessous et surtout au-dessus des autres.
À l’extérieur, ils mènent donc une politique expansionniste à travers diverses actions militantes. Rien qu’en France, ils investissent tous les terrains sociaux imaginables : scolaire, associatif, sexuel, économique, religieux, ethnique, professionnel, universitaire, etc. Il faut le reconnaître : la communauté homosexuelle est une franc-maçonnerie comme une autre, avec ses ramifications. Elle possède ses propres librairies, entreprises, musées, villes, quartiers, rassemblements, Jeux Olympiques, etc. Que ce phénomène de lobbying à l’américaine s’explique par une oppression sociale ou un instinct de survie ne change rien à cet état de fait : le sentiment d’exclusion conduit n’importe quel groupe à des unions créant des réseaux de pouvoir. À tous les « paranos » qui les soupçonnent de fomenter un coup d’État mondial, certaines personnes homosexuelles répondent en pouffant nerveusement de rire que le « lobby gay » n’existe pas. Mais, comme au bout d’un certain moment, elles ne peuvent pas nier qu’il y a bien une activité associative homosexuelle relativement importante, elles finissent parfois par avouer à demi-mots que le lobby homosexuel existe très certainement, mais tout de suite après, elles embrayent sur la justification de sa présence par de jolis principes démocratiques et la victimisation, en soutenant qu’il ne dépassera jamais en importance et en cruauté le « lobby non-homosexuel » et qu’il procède d’un processus logique de résistance. « Évidemment, il existe un lobby gay, comme il existe un lobby franc-maçon ! Il est normal qu’une minorité qui a été opprimée s’entraide et se serre les coudes ! » (Pierre Bergé dans l’article « Y a-t-il une culture gay ? », sur la revue TÉLÉRAMA, n°2893, le 22 juin 2005, p. 18) La maxime tacite pour justifier l’établissement d’une force politique gay est donc que la fin (= rendre justice aux victimes que seraient les personnes homosexuelles) justifie les moyens. À partir de là, les membres actifs des commandos homosexuels ne considèrent pas les méthodes expéditives qu’ils mettent en place (zap, dying, interruption de messes, opérations « coup de poing » dans les lieux publics, entartages, outing, Marche des Fiertés, interventions en milieu scolaire, etc.) comme des atteintes à la liberté d’autrui puisqu’elles seraient nées des intentions les plus pures.
Face à ses ennemis, la communauté homosexuelle sait parfois se montrer plus subtile et souriante pour s’imposer. Elle pratique une forme démocratique du totalitarisme : la simulation émotionnelle du sacrifice solidaire. Toute bonne croisade se justifie par le prétexte de la libération des victimes, mais aussi des bourreaux, « dominés eux-mêmes par leur domination » (cf. l’article « Hétérosexisme » de Louis-Georges Tin, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003), p. 210). Même si certaines personnes homosexuelles pensent qu’elles détestent « les hétéros », elles ont quand même la prétention d’être plus charitables qu’eux : elles ne désirent pas les écraser complètement comme eux les ont/auraient jadis soi-disant écrasées, histoire de bien leur montrer que rien n’égalera leur inhumanité. En fin de compte, leur élan vers les personnes dites « hétérosexuelles » n’équivaut pas à un geste de pardon, mais plutôt à un accueil condescendant. Elles les utilisent souvent à des fins pédagogiques et publicitaires. Par exemple, elles aiment montrer des modèles de personnes « homophobes » repentantes faisant leur mea culpa larmoyant devant les caméras en se frappant la poitrine pour toutes les injustices qu’elles leur ont/auraient infligées. Dans certains films, nous assistons à de véritables mises en scène de l’apprentissage : ce sont les personnages homosexuels, en bons maîtres, qui donnent une leçon d’humanité au pseudo « hétérosexuel » aveugle qui recouvre miraculeusement la vue : nous en trouvons une belle illustration avec la scène d’écoute de Maria Callas dans le film « Philadelphia » (1993) de Jonathan Demme. Les militants homosexuels, loin de dénigrer leurs opposants réactionnaires, s’émeuvent à les utiliser pour la propagande, à les convertir. Par exemple, l’article de Libération composé des lettres d’insultes envoyées à Noël Mamère après le mariage de Bègles (cf. l’article « Homophobes en toutes lettres » de Blandine Grosjean, dans le journal Libération, le 22 juin 2004) finit par la remarque attendrissante et insipide d’une mamie de 83 ans (« La démocratie, c’est de ne pas condamner et ne pas s’occuper de la vie privée des gens quand ils ne font de mal à personne. ») … comme pour prouver aux « vieux cons hétérosexuels » qui la lisent qu’il existe parfois des exceptions de « vieux cons » dont ils peuvent exceptionnellement faire partie (s’ils restent sages et obéissants, bien sûr !).
Certes, parler de dictature en ce qui concerne la communauté homosexuelle peut paraître excessif, voire paranoïaque, quand dans la réalité, les personnes homosexuelles sont loin de faire numériquement l’unanimité dans les sociétés où elles vivent. Mais ne nous y trompons pas. Un désir totalitaire de domination peut exister à l’état de fantasme, avec ou sans réalisme, et donc tout à fait émaner d’une minorité, surtout celle qui a actuellement une influence non négligeable dans le monde des symboles sociaux, et donc des désirs collectifs à échelle nationale et internationale. À mon avis, il convient d’ouvrir l’œil sans catastrophisme, de surveiller que la minorité culturelle homosexuelle reste dans des sentiers démocratiques, et de ne pas baisser nos exigences concernant les personnes homosexuelles, non pas parce qu’elles seraient potentiellement dangereuses en elles-mêmes, mais parce qu’elles méritent ces exigences du fait de notre commune humanité, et de leur liberté.
Faut-il avoir peur du Gay Power ?
Tout au long de mes écrits sur les liens non-causaux entre désir homosexuel et viol, j’ai essayé de montrer en quoi beaucoup de personnes homosexuelles, en cherchant à tout prix à être innocentées d’un crime qu’elles ont/auraient subi, sont devenues parfois bourreaux des autres et surtout d’elles-mêmes. Comme l’affirme à juste raison Frédéric Martel dans son essai Le Rose et le Noir (1996), « la dictature de la majorité n’est pas plus enviable que la dictature des minorités. » (p. 713) En apparence, elles ne sont donc pas du tout à plaindre par rapport à des Hommes plus désemparés qu’elles, matériellement du moins. Cependant, je crois qu’elles font partie d’une nouvelle catégorie de personnes violées, non moins importante que les vrais miséreux ou les laissés-pour-compte audiovisuels, puisqu’elle se compose de victimes qui ignorent qu’elles le sont à force d’espérer se substituer aux autres. Elles sont pauvres de la « pauvreté d’Occident » dont parle Mère Teresa, celle qui se subit en se choisissant, et qui concerne le manque de désir du Désir. Elles ont apparemment tout pour elles, mais il leur manque l’essentiel : le manque et l’acceptation de celui-ci. C’est pourquoi elles sont définies à juste titre par Gian-Luigi Simonetti comme des « martyres à la fois symboliques et réels » (cf. l’article « Pier Paolo Pasolini » de Gian-Luigi Simonetti, dans le Dictionnaire de l’homophobie (2003) de Louis-Georges Tin, p. 307). Elles ne maîtrisent pas leur identification à la victime et au bourreau cinématographiques, et actualisent parfois imparfaitement sur elles-mêmes ces deux personnages, de manière souvent inconsciente et violente. Leur entreprise de destruction est dirigée essentiellement vers elles-mêmes. Voilà le drame. « Cet isolement, c’est une sauvagerie, rien d’autre. Oui, une barbarie. Mais inoffensive. À la fin, ça ne détruira que moi. Ce qui m’attend, c’est de me consumer, de m’annuler. » (Leo, l’un des personnages homos du roman Un Garçon d’Italie (2003) de Philippe Besson, p. 66) Si elles ont vengé leur sexe en ordonnant l’assassinat – symbolique et parfois réel – de l’homme (dans le cas des femmes lesbiennes), ou de la femme (pour les hommes gays), le prix de la rébellion sociale par la transgression sexuelle qu’elles ont malgré tout désirée est souvent l’isolement. C’est une réalité déplaisante à voir : beaucoup de personnes homosexuelles relativement âgées se retrouvent finalement toutes seules, sans enfants, sans compagnon de vie, parfois après des années de bons et loyaux services pour la cause gay. Elles préfèrent ne pas se retourner sur leur passé par peur d’éprouver le vertige existentiel qui les a menacées depuis les premiers jours de la découverte de leur liberté. À travers leurs mots, elles expriment souvent un cri semblable à la plainte de Molina dans le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig, celle de l’enfant qui en elles ne demande qu’à naître : « Et ma vie, quand est-ce qu’elle commencera ? Quand est-ce que ce sera mon tour d’avoir quelque chose à moi ? » (p. 239)
2 – GRAND DÉTAILLÉ
FICTION
a) Le père militaire :

Avant de se durcir et de choisir la voie du despotisme, le héros homosexuel montre des antécédents familiaux qui semblent l’avoir prédestiné. Il est en effet fréquent de voir que son père ou/et sa mère se sont comportés en tyrans, ou bien ont exercé le métier de militaire. On trouve la figure du père tyrannique dans le roman Adrienne Mesurat (1927) de Julien Green, le film « Le Cercle des poètes disparus » (1989) de Peter Weir, le roman Dream Boy (1995) de Jim Grimsley, le film « Postcards From America » (1994) de Steve McLean, le film « Dorian Blues » (2005) de Tennyson Bardwell, le film « Une Famille allemande » (2004) d’Oskar Roehler, le film « Footing » (2012) de Damien Gault (le père de Marco est un gendarme à la retraite), la pièce The Importance To Being Earnest (L’importance d’être Constant, 1895) d’Oscar Wilde (avec le père de Jack qui est lieutenant-colonel), etc. « Comme mon père, j’ai horreur d’avoir tort. Mais comme cela n’arrive jamais, je suis finalement très sociable. » (Jarry dans son one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman) ; « C’était un militaire, un homme dur. » (Joe en parlant de son père, dans la comédie musicale Angels In America (2008) de Tony Kushner) ; « Mon père voulait que je devienne militaire de carrière. » (Damien, le travesti M to F, dans la pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; etc.
Par exemple, dans le film « Saisir sa chance » (2006) de Russell P. Marleau, le père de Chance est militaire : ses enfants l’appellent même « chef ». Dans le film « Le Jupon rouge » (1986) de Geneviève Lefebvre, Manuela est traitée de « fille de fasciste ». Dans la pièce très autobiographique Mi Vida Después (2011) de Lola Arias, le père de l’héroïne lesbienne, Vanina, est policier militaire, et a participé au régime de la junte militaire de 1976-1983 en Argentine. Dans le film « Catilina ou le venin de l’amour » (2012) d’Orest Romero, Catalina, fils d’un ancien militaire propriétaire d’un supermarché, décide de se faire passer pour son père pour conquérir Marcus, un jeune garçon qui vient d’être embauché. Dans le film « Xenia » (2014) de Panos H. Koutras, Lefteris Christopoulos, le père de Dany (le héros homosexuel) et de son frère Ody serait un homme politique d’extrême droite. Dans la pièce Un Tango en bord de mer (2014) de Philippe Besson, le beau Vincent raconte que la première fois qu’il a couché homosexuellement, c’était dans un coin reculé d’une plage, à l’âge de 15 ans, avec un homme de 20 ans, Sébastien, qui s’est fait sauter la cervelle un an après avec l’arme de service de son père qui était gendarme. Dans la pièce Hétéro (2014) de Denis Lachaud, le Père 2 (homosexuel) de Gatal (homo lui aussi) écoute de la musique militaire (fanfares) bien fort dans l’appartement… et ordonne à son fils de devenir dur comme lui : « Tu vas me faire le plaisir de t’endurcir, mon fils ! » Dans le téléfilm « Baisers cachés » (2017) de Didier Bivel, Stéphane, le père de Nathan, est un CRS. Dans la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn, Monsieur Groff, le proviseur du lycée de Moordale, est le père d’Adam, l’un des héros homosexuel : il est très froid avec son fils, ne lui témoigne aucune affection, et lui rappelle sans cesse l’ordre : « Tu connais les règles. » (c.f. épisode 1 de la saison 1).
b) Le comportement de vieux gars tyrannique et inflexible :

Film « The Colonel’s Outing » de Jacqui Stanford
Le manque d’amour et de tendresse parentale peut avoir des retombées sur le caractère du héros homosexuel, qui pour le coup devient un « vieux garçon » irascible, qui ne supporte pas de se plier à d’autres désirs que les siens : cf. le film « Oublier Chéyenne » (2004) de Valérie Minetto (avec le personnage de Chéyenne), le film « Une Affaire de goût » (1999) de Bernard Rapp (avec le personnage de Frédéric), le film « Rien sur Robert » (1998) de Pascal Bonitzer (avec Michel Piccoli en écrivain misanthrope et caractériel), le film « Personne n’est parfait(e) » (1999) de Joel Schumacher (avec le personnage de Walt Koontz), le film « Jan-Ken-Senso » (1971) de Shuji Terayama, le film « Menmaniacs » (1995) de Jochen Hick, le film « Crush, le Club des Frustrées » (2001) de John McKay, le film « Au secours, j’ai 30 ans ! » (2004) de Marie-Anne Chazel (avec l’homo vieux gars), le film « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ! » (1982) de Coline Serreau, le film « Swimming Pool » (2002) de François Ozon (avec la rigide romancière Sarah Morton), le film « Dirty Talk » (2012) de Jeff Sumner (avec Nathan, le prof d’anglais secrètement homo et plutôt conservateur), la pièce En ballotage (2012) de Benoît Masocco (avec Édouard, le héros gay, homme politique de droite, refoulant son homosexualité et montré comme guindé), le film « Indian Palace » (2011) de John Madden (avec Graham, le magistrat rigide et homosexuel), etc.
Lui ou bien son entourage le décrit comme un garçon manquant de souplesse, transi de peurs et de complexes : « Ça fait des années qu’on parle : il est psychorigide. » (Manu par rapport à Philippe, dans le film « Comme les autres » (2008) de Vincent Garenq) ; « J’suis insomniaque, psychorigide, maniaque. » (l’un des personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Ta belle-fille est d’extrême droite ? Sois pédé ! » (cf. un couplet de la chanson « Sois pédé » de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Pierre est un vieux garçon, homosexuel. » (Lili dans la pièce Le Clan des joyeux désespérés (2011) de Karine de Mo) ; « Nous, les fiottes, aussi aigres que des griottes, aussi raides que des balais de chiottes… » (les quatre personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Elle [Gabrielle] sait que de tout temps, on l’a considérée comme une femme dure, autoritaire, inflexible et, bien que parfois il lui soit arrivé d’en souffrir, elle en retire aujourd’hui le délicieux bénéfice d’avoir su protéger ses sentiments. » (Élisabeth Brami, Je vous écris comme je vous aime (2006), p. 14) ; « D’ailleurs, je suis facho. » (Suzanne, l’héroïne lesbienne du roman Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 345) ; « J’ai des acouphènes en avion. » (Jean-Paul, le pédé bourgeois du film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier) ; « La musique ethnique… une de tes spécialités… comme la musique militaire. » (Michael parlant à son pote Emory, homo comme lui, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « J’ai jamais vu un mec qui avait l’air aussi propre sur lui et qui était autant bordélique. » (Polly parlant de son meilleur ami gay Simon, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 13) ; « Claude ne sait exister que dans la colère. » (Mike par rapport à Claude, son amie lesbienne, op. cit., p. 107) ; « Tu es absolument paranoïaque. » (Michael, le héros homosexuel s’adressant à son coloc gay Harold, un vieux gars précieux, dans le film « The Boys In The Band », « Les Garçons de la bande » (1970) de William Friedkin) ; « Efficacité allemande typique » (Jane se moquant de la maniaquerie de Petra son amante, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 91) ; etc.
Par exemple, dans la pièce Copains navrants (2011) de Patrick Hernandez, Norbert, le compagnon de Victor, est un vieux gars, ultra-organisé, ingénieur en poêles à frire, coincé, ordonné, ne voulant jamais sortir, regardant Thalassa chaque vendredi soir. Dans le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2010) de Malu de Martino, Julia, l’héroïne lesbienne, décrit son meilleur ami homo Hugo, comme « un tyran » ; elle-même apparaît aux yeux de ses proches comme une femme inflexible, « tendue », intello. Dans le roman L’Hystéricon (2010) de Christophe Bigot, on dit de Jason, l’un des deux héros homosexuels, qu’il est un « petit tyran » (p. 461) : « Dans son obsession du contrôle il avait besoin de prévoir l’imprévisible jusque dans ses moindres détails. » (p. 377) D’ailleurs, Colette, l’héroïne qui lui fait office de grand-mère, l’encourage à être plus flexible, car visiblement, il a du mal à (se) faire confiance : « De la superficialité, bon sang de bonsoir ! De la souplesse ! » (p. 462) Dans le roman Vincent Garbo (2010) de Quentin Lamotta, tous les personnages sont intraitables, orgueilleux (par force ou par faiblesse) : en particulier le personnage de Vincent Garbo, l’arrogance incarnée du séducteur froid (« Vincent Garbo se réserve jusqu’au bout le droit d’écarter les gêneurs. », p. 18), ainsi le personnage d’Emmanuel Montier, vieux gars qui n’a toujours pas « baisé à trente-trois ans » (p. 151), qui a « la manie du rangement des désordonnés profonds » (p. 152). Dans la pièce Carla Forever (2012) de Samira Afaifal et Yannick Schiavone, Christophe, le « copain d’un soir » du héros homo, a voté Le Pen en 2002. Dans le film « Minuit à Paris » (2011) de Woody Allen, les artistes lesbiennes Gertrude Stein, Djuna Barnes…) sont présentées comme des femmes à poigne, capables d’être désagréables. Dans la pièce Sugar (2014) de Joëlle Fossier, Georges est officier ministériel, notaire, obéissant aux règles et aux protocoles. Dans le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki, Stella est taxée de « gouine coincée » par Thor. Dans le film « Imitation Game » (2014) de Mortem Tyldum, le mathématicien homosexuel Alan Turing est un homme inhumain, autoritaire, asocial, se mettant tout le monde à dos : « Plus insupportable que ce type, ça n’existe pas. » (le flic s’adressant à l’inspecteur de police à propos de Turing) Dans la pièce Les Faux British (2015) d’Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, Thomas, le héros homosexuel, est décrit comme invivable : « Quel insupportable bonhomme ! » s’exclame Helmer.
Dans la pièce Gouttes dans l’océan (1997) de Rainer Werner Fassbinder, les deux membres du couple homo, Franz et Léopold, se transforment l’un au contact de l’autre en despotes car ils n’osent pas s’avouer qu’ils n’ont rien à faire ensemble et qu’ils s’insatisfont : Franz a des troubles obsessionnels de femme au foyer (« Il y a encore quelque chose qui ne va pas !! » « Dois-je faire encore quelque chose ??? »), il tourne en rond dans l’appart, et ne sait pas comment contenter son amant Léopold ; quant à ce dernier, il manipule complètement son cercle libertin – composé d’Ana, de Véra et de Franz – et ne fait pas secret de sa rigidité : « Je suis toujours aussi épouvantablement nerveux. »
Dans le film « Noureev, le Corbeau blanc » (2019) de Ralph Fiennes, le danseur et chorégraphe homo Rudolf Noureev est montré comme un génie parce qu’inflexible, intraitable et maniaque. C’est un peu hallucinant. Par exemple, il fait une scène dans un restaurant de luxe spécialisé dans la gastronomie russe, parce qu’il refuse de manger de la viande avec de la sauce au poivre… : « Je déteste la sauce !!! ». Il pique une crise pour que son amie Clara Saint se plaigne auprès du restaurateur à sa place.
c) Esprit de conquête et orgueil :

Film « Avant la nuit » de Julian Schnabel
Le mal-être existentiel du héros homosexuel peut prendre chez lui la forme de l’orgueil offensif : « J’étais Marlon Brando. Un vieil homme qui avait de la classe et de la cruauté. Un vieil homme irrésistible, généreux, impitoyable, sanguinaire. » (Omar après avoir tué son amant Khalid, dans le roman Le Jour du Roi (2010) d’Abdellah Taïa, p. 168) ; « Ce costume n’a pas assez d’ampleur. Je voudrais une traîne de 2 mètres. Et une capeline avec une violette qui me couvre jusqu’aux chevilles. Je parlerai à l’intérieur dans un micro. Je serai trop intimidée. » (la Comédienne dans la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi) ; « Quand je prends une décision, je suis pire que Napoléon. » (cf. la chanson « No Hay Marcha En Nueva York » du groupe Mecano) ; « J’aime soumettre. J’aime imposer. » (Simone dans la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer) ; « Je n’admets pas qu’on menace mes résolutions. » (cf. la chanson « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer) ; « J’aime pas quand on m’impose un truc. » (Pierre, le héros homosexuel de la pièce Le Fils du comique (2013) de Pierre Palmade) ; « Je suis un homme hyper nerveux. » (la figure d’Anton Tchekhov, dans la pièce Anton, es-tu là ? (2012) de Jérôme Thibault) ; « Tu n’as pas le goût du pouvoir ? » (Horacio s’adressant à Silvano qui ne se laisse pas draguer par lui, dans la pièce La Vie est un tango (1979) de Copi) ; « Cocteau est décidément une brute, un saligaud ! » (Érik Satie dans la pièce musicale Érik Satie… Qui aime bien Satie bien (2009) de Brigitte Bladou) ; « C’est Claude que je trouve minable. Elle ne sait exister que dans la colère. » (Mike, le narrateur homosexuel parlant de son amie lesbienne, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 107) ; etc.
Le héros homosexuel a tendance à tenir le discours de la conquête (en général la conquête par la voie de la séduction). C’est le cas par exemple dans la pièce Dialogue aux enfers (1864) de Maurice Joly, avec l’ambigu et diabolique Machiavel cherchant à convaincre Rousseau. C’est parfois le feu dévorant de son amour passionnel et possessif qui pousse le protagoniste à se braquer : cf. le film « Charlotte dite ‘Charlie’ » (2003) de Caroline Huppert (avec l’envahissante et rigide Charlotte), le film « Je te mangerais » (2007) de Sophie Laloy (avec Julie en proie aux griffes d’Emma, son oppressante colocataire), le film « Intrusion » (2007) d’Artemio Benki, le film « Kaboom » (2010) de Gregg Araki (avec Stella et la vénéneuse Lorelei), etc. Dans le film « Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant » (« Les Larmes amères de Petra von Kant », 1971) de Rainer Werner Fassbinder, plus Petra prétend aimer Karin, plus elle entre dans la spirale du despotisme. Dans le film « Children Of God » (« Enfants de Dieu », 2011) de Kareem J. Mortimer, le pasteur Ralph, marié avec enfants, fait des prêches d’autant plus virulentes qu’il masque sa pratique homosexuelle privée. Dans le film « Avant la nuit » (2000) de Julian Schnabel, Johnny Depp joue deux rôles différents, celui de Bonbon le travesti M to F puis celui du lieutenant inflexible et homophobe. Dans la série House of Cards, Kevin Spacey, homosexuel, joue le président des États-Unis.

Photo Le Festin des Barbares de Rancinan
En amour comme en société, le protagoniste homosexuel prétend avoir tous les pouvoirs : « C’est bien le curieux de la nature humaine qui porte souvent plus d’intérêt à la conquête qu’à ce qui pourtant déjà existe, si beau, dans sa maison. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 70) ; « Malgré les bonheurs que Marie me donnait tous les jours, ce bel amour simple ne me suffisait déjà plus. Cette inclination que j’ai pour la conquête est sans doute le pire. Je me sens toujours amoureuse du plus difficile, de l’impossible même, et donc condamnée à n’être jamais comblée. » (idem, p. 204-205)
Par exemple, dans le roman Le Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, Suzanne, l’héroïne lesbienne, évoque « sa tendance à tout régenter » : « La seule différence entre maintenant et ma lointaine enfance, c’est que je domine plus subtilement. J’ai acquis du savoir-faire. » (p. 25)
Certains personnages homosexuels sont attirés par le terrorisme : cf. le film « Hantise » (1998) de Jan De Bont, film « Tu marcheras sur l’eau » (2005) d’Eytan Fox (avec les attentats contre les néo-Nazis), le film « Matador » (1985) de Pedro Almodóvar, le film « Tesis » (1996) d’Alejandro Amenábar, le roman Le Portrait de Dorian Gray (1890) d’Oscar Wilde (Dorian Gray, par sa beauté, inspire la « terreur » à Lord Henry), le one-woman-show Femmes de pouvoirs, pouvoirs de femmes (2013) d’Océane Rose-Marie, etc. « Je voulais une panique. Je voulais que ça flambe et que les gens aient vraiment peur. » (Julien Brévaille, le personnage homosexuel incendiaire du roman Portrait de Julien devant la fenêtre (1979) d’Yves Navarre, p. 136)
d) L’architecte :
Le personnage homosexuel est tellement soucieux de tout contrôler dans sa vie et ses amours qu’il exerce souvent le métier d’architecte : cf. le film « It’s My Party » (1996) de Randal Kleiser, le film « Le Tuteur » (1996) de Fabien Onteniente, le film « Un de trop » (2000) de Damon Santostefano, le film « Cat People » (« La Féline », 1942) de Jacques Tourneur, le roman El Beso De La Mujer-Araña (Le Baiser de la Femme-Araignée, 1976) de Manuel Puig, le film « Le Vent de la nuit » (1998) de Philippe Garrel, la pièce Le Roi Lune (2007) de Thierry Debroux, le film « Hammam » (1996) de Ferzan Ozpetek (avec le film Francesco), le film « Poséidon » (2005) de Wolfang Petersen, le film « Un Couple presque parfait » (2000) de John Schlesinger, le film « La Souris » (1997) de Gore Verbinski, le film « Clara Es El Precio » (1975) de Vicente Aranda (avec Juan, l’architecte homosexuel), le film « You Belong To Me » (2009) de Sam Zalutsky, le film « Les Biches » (1967) de Claude Chabrol (où le jeune architecte Paul est au centre de l’amour lesbien entre Why et Frédérique), le film « A Single Man » (2009) de Tom Ford (Jim, le copain de George, était architecte), la pièce Cosmopolitain (2009) de Philippe Nicolitch (avec le personnage de Jean-Luc), la pièce Perthus (2009) de Jean-Marie Besset, le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta (où Luther, l’un des héros homos, est architecte), le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier (avec Kim, l’héroïne lesbienne, qui est présentatrice télé et anime une émission d’architecture Des Maisons et des Hommes), le film « Frauensee » (« À fleur d’eau », 2012) de Zoltan Paul (avec Kirsten, la maîtresse de Rosa, qui est une architecte de renom), le téléfilm « Ich Will Dich » (« Deux femmes amoureuses », 2014) de Rainer Kaufmann (avec Marie, l’héroïne lesbienne architecte), l’épisode 91 « Retour vers le futur : 1998-2018 » de Joséphine ange gardien (avec Ismaël, l’ange gardien gay), etc. « Si un architecte a bâti une maison et qu’elle s’écroule, entraînant la mort de celui qui l’habite, l’architecte sera mis à mort. » (Laura à son amante Sylvia, dans le roman Deux femmes (1975) de Harry Muslisch, p. 88) ; « J’adore l’ARCHITECTURE de la bibliothèque. » (Bosley dans le roman Le Musée des amours lointaines (2008) de Jean-Philippe Vest, p. 45) ; « Il est architecte. Il va faire l’architecte. » (Sara en parlant de son fils gay Malik aux tantes de ce dernier, dans le film « Le Fil » (2010) de Mehdi Ben Attia) ; « J’étais chez Marmeladi. […] Il m’a dit qu’avec le temps tu étudieras l’architecture. En tout cas, tu as des dons pour ce qui est décoratif. Tu as de la chance. » (Mirna à Ernestito, homosexuel, dans l’autobiographie Folies-Fantômes d’Alfredo Arias, p. 267) ; « À l’époque, je rêvais d’être architecte. » (Damien, le héros travesti M to F parlant de son enfance, dans le pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine) ; « Les architectes adorent le cinéma. » (la figure de Sergueï Eisenstein, homosexuel, dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway) ; « Smokrev revint fréquemment dans la boutique. Il achetait toujours quelque chose : un jour une collection de gravures sur l’architecture viennoise, le lendemain, une biographie des compositeurs d’opéras italiens, etc. » (Pawel Tarnowski, homosexuel continent, dans le roman Sophia House, La Librairie Sophia (2005), p. 299) ; « Restez, ordonna Smokrev avec une sévérité efféminée. » (idem, p. 481) ; « J’voulais faire une école d’archi… mais faut le bac pour ça. » (Victor, le héros homosexuel ado, qui finira à l’âge adulte par devenir architecte, dans le téléfilm Fiertés de Philippe Faucon, diffusé sur Arte en mai 2018) ; « En fait, je suis architecte. » (Tareq, le héros homosexuel syrien, dans le film « A Moment in the Reeds », « Entre les roseaux » (2019) de Mikko Makela) ; etc.
Par exemple, dans le roman La Désobéissance (2006) de Naomi Alderman, Ronit, l’héroïne lesbienne, cherche à provoquer des convives à un dîner, en leur annonçant abruptement son homosexualité par l’entremise d’un mensonge : elle fait croire qu’elle a « une amante architecte imaginaire » (p. 140) : « ‘En fait, je suis lesbienne. Je vis avec ma compagne à New York. Elle s’appelle Miriam. Elle est architecte.’ Ce n’est pas vrai. Ça n’a jamais été vrai. J’ai connu une Miriam, il y a longtemps, mais nous n’avons pas vécu ensemble. Quant à l’architecte, c’était une autre femme. » (p. 123)
Dans la pièce The Mousetrap (La Souricière, 1952) d’Agatha Christie (mise en scène en 2015 par Stan Risoch), Christopher Wren, le héros homosexuel hyperactif, est architecte et dit qu’il doit son nom au célèbre architecte du même nom. Ce jeune homme est présenté comme « un jeune architecte très prometter qui a conçu la Cathédrale de Saint Paul à Londres ». Pour la petite histoire, l’acteur qui joue l’architecte dans le film « Titanic » (1997) de James Cameron, Victor Garber, est gay. Dans le téléfilm nord-américain The Christmas House (Duel à Noël chez les Mitchell, 2022) de Rich Newey, Jake, le mari de Brandon, est architecte.
e) Maniaque de la propreté :

Major Weldon dans le film « Reflets dans un œil d’or » de John Huston
Par ailleurs, un certain nombre de personnages homosexuels se montrent hyper maniaques et obsédés par la propreté : cf. la pièce Burlingue (2008) de Gérard Levoyer (avec Simone, la maniaque du rangement), le film « La Ley Del Deseo » (« La Loi du désir », 1986) de Pedro Almodóvar (avec le personnage hypocondriaque et hygiéniste d’Antonio), le film « Reflection In A Goldeneye » (« Reflets dans un œil d’or », 1967) de John Huston (avec l’inflexible major Weldon, homosexuel très refoulé, ventant les mérites d’un monde aseptisé), la pièce Attachez vos ceintures (2008) de David Buniak (avec le vendeur en prêt-à-porter), le film « Les Derniers Aventuriers » (1969) de Lewis Gilbert (avec les lesbiennes auto-stoppeuses agressives et obnubilées par la propreté), la comédie musicale À voix et à vapeur (2011) de Christian Dupouy (avec le couple homosexuel déguisé en femmes de ménage maniaques de la propreté, les « Blues Brosseuses » : « On nettoie tout, tout, tout. ») ; « Personne n’a une porte de vestiaire aussi nickel que toi, Romain ! » (Martial se moquant de Romain, le héros homosexuel, dans la B.D. Pressions & Impressions (2007) de Didier Eberlé, p. 11) ; « Il était conscient de cet arôme qu’il dégageait […], mais cela allait-il jusqu’à la hantise, jusqu’à la propreté maniaque ? » (Jean-Marc par rapport à son amant Michael, dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, p. 223) ; « C’est un cauchemar, la ligne 13… Et puis l’odeur… C’est une horreur. » (Samuel Laroque dans le one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « Sylvia présenta bientôt les symptômes d’une manie de nettoyage. » (Laura à propos de son amante Sylvia, dans le roman Deux femmes (1975) de Harry Muslisch, p. 121) ; « J’aime être propre : avant et après. […] La douche, c’était le grand moment. » (Eloy, le prostitué homosexuel, un fou des douches, et racontant ses habitudes en amour, dans le film « Esos Dos » (2012) de Javier de la Torre) ; etc.
Par exemple, dans le film « On ne choisit pas sa famille » (2011) de Christian Clavier, Jean-Paul, le prototype du pédé nouveau riche bobo, pro-humanitaire en théorie mais pas du tout en pratique, refuse de quitter son petit confort bourgeois pour partir à l’étranger accompagner le couple lesbien dans sa démarche d’adoption : « T’as plongé dans cette eau dégueulasse ??? » Dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, Anamika, l’héroïne lesbienne, se bat pour que les femmes s’épilent sous les aisselles. Dans le film « Les Garçons et Guillaume, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, lorsque le héros raconte son deuxième « plan cul », il dit qu’il est tombé sur un mec qui lui a fait prendre une douche avant de faire l’amour parce que « c’était plus hygiénique », et qui l’a fait languir pendant un long moment parce qu’il a lui aussi pris une douche interminable : il est tombé sur un véritable « Monsieur Hygiène ». Dans la pièce À partir d’un SMS (2013) de Silas Van H., Jonathan est ultra-maniaque, veut toujours avoir une haleine fraîche, est très sensible aux odeurs : « Pourvu qu’il y ait pas d’odeur… » dit-il après avoir chié juste à côté de son copain. Dès le début de la pièce À quoi ça rime ? (2013) de Sébastien Ceglia, Bernard, le héros homosexuel, débarque sur scène avec son plumeau rose qu’il passe dans tout l’appartement. Dans la pièce Un Cœur en herbe (2010) de Christophe et Stéphane Botti, Jacques, l’écrivain homosexuel quinquagénaire, évoque « son obsession pour le rangement, le ménage ». Dans le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson, Frankie, le héros homosexuel, a du mal à se tenir droit, et à rester droit… si bien qu’il se croit atteint de vertiges et de signes physiques montrant qu’il est malade du Sida. Son hypocondrie le pousse à voir des risques de contagion partout. Il se scrute sans arrêt la peau dans le miroir pour y voir des taches. Dans son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca, homosexuel, est très à cheval sur l’hygiène. Dans la pièce Soixante degrés (2016) de Jean Franco et Jérôme Paza, Damien, l’un des héros bisexuels, est un maniaque de la propreté. Il fait d’ailleurs de régulières rencontres troublantes avec Rémi dans une laverie.
Dans le film « Boys Like Us » (2014) de Patric Chiha, Rudolf, l’un des héros gays, autrichien, est un homme maniaque : il aspire méticuleusement la poussière sur chacun des livres de sa bibliothèque, vénère les principes (il parle de « son obsession des règles » et sort cette maxime : « L’ordre, c’est la beauté. »), se présente comme quelqu’un d’intransigeant (« Je suis très rigoureux et organisé. »). Ses amis homos Nicolas et Gabriel apprennent à faire avec : « C’est moi ou sa peine de cœur le rend encore plus psychorigide ? » demande Nicolas ; ce à quoi Gabriel lui répond « Il est un peu névrosé, c’est tout ».
Chez l’homosexuel fictionnel, la faute de goût ou de « savoir-vivre » peut être décisive dans le choix ou l’abandon de l’amant : « J’aime qu’elles sachent manger. […] Le test de la table sert à donner des indications sur la sensualité. » (Suzanne en parlant de ses amantes, dans le roman Le Journal de Suzanne (1991) d’Hélène de Monferrand, p. 237) ; « J’ai l’amour de la netteté et de la fraîcheur. Or, la vulgarité des hommes m’éloigne ainsi qu’un relent d’ail, et leur malpropreté me rebute à l’égal des bouffées d’égouts. » (Renée Vivien, La Dame à la Louve (1904), p. 24) ; « C’est pas que je sois obsessionnel mais chez moi, c’est ‘no concession’ sur la propreté ! » (Jarry dans son one-man-show Entre fous émois (2008) de Gilles Tourman)
f) Le militaire homosexuel :

Film « East West Palace Palais » de Zhang Yuan Zhang Yuen
Souvent, dans les fictions homo-érotiques, le militaire ou le flic est homosexualisé, présenté comme une grande tapette : cf. le film « New York City Inferno » (1978) de Jacques Scandelari (avec le flic voyeur en train de se rincer l’œil en observant les coïts homos dans les docks), le one-man-show Le Comte de Bouderbala (2014) de Sami Ameziane (avec le flic homo), le film « Cibrâil » (2010) de Tor Iben, la chanson « La Folle du régiment » de Michel Sardou, la pièce Les Z’héros de Branville (2009) de Jean-Christophe Moncys (avec l’amour entre les deux militaires, le colonel Crevard et le Vieux Con), la série Les Bleus, premiers pas dans la police (2006-2010) d’Alain Robillard (avec Kévin et Yann, les deux flics en couple), le film « Freier Fall » (« Free Fall », 2014) de Stéphane Lacant (avec le couple de CRS à l’allemande, Engel et Marc), le film « Hard » (1998) de John Huckert, le film « Túnel Russo » (2008) de Eduardo Cerveira, le roman At Swim, Two Boys (Deux garçons, la mer, 2001) de Jamie O’Neill (avec Kettle, le militaire homo efféminé), le film « Pauline » (2009) de Daphné Charbonneau (avec Pauline, l’héroïne lesbienne déguisée en soldat marin), la pièce L’Homosexuel et la difficulté de s’exprimer (1971) de Copi (avec Garbenko et Pouchkine, les militaires à la sensibilité de jeune fille), le film « RTT » (2008) de Frédéric Berthe (avec les deux flics « homos » ; l’un finit par se prendre à son rôle), le film « L’Immeuble Yacoubian » (2006) de Marwan Hamed (avec le flic militaire homo), la pièce Et Dieu créa les folles (2009) de Corinne Natali (avec Frédérique policière lesbienne), le film « Mambo Italiano » (2003) d’Émile Gaudreault (avec Nino, le policier homosexuel), le film « Fiesta » (1995) de Pierre Boutron (avec le colonel Masagual, un officier franquiste pédéraste), le sketch du « Colonel » de Pierre Palmade, la pièce Tante Olga (2008) de Michel Heim (avec le lieutenant Kalashnikov), le roman La Nuit du décret (1981) de Michel del Castillo (avec le policier franquiste homo), le film « Haltéroflic » (1982) de Philippe Vallois (avec le personnage du flic homo), le film « Sergent » (1967) de John Flynn, le film « Magnum Force » (1973) de Ted Post (avec les quatre policiers fascistes), le film « Y’a plus de trou à percer » (1971) de J. Johnsone (avec le policier homo), le film « La Bidasse » (1982) d’Howard Zieff, le film « Colonel Redl » (1985) d’Istvan Szabo, le film « Spionage » (1955) de Franz Antel, le film « Les Hommes de sa Majesté » (2001) de Stefan Ruzowitzky (avec l’équipe travestie de soldats américains), le film « Operación Gonada » (2000) de Daniel F. Amselem (avec le militaire fasciste et homo), le roman Dix Petits Phoques (2003) de Jean-Paul Tapie (avec l’adjuvant Diaz, homosexuel homophobe), le film « La Perm » (1990) d’Eytan Fox (avec le lieutenant macho), le film « Un Chant d’amour » (1950) de Jean Genet (avec le flic homo), la pièce La Estupidez (2008) de Rafael Spregelburd (avec le couple des deux flics gay Wilcox et Zielinsky), le film « Nous étions un seul homme » (1978) de Philippe Vallois, le film « Caballeros Insomnes » (« Les Chevaliers insomniaques », 2012) de Stefan Butzmühlen et Cristina Diz (avec le jeune policier homosexuel, Juan), la chanson « Marcel » de Bobby Lapointe (dans laquelle « faire le coup du légionnaire » se réfère à la sodomie), la chanson « Mathématiques souterraines » d’Hubert-Félix Thiéfaine (avec la flic lesbienne), le film « Private Romeo » (« Soldat Roméo », 2011) d’Alan Brown (Huit cadets sont livrés à eux-mêmes dans un camp d’entraînement militaire), la série In Traitement (2008) de Rodrigo Garcia (avec Alex, le policier militaire gay), le roman Une Histoire d’amour radioactive (2010) d’Antoine Chainas (avec les deux flics homos), le film postiche « Servir et protéger » dans le film « In & Out » (1997) de Frank Oz (avec les deux militaires Dany et Billy), le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee (avec Wilma, le flic travelo), le film « Love Is Strange » (2014) d’Ira Sachs (avec les deux flics homos en uniforme, Ted et Roberto, qui vivent en couple), la pièce Le Cheval bleu se promène sur l’horizon, deux fois (2015) de Philippe Cassand (avec l’adjuvant qui est un homme travesti, portant des talons hauts et du rouge à lèvres), etc.
Film « Honeypot » (2010) de Nghi Huynh
« Les deux chefs des armées russe et américaine [les amiraux Smutchenko et Smith], assez semblables entre eux, blonds, s’avancèrent se tenant par le bras. Deux interprètes du sexe féminin brunes les suivaient. » (Copi, La Cité des Rats (1979), p. 113) ; « Jane se demanda s’il était homo. » (Jane, l’héroïne lesbienne face à un policier, dans le roman The Girl On The Stairs, La Fille dans l’escalier (2012) de Louise Welsh, p. 151) ; « Je rêve d’être policier. » (Frank, le héros homosexuel, dans le film « Glückskinder », « Laissez faire les femmes ! » (1936) de Paul Martin) ; etc.
Par exemple, dans la comédie musicale Frankenstein Junior (2012) de Mel Brooks, Ziggy, l’homosexuel de service, est le bras droit du gendarme boiteux. Dans la nouvelle « Mémoires d’un chiotte public » (2010) d’Essobal Lenoir, deux flics, nommés Pastis et Pandrax (un duo de vigiles de la brigade du S.A.C. – Sécurit Alarme Cabinet) s’envoient en l’air dans des toilettes publiques : « Nos deux superflics s’embrassaient sur la bouche à la russe. » (p. 91) Dans le film « 30° Couleur » (2012) de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue, le flic au commissariat martiniquais se travestit. Dans le film « Un Héros très discret » (1995) de Jacques Audiard, le Capitaine plaque tout pour suivre un bel Américain : « Il s’appelle Marlon, il a 20 ans, il vient de Virginie, il est beau comme un char d’assaut. Il me fait découvrir le jazz et le charme violent des armées victorieuses. Ah, Albert, l’amour, l’amour ! » Dans le film « Pas si grave » (2002) de Bernard Rapp, Leo est troublé par le beau policier espagnol qui, le soir venant, se travestit dans un cabaret. Dans le roman La Conjuration des imbéciles (1981) de John Kennedy Toole, le premier homosexuel qu’Ignatius, le héros, voit dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans est marin : pour lui, c’est la preuve que tous les militaires sont des homos.
Le militaire gay est souvent une projection du héros homosexuel lui-même, qui lui attribue ses propres fantasmes de dictature et de luxure. On le voit très clairement dans le film « Je t’aime toi » (2004) d’Olga Stolpovskay et Dmitry Troitsky, quand Timofeï, le héros découvrant son homosexualité, s’imagine, pendant qu’il est en voiture, un agent de la circulation lui faire de l’œil. Dans le film « Cloudburst » (2011) de Thom Fitzgerald, Stella, l’une des deux héroïnes lesbiennes, traite le flic Tommy de « suceur de bites ». Dans le film « Cruising » (« La Chasse », 1980) de William Friedkin, sont filmées des soirées « Nuit de la Police » SM où tous les clients homos sont déguisés en flics, en Nazis ; et les flics se font traiter de « pédés » par les travestis (à raison parfois car certains se font passer pour des policiers sur les lieux de drague homo pour « tirer leur coup » incognito…). Dans son one-woman-show Wonderfolle Show (2012), Nathalie Rhéa, l’héroïne lesbienne, compare le flic qui l’arrête en bagnole à un viril chanteur des Village People. Dans le film « L’Homme blessé » (1983) de Patrice Chéreau, sur les lieux de drague homo, et notamment les gares, Jean, le héros homosexuel, fait semblant de « faire flic » pour se prostituer et détrousser ses amants de passe.
Bien des personnages homosexuels se voient dans la peau d’un militaire ou d’un policier (figure parfois allégorisée par une femme fatale incestueuse) : « La femme démente avec une tenue incroyable… c’est la police. » (cf. une réplique de la pièce La Mort vous remercie d’avoir choisi sa compagnie (2010) de Philippe Cassand) ; « J’étais devenu flic pour retrouver ma mère. » (Steven, l’un des héros homos du film « I Love You Phillip Morris » (2009) de Glenne Ficarra et John Requa) ; « J’me serais très bien vu en militaire. » (Zaza Napoli dans la pièce La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret) ; « Pédépolis : tout le monde est gay, même la police. » (l’un des personnages homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Salut les gouines ! » (Anthony Kavanagh saluant deux femmes flics, dans son one-man-show Anthony Kavanagh fait son coming out, 2010) ; « Je veux devenir un playboy professionnel […] j’entrerai dans l’armée. […] Ce sera que pour fréquenter l’école militaire. Pour m’entraîner et avoir un corps magnifique. Je veux dire un corps rude et robuste comme le vôtre. » (Anamika, l’héroïne lesbienne, à Adit, le père de son meilleur ami, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 206) ; « J’m’en fous, j’suis goudou. » (la contractuelle dans « Very Bad Blagues » : Quand on prend une amende ») ; etc.
g) Le soldat-paon :

Le « Livre blanc » de Copi (Geraldas von Stroessner, ex-dictateur latino-américain)
L’identification au despote orgueilleux se fait par le biais du sentiment amoureux esthétisé sous la forme d’un animal : le paon : cf. la couverture du premier album de Christophe Willem (où le chanteur apparaît déguisé en militaire bobo, entouré de plumes de paon), le one-man-show Comme son nom l’indique (2008) de Laurent Lafitte (avec Michael, le chorégraphe despotique très plumé), le spectacle musical Yvette Leglaire « Je reviendrai ! » (2007) de Dada et Olivier Denizet, la couverture de l’album Histoires naturelles de Nolwenn Leroy, le roman Le Cri de l’ôtruche (2007) de Claude Gisbert, la comédie musicale Panique à bord (2008) de Stéphane Laporte (avec la « dame à plumes »), la chanson « Mon truc en plume » de Zizi Jeanmaire, la pièce À trois (2008) de Barry Hall, le roman Les Paons (1901) de Robert de Montesquiou, la nouvelle Les Paons (1968) de Yukio Mishima, la pièce Morir Por Cerrar Los Ojos (1968) de Max Aub (avec la description du sergent-paon, se pavanant de manière très efféminée), le one-woman-show Vierge et rebelle (2008) de Camille Broquet (et la Tata Louise autoritaire, avec « sa plume dans le cul »), le film « Œufs de l’autruche » (1957) de Denys de La Patellière, la pièce Les Œufs de l’autruche (1948) d’André Roussin, le film « Une Poule, un train et quelques monstres » (1969) de Dino Risi, le spectacle de marionnettes L’Histoire du canard qui voulait pas qu’on le traite de dinde (2008) de Philippe Robin-Volclair (avec les deux marionnettes plumées Édouard et Luigi), le tableau Messe en sol mineur (1972) de Jacques Sultana, le film d’animation « Là-haut » (2009) de Pete Docter et Bob Peterson (avec Kévin, l’homme-paon), le film « Rose et Noir » (2009) de Gérard Jugnot (avec Myosotis, l’homme-paon), la pièce La Cage aux folles (1973) de Jean Poiret (avec Jacob, le domestique, imitant le paon), le film « Hôtel Woodstock » (2009) d’Ang Lee, la pièce Dans la solitude des champs de coton (1987) de Bernard-Marie Koltès (à un moment, l’un des héros homos est comparé à une poule), le one-(wo)man-show Charlène Duval… entre copines (2011) de Charlène Duval, la pièce La Pyramide ! (1975) de Copi (avec le Jésuite et sa plume de paon), le recueil d’illustration Un Livre blanc (2002) de Copi (avec Geraldas Von Stroessner, ex-dictateur latino-américain, s’attaquant à un paon), la nouvelle « Virginia Woolf a encore frappé » (1983) de Copi (avec les hommes portant des masques de plume dans la boîte gay), le one-man-show Ali au pays des merveilles (2011) d’Ali Bougheraba (avec la chambre de son héros homosexuel, Fayssal, avec « des plumes, des plumes partout »), la comédie musicale La Belle au bois de Chicago (2012) de Géraldine Brandao et Romaric Poirier (avec Philippe qui fait le pompier-paon), le vidéo-clip de la chanson « It’s OK To Be Gay » de Tomboy, le film « Métamorphoses » (2014) de Christophe Honoré (avec l’homme aux 100 yeux, qui se métamorphose en paon), le film « Guillaume et les garçons, à table ! » (2013) de Guillaume Gallienne, le film « Test : San Francisco 1985 » (2013) de Chris Mason Johnson (avec les plumes de paon traînant dans les loges des danseurs homosexuels), le film « Certains l’aiment chaud » (1959) de Billy Wilder, la pièce Drôle de mariage pour tous (2019) de Henry Guybet (c.f. le tableau du paon ou de l’autruche accroché au mur du salon), le film « Le Bal des 41 » (« El Baile de los 41 », 2020) de David Pablos (avec les paons peints sur le paravent de la maison d’Ignacio, ainsi que les plumes de paon sur la coiffe de la cantatrice gay travestie), le film « Miss » (2020) de Ruben Alves (avec le tableau final du concours de Miss France), etc.

Le « Livre blanc » de Copi
Le totalitarisme du personnage homosexuel psychorigide s’annonce par la voie de la douceur du paon plumé, de la séduction caressante du travesti (cf. je vous renvoie au code « Douceur-poignard » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Il est tout mielleux et doucereux avant de frapper : « J’ai un pillow en plumes en forme de lune, en forme de dune, refais le geste. » (cf. la chanson « Appelle mon numéro » de Mylène Farmer) ; « Le huitième jour, une odeur de vanille fait surgir l’image de ta mère. Lorsque l’effluve s’agrémente d’un soupçon de bois de rose, l’image prend du relief. Statufié dans ton sommeil, tu jurerais qu’elle te fait face, que ses boucles noires titillent tes joues comme des plumes. » (cf. la description de la mère de Félix, le héros homosexuel, dans le roman La Synthèse du camphre (2010) d’Arthur Dreyfus, p. 167) ; « Nous vîmes de notre cachette […] un thon à pieds de cochon et tête de mule, un éléphant à tête d’homme dont la trompe finissait par un ongle, un crapaud à queue de paon et tête de dinde, un griffon tel quel, une femme à queue et tête de kangourou portant un grand scorpion à tête de coq dans sa poche, et parmi eux le Dieu des Hommes avec les deux têtes du caniche et du fox-terrier à la place de la sienne, et une queue de lézard, et j’en passe des plus bizarres, telle une tortue de mer à tête de queue de poisson. » (Gouri décrivant le « Dieu des Hommes », dans le roman La Cité des rats (1979) de Copi, p. 135) ; « Je commence à m’arrêter de plus en plus souvent, dès que je vois une branche de libre. Et j’y trouve des gens qui me ressemblent, des camarades qui ont des muscles meurtris à force de voyager. Et je reste avec eux, piailler, sautiller, changer de branche quand le temps nous le concède. Alors il pleut souvent. Nos plumes deviennent grises. Alors, peu à peu, je viens chez vous. » (Copi, La Journée d’une rêveuse, 1968) ; « Goliatha, vous êtes une autruche ! » (« L. » dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi) ; « Personne n’est un paon royal. » (Cachafaz, l’un des héros homosexuel de la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « Hier soir j’étais sorti de mon œuf… Je crois bien que c’était un œuf, alors ils m’ont dit : tu iras à la guerre ! […] Moi, la guerre, je n’en connaissais rien. Je ne savais même pas où ça se passait ! […] Alors je me suis mis à voler. J’y prends un plaisir fou […] moi je planais comme un dingue. […] Mais cette vie-là ça m’a fatigué vite. Je commence à m’arrêter de plus en plus souvent, dès que je vois une branche de libre. Et j’y trouve des gens qui me ressemblent, des camarades qui ont des muscles meurtris à force de voyager. Et je reste avec eux, piailler, sautiller, changer de branche quand le temps nous le concède. Alors il pleut souvent. Nos plumes deviennent grises. Alors, peu à peu, je viens chez vous.é (Copi, La Journée d’une rêveuse, 1968) ; « Le Marais, c’est un peu comme une grande ferme où y’a de la dinde en batterie. » (Samuel Laroque dans son one-man-show Elle est pas belle ma vie ?, 2012) ; « J’ai mis Mister Wren dans la chambre rose. Il aimait bien le baldaquin. » (Mollie à propos de Mister Wren, le héros homo, dans la pièce The Mousetrap, La Souricière (1952) d’Agatha Christie, mise en scène en 2015 par Stan Risoch) ; « Maman, quand je serai grand, je voudrais être un paon. » (Jarry dans son one-man-show Atypique, 2017) ; etc.

Film « Reflets dans un oeil d’or » de John Huston
Par exemple, dans la pièce Des bobards à maman (2011) de Rémi Deval, après s’être comparés à des poules, Max panique auprès de son copain Fred face à la mère de ce dernier qu’ils ont comparée à un renard : « On va se faire plumer !!! » Dans le film « Ma vie avec Liberace » (2013) de Steven Soderbergh dresse le portrait de Liberace, un pianiste virtuose absolument tyrannique autant que doucereux avec ses amants qu’il infantilise et exploite en les traitant tôt comme des dieux (il dira « Mon Sauveur !!! » à Scott) tantôt comme des diables qui lui ont pourri la vie.
La « follitude » (la féminité fatale singée par le personnage homosexuel) est souvent appréhendée comme un instrument de pouvoir, de propagande, et de soumission :
Cyrille – « Pourquoi est-ce que vous ne m’appelez pas ‘maître’ ?
Le Journaliste – Je n’en ai pas l’habitude, maître.
Cyrille – Vous êtes intimidé ? Vous n’aviez jamais rencontré une folle sublime dans la vie privée ? »
(Copi, Une Visite inopportune, 1988)
Le personnage homosexuel s’identifie à la féminité psychorigide de la bourgeoise un peu facho : « Vous pensez que je suis folle, je suis juste sous l’emprise de mes hormones, je veux diriger l’empire des sens, être votre maîtresse à tous ! […] Oui, c’est ça dont on manque, de folie… de folles… Oui, c’est pour ça que moi je suis gay, voilà j’ai réussi à le prouver ! La folie, c’est la seule chose qui ne soit pas mondialisée. La folie c’est la véritable différence entre les gens, c’est la vérité. C’est quand on est fou qu’on est différent. La reine des folles, c’est moi ! Voilà ce qu’il nous faut : Une folle présidente ! » (la folle militante dans la pièce La Fesse cachée (2010) de Jérémy Patinier)
Par exemple, dans la pièce Le Frigo (1983) de Copi, la Doctoresse Freud, une poupée que L. prénomme « Fraulein Freud », incarne un despotique transgenre : « Vous lui agrafez trois plumes d’oiseaux du paradis soutenues par un gros strass sur le front, comme si elle allait descendre le grand escalier des Folies Bergère ! » Dans la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias, la Téré, la directrice despotique de la volière, est définie comme un « oiseau qui chante, ou un paon qui se pavane ».

Harold, le cynique homo du film « Les Garçons de la bande » de William Friedkin
D’ailleurs, il n’est pas anodin que, très souvent dans les fictions homo-érotiques, ce soit les personnages transsexuels que l’on présente comme les « sublimes » instruments du terrorisme homosexuel : cf. le film « Dragzilla » (2002) de Lola Rock ‘N’ Rolla, le film « Priscilla, folle du désert » (1995) de Stephan Elliot, la comédie musicale Big Manoir (2007) d’Ida Gordon et Aurélien Berda, le film « L’Honneur du dragon » (2005) de Prachya Pinkaew, le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman, le film « Who’s Afraid Of Vagina Wolf ? » (« Qui a peur de Vagina Wolf ? », 2013) d’Anna Margarita Albelo, la pièce Les Oiseaux (2010) d’Alfredo Arias (avec le Coryphée, cet homme travesti M to F, despotique et plumé), etc. Par exemple, dans la B.D. La Foire aux Immortels (premier tome de la Trilogie Nikopol) d’Enki Bilal, Jean-Ferdinand Choublanc, « Gouverneur de la cité autonome de Paris » est manifestement homosexuel : les adhérents au parti sont tous sans exception très fortement maquillés, il s’adresse à ses maquilleurs en les appelant « les filles » et à son intendant en l’appelant « chéri », intendant avec lequel il partage son bain.
Le transsexuel ou l’homosexuel efféminé joue souvent le rôle du cerbère terrorisant du ghetto homo censé s’étendre et convertir les autres protagonistes non-homosexuels : « Je suis comme une sorte de terroriste queer comme j’oblige les hommes hétéros de se rendre compte que tout le monde est pédé, quoi, parce que tout le monde bande pour n’importe qui. » (Cody, le héros homosexuel nord-américain s’adressant à son pote gay Mike, dans le roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, pp. 98-99) ; etc. Par exemple, dans la pièce Brigitte, directeur d’agence (2013) de Virginie Lemoine, Damien, le travesti M to F, fait peur à son huissier Monsieur Alvarez quand il se travestit en « Brigitte ».
h) Le despote homosexuel :

Vidéo-clip de la chanson « Relax » de Frankie Goes To Hollywood
Mais allons plus loin dans l’étude des dictateurs homosexuels, et observons les nombreux cas fictionnels d’homme de pouvoir qui sont présentés comme des homosexuels, ou qui le sont vraiment : cf. le vidéo-clip de la chanson « Trust Me » de Matt Zarley, le film « Bulldog In The Whitehouse » (« Bulldog à la Maison Blanche », 2008) de Todd Verow (avec le président des USA homosexuel), le film « Les Adieux à la reine » (2011) de Benoît Jacquot (avec Marie-Antoinette lesbianisée), le vidéo-clip de la chanson « Gay Bar » du groupe Electric Six (avec le président des USA homosexuel), l’opéra King Arthur (2009) d’Hervé Niquet (avec un Roi Arthur super efféminé), le vidéo-clip de la chanson « Tainted Love » du groupe Soft Cell, etc. « À la mairie de Paris, y’a vraiment beaucoup de pédés ! » (Laurent Violet dans le one-man-show Faites-vous Violet, 2012) ; « Ils [les hommes politiques] en sont tous. » (un des héros homosexuels de la comédie musicale Encore un tour de pédalos (2011) d’Alain Marcel) ; « Le président se faisait sodomiser par le pape de l’Argentine » (la voix narrative du roman L’Uruguayen (1972) de Copi) ; « Les balles avaient été réalisées avec la peau des boules authentiques de Fidel Castré. » (le narrateur homosexuel de la nouvelle « L’Apocalypse des gérontes » (2010) d’Essobal Lenoir, p. 131) ; etc. Je vous renvoie également à la partie « Grands Hommes » du code « Défense du tyran » ainsi qu’au code « Promotion « canapédé » » dans le Dictionnaire des Codes homosexuels.

B.D. « Kang » de Copi
Certains personnages homosexuels sont même des dictateurs : cf. le roman Les Maîtres du monde (1996) de Gilles Leroy, le film « The King » (1968) de Looney Bear, le film « King Girl » (1996) de Sam Miller, le film « Sacré Graal » (1974) de Terry Gilliam et Terry Jones (avec le prince Herbert), le film « Le Petit César » (1930) de Mervyn LeRoy (avec le personnage de Rico), le film « Marche triomphale » (1976) de Marco Bellocchio, le roman Les Aigles foudroyés (1997) de Frédéric Mitterrand, la chanson « Princes Of The Universe » du groupe Queen, le roman Le Monarque (1988) de Knut Faldbakken, la chanson « Les Gens stricts » du groupe Animo, le film « Blanche » (2001) de Bernie Bonvoisin (avec José Garcia en Louis XIV de pacotille), le film « The Rocky Horror Picture Show » (1975) de Jim Sharman (avec le « cruel » Dr Franck-N-Furter), le film « Tan De Repente » (2003) de Diego Lerman (avec Lénine et Mao, les deux héroïnes lesbiennes), le film « La Passion » (2004) de Mel Gibson (avec l’empereur Néron en grande tapette), le roman El Príncipe Que Quiso Ser Princesa (1920) d’Álvaro Retana, le film « Le Roi et le Clown » (2005) de Lee Jun-ik (avec la figure du roi despotique), le film « Les Week-ends de Néron » (1956) de Steno, le film « Fiddlers Three » (1944) d’Harry Watt (avec l’empereur Néron en homosexuel), le dessin animé « South Park, plus long, plus grand et pas coupé » (1998) de Trey Parker (avec le couple gay Saddam Hussein/satan), le film « The Singing Forest » (2003) de Jorge Ameer, le film « Girl King » (2001) d’Ileana Pietrobruno, le film « La Racine du cœur » (2000) de Paulo Rocha (avec le dictateur nommé Caton), le spectacle d’imitations L’Électron libre (2008) de Dany Mauro (avec Sarkozy en talons aiguilles), le vidéo-clip de la chanson « Relax » du groupe britannique Frankie Goes To Hollywood (avec l’empereur décadent), le film « La Jeunesse de la bête » (1965) de Seijun Suzuki (avec le tyran homo), la photo Adam et Ewald (2008) de la photographe iranienne Sooreh Hera (représentant deux amants homosexuels talibans), le film « Fiesta » (1994) de Pierre Boutron (avec le tyran homo franquiste), le film « Rose et Noir » (2009) de Gérard Jugnot (avec Papito, le tyran homosexuel), la B.D. Batman (avec le méchant clown, fardé comme une folle), le film « Furyo » (1982) de Nagisa Oshima (avec le capitaine japonais homosexuel), la pièce Jules César (1599) de William Shakespeare, la pièce El General Poder (1960) de Copi, etc.
Par exemple, dans le film « Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ » (1982) de Jean Yann, Jules César (interprété par Michel Serrault) est plus attiré par ses gardes que par Cléopâtre. Dans son one-man-show Atypique (2017), Jarry, en policier du GIGN, porte une cagoule de Ben Laden. Dans le film « Serp I Molot » (1994) de Sergei Livnev, Staline promeut la transsexualité. Dans la pièce Yvonne, Princesse de Bourgogne (2008) de Witold Gombrowicz, Ignace, le monarque gay, fait des avances à son bras droit Chambellan. Dans le roman Le Cœur éclaté (1989) de Michel Tremblay, le couple Catherine/Muriel est associé à l’improbable duo despotique Marie-Antoinette/Cléopâtre (p. 294), ou bien au couple Marc-Antoine/Louis XVI. Dans la pièce El Campo (1967), Griselda Gambaro aborde l’homosexualité refoulée de son personnage Franco. Dans son film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 journées de Sodome », 1975), Pier Paolo Pasolini déguise les quatre dictateurs en folles ou en mariées. Dans les romans El Color Del Verano (1982) et El Palacio De Las Blanquísimas Mofetas (1982), Reinaldo Arenas décrit un Fidel Castro homosexuel fréquentant les pissotières. Dans la pièce Elvis n’est pas mort (2008) de Benoît Masocco, John, la lesbienne asociale, se fait baptiser par erreur « Lénine » (« comme le dictateur » dit-elle) au lieu de « Lennon ». Dans le one-man-show Varón Mayor De 30 Años (2007) de Javier González Traba, le magicien compare sa femme à un Guardia Civil à moustache. Dans la pièce À plein régime (2008) de François Rimbau, Luc, le héros homosexuel a choisi pour pseudo Internet « Benito », comme Benito Mussolini. Dans la comédie musicale Angels In America (2008) de Tony Kushner, Roy Cohn s’exprime comme un dictateur. Le roman Un Rajah blanc à Bornéo (2002) de Nigel Barley raconte la vie de Sir James Brook, homosexuel psychorigide, ayant pris le pouvoir sur l’île de Borné, et déchiré entre son statut de colon anglais méprisant et son appel à aimer physiquement l’étranger qu’il cherche à soumettre. Dans la pièce Lettre d’amour à Staline (2011) de Juan Mayorga, l’écrivain Boulgakov, sous l’emprise d’un Staline homosexuel, rejette sa femme Boulgakova, et ne ressent plus rien au lit avec elle : « Tu te sens coupable d’être avec moi plutôt qu’avec elle… » lui susurre Staline. Dans son sketch « Le 11 septembre », l’humoriste Dieudonné dévirilise les talibans ; il joue le rôle d’un Ben Laden haranguant les hommes de son commando kamikaze en les présentant comme des bisexuels refoulés : « On n’est pas des travelos, les mecs ! » ; « Pourquoi y’aurait pas des hommes ? 50/50 ? » Dans la pièce Les Favoris (2016) d’Éric Delcourt, Guen, le héros homosexuel, appelle au téléphone son amant Brice qui ne le reconnaît pas tout de suite, alors ça l’agace, et il se fait passer cyniquement pour Vladimir Poutine : « Tu pensais que t’allais tomber sur quoi ? Poutine ?! Non, désolé, il a piscine. » Dans le film « Moonlight » (2017) de Barry Jenkins, Chiron, le héros homosexuel, a placé une couronne royale sur le tableau de bord de sa bagnole. Dans le film « Carol » (2016) de Todd Haynes, Thérèse, l’héroïne lesbienne, ne lésine pas sur les moyens qu’elle n’a pas : elle veut la suite présidentielle comme chambre d’hôtel. Dans le film « Jonas » (2018) de Christophe Charrier, pendant le cours d’histoire, Nathan simule un malaise alors que le prof parle de l’accord (pacte de non-agression) entre Hitler et Staline pendant la Seconde Guerre mondiale, pour être amené à l’infirmerie par son futur amant Jonas, qu’il va draguer en même temps qu’humilier.

« Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway
Dans le film « Que Viva Eisenstein ! » (2015) de Peter Greenaway, Sergueï Eisenstein, homosexuel, se compare au tsar de Russie : « Je me suis assis, comme le Tsar, sur le Trône d’Hiver. » Plus tard, quand la bourgeoise Mary Sinclair débarque dans sa chambre et le découvre cul nu, Eisenstein ose dire qu’il fait un hommage à Staline : « Les Russes ne portent pas de pyjama. Staline n’en porte pas non plus ! » Hunger attribue à ce capricieux un « comportement puéril », « une longue aventure irresponsable », « des exigences exorbitantes ».

Roger Payne
« Je serai pour toi un pur César du bidonville au bord du fleuve. » (Cachafaz à son amant Raulito, dans la pièce Cachafaz (1993) de Copi) ; « J’adore te voir en colère, on aurait dit… Jules César… ou Alexandre le grand… Ouais c’est ça… plutôt Alexandre, partant en guerre. J’ai cru que t’allais me frapper ! » (Bryan s’adressant à son amant Kévin dans le roman Si tu avais été… (2009) d’Alexis Hayden et Angel of Ys, p. 158) ; « On aurait dit la branche homosexuelle d’Al-Qaïda. » (Ali Bougheraba parlant des amis de son quartier qui se fringuaient comme George Michael pendant les années 1980, dans son one-man-show Ali au pays des merveilles, 2011) ; « Il y a un point commun entre Al Qaïda et nous : on aime se faire sauter. » (le narrateur homosexuel du one-man-show Elle est pas belle ma vie ! (2012) de Samuel Laroque) ; « Quand Mark parle, on obéit. C’est comme ça. » (un militant LGBT présentant le jeune leader du mouvement LGBT londonien, à Joe le novice, dans le film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; « Elle commence vraiment à me gonfler, la Kim Jong-Un de la natation ! » (Damien, personnage homo, par rapport à Fred, son co-équipier trans M to F dirigeant la choré de leur équipe de water-polo, dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare) ; etc.

Scar dans « Le Roi Lion » de Walt Disney
Pas étonnant que les méchants des dessins animés (travaillés pour la plupart par les studios Disney), pour accentuer leur cruauté et leur violence de despotes, cultivent justement des attitudes précieuses et homosexuelles : je pense par exemple au Dr Facilier, le « Maître des ombres » efféminé du film d’animation « La Princesse et la Grenouille » (2009) de Ron Clements et John Musker, à Skar dans le film d’animation « The Lion King » (1994) de Roger Allers et Rob Minkoff, à Jafar dans le film d’animation « Aladdin » (1992) de John Musker et Ron Clements, au prince Jean dans le film d’animation « Robin Hoods » (« Robin des bois », 1973) de Walt Disney, etc.

Le Prince Jean dans « Robin des Bois » de Walt Disney
i) L’armée homosexuelle :
La fusion entre totalitarisme et homosexualité ne se limite pas aux monarques d’antan. Elle s’élargit aux tenants de la culture homosexuelle contemporaine : militants d’association LGBT, mais aussi couples homosexuels dits « ordinaires » et célibataires occasionnels. En ce qui concerne le despotisme homosexuel à échelle communautaire, je vous renvoie au code « Milieu homosexuel infernal » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels.
Le personnage homosexuel décrit souvent le « milieu homosexuel » comme une dictature, un paradis de la consommation et de l’apparence, avec des légions de clones militaires : cf. le film « À cause d’un garçon » (2001) de Fabrice Cazeneuve, le téléfilm « Juste une question d’amour » (2000) de Christian Faure, le film « Fast Forwad » (« D’un trait », 2004) d’Alexis Van Stratum, le vidéo-clip de la chanson « Dile A Tu Amiga » de Dalmata, le vidéo-clip de la chanson « Alejandro » de Lady Gaga, le vidéo-clip de la chanson « Go West » des Pet Shop Boys, le vidéo-clip de la chanson « Du temps » de Mylène Farmer, le film « Un Año Sin Amor » (2005) d’Anahi Berneni, le film « La Parade » (2011) de Srdjan Dragojevic, etc.

Pierre Fatus dans Arme de fraternité massive (2015)
On retrouve l’armée ou la police homosexuelle dans beaucoup d’œuvres homo-érotiques : cf. la pièce Jeffrey (1993) de Paul Rudnick (avec les Panthères roses), le vidéo-clip de la chanson « Désenchantée » de Mylène Farmer (avec les prisonniers), le film « Salò O Le 120 Giornate Di Sodoma » (« Salò ou les 120 Journées de Sodome », 1975) de Pier Paolo Pasolini (avec l’armée décadente), le film « Suddenly Last Summer » (« Soudain l’été dernier », 1960) de Joseph Mankiewicz (avec l’armée gay, composée des anciens amants de Sébastien), les vidéo-clips des chansons « Pourvu qu’elles soient douces » et « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer (avec les soldats de plomb), le film « Freak Orlando » (1981) d’Ulrike Ottinger (avec les soldats), les armées cinématographiques de Youssef Chahine ou de Bruce LaBruce, la B.D. La Guerre des pédés (1982) de Copi, le film « The Virgin Soldiers » (1969) de John Dexter, le film « Our Miss Fred » (1971) de Bob Kellett, le film « Lady Oscar » (1978) de Jacques Demy, le film « Marche triomphale » (1976) de Marco Bellocchio, le film « Les Amazones » (1974) de Terence Young, le film « Tank Girl » (1994) de Rachel Talalay, le film « Armée d’amants » (1976) de Rosa von Praunheim, le film « Les Chevalières » (2002) de Barbara Teufel, le film « Johanna d’Arc Of Mongolia » (1988) d’Ulrike Ottinger, le film « Kyokon Densetu » (1993) de Nakamura Genji, le film « Kamikaze Girls » (2004) de Tetsuya Nakashima, le ballet Alas (2008) de Nacho Duato (avec le bruit des bottes), le film « Poo Kor Karn Rai » (« The Terrorists », 2011) de Thunska Pansittivorakul, le vidéo-clip de la chanson « Only Gay In The World » de Ryan James Yezak, la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi (et les 4 « gouines armées » avec, à leur tête, Sapho), etc.
Par exemple, dans le film « Dérive » (1983) d’Amos Gutmann, la grand-mère de Robbie qualifie les homos de « terroristes ». Dans le roman Des chiens (2012) de Mike Nietomertz, le groupe de rock de Polly, l’héroïne lesbienne, s’appelle les Lesbians Warriors. Dans le film « Surfing Gang » (2006) de Katrina del Mar, le gang de méchantes filles lesbiennes, avec leur drapeau pirate, sème la terreur sur la plage de Rockaway Beach. Dans la pièce Les Virilius (2014) d’Alessandro Avellis, les Hommens pro-life sont parodiés en groupe paramilitaire sado-maso de puceaux homosexuels refoulés, vomissant du slogan hétérosexiste : « Attention = HÉTÉROSEXUALITÉ EN DANGER ! […] On vaincra ! On a un phallus ! […] Voici ce qui se passe quand on laisse sortir les femmes de la cuisine ! […] Nous devons sanctuariser la famille hétérosexuelle ! ». Dans le film « Les Crevettes pailletées » (2019) de Cédric le Gallo et Maxime Govare, le cri de guerre de l’équipe de water-polo gay s’achève en mimant une décapitation : « On va vous décortiquer ! On est les crevettes pailletées ! Argh…. ! »
Dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi, ce sont les travestis qui prennent la place des policiers persécutant les homos dans les parcs : « Les jardins du Sacré-Cœur sont bien gardés par les flics ! Vous ne me faites pas peur ! […] Vous, les travestis troupières, vous venez nous faire la guerre à nous, pédés pacifistes, nous traitant de jeunes filles tristes quand tout ce que nous cherchons, c’est simplement un garçon (si c’est possible un artiste) idéaliste, simple et bon qui reste garder la maison quand nous faisons secrétaires ! vous voulez nous effrayer, affublées de vos perruques, habillées comme des perruches. » (Pédé)
Dans le roman Des chiens (2011) de Miko Nietomertz, Polly soupçonne son ami gay Simon de désigner le « milieu homo » comme une « fausse démocratie »… parce qu’elle sent bien qu’il a raison : « En fait, t’es en train de nous dire qu’il y a autant de personnels armés en France que de gays et de lesbiennes ? Si je suis ton raisonnement, on pourrait faire une révolution gays-lesbiennes contre les uniformes armés, pour obtenir le pouvoir ? » (p. 30)
j) La politique expansionniste du milieu homo : le fascisme gay
Il arrive que les personnages homosexuels des fictions ne se fassent pas à l’idée que, selon eux, le monde soit « non-homosexuel » ou ne soit pas « hétérosexuel ». À les entendre, tout le monde serait homo quelque part. « Tout le monde est gay de nos jours. » (Mr Chapiro, dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner) ; « On est partout, tu sais ? » (Éric le héros homo s’adressant à Otis, dans l’épisode 1 de la saison 1 de la série Sex Education (2019) de Laurie Nunn) ; etc. Pour « libérer » chez tous ceux qui ne voient pas la sexualité comme eux « l’homosexuel qui serait en eux », beaucoup partent en croisade pour l’« amour libre » (homo, hétéro, bi, peu importe) : cf. le film « Papa faut que j’te parle » (2008) de Philippe Becq et Jacques Descomps, le film « Were The World Mine » (2010) de Tom Gustafson (où la communauté homo essaie de rendre gay tous les hétéros), le roman Hétéro par-ci, homo par le rat (2000) de Cy Jung, le film « In & Out » (1997) de Frank Oz (avec le coming out généralisé final), la chanson « You Are Unstoppable » de Conchita Wurst, etc.
Cette homosexualisation de la terre entière commence par la blagounette… et puis la blague devient parfois beaucoup plus sincère que prévu. Par exemple, l’affiche d’Élisabeth Ohlson Wallin pour Equal Program (2004) représente sur fond ténébriste et apocalyptique un homo, une lesbienne et un transsexuel M to F déguisés en l’autre trinité autoritaire qu’ils prétendent remplacer : l’armée, l’Église, et la police. Dans la pièce My Scum (2008) de Stanislas Briche, il est question d’installer les femmes puissantes et des homosexuels au pouvoir pour exterminer tous les hommes sexués et « détruire le sexe masculin ». Cette œuvre théâtrale promeut un monde asexué, imposant le totalitarisme ascétique de l’orgasme : « La sexualité est une activité totalement inutile. […] Le sexe est le refuge des débiles. »
Les slogans des héros homosexuels deviennent de plus en plus menaçants, belliqueux, victimisants : « Réécrire l’Histoire, à nos étendards… Soldats de la rue ou anges déçus… Oh, debout et le poing levé ! » (cf. la chanson « Réévolution » d’Étienne Daho) ; « Je suis un nom, sommes légion… et de lumière sur les pavés coule le ré de rébellion de nos prières. » (cf. la chanson « Réveiller le monde » de Mylène Farmer) ; « Ce n’est qu’un début. Continuons le combat ! » (cf. la dernière phrase du film anti-sarkoziste « Nés en 68 » (2008) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, scandé par un groupe de militants petits-bourgeois de gauche) ; « Les victimes d’aujourd’hui seront-elles les bourreaux de demain ? » (Joachim dans la pièce Entre vos murs (2008) de Samuel Ganes) ; « On va faire un putsch ! » (Stephany, la lesbienne du film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; « C’est pas la guerre mais c’est l’invasion. » (Jefferey Jordan parlant des personnes homos dont il fait partie, dans son one-man-show Jefferey Jordan s’affole, 2015) ; « Aide-les à construire une Nation : celle du cœur. Vous êtes un Peuple fier et ancien. Aide ces garçons à construire leur propre Nation. » (Scrotes s’adressant à son amant Anthony, à propos du couple homo naissant Jim/Doyler, dans le roman At Swim, Two Boys, Deux garçons, la mer (2001) de Jamie O’Neill) ; « Couchons-nous et demain, lesbiennes et pédales seront le genre humain. » (Cf. la reprise parodique de l’Internationale, dans le film « La Belle Saison » (2015) de Catherine Corsini) ; « Ce qui est chiant avec vous les gays, c’est que vous voyez des gays partout. » (le Dr Katzelblum s’adressant à ses deux patients en couple homosexuel Benjamin et Arnaud, dans la pièce La Thérapie pour tous (2015) de Benjamin Waltz et Arnaud Nucit) ; etc.
Dans le film « L’Ultime souper » (1996) de Stacy Title, un groupe de cinq étudiants « libéraux » décident d’éliminer tous ceux qui représentent selon eux des menaces pour la démocratie : les extrémistes, les fascistes, les racistes, les homophobes. On a affaire ici à un programme de nettoyage ethnique inversé.
Certains personnages communautaires homosexuels ne se contentent pas de fermer les portes de l’enfer de leurs pratiques sexuelles autour d’eux : ils veulent l’étendre au reste du monde, en cherchant – pour les plus extrémistes – à homosexualiser la Planète entière, et – pour les encore plus extrémistes et les plus bobos d’entre eux – à bisexualiser/asexualiser tous les êtres humains : « Je pense à toutes ces situations que la plupart des femmes ne connaîtront jamais, par ce manque de courage qu’elles ressentent pour assumer leurs goûts au regard des conventions imposées. » (Alexandra, la narratrice lesbienne du roman Les Carnets d’Alexandra (2010) de Dominique Simon, p. 71) ; « Je compris que les amies allemandes de ma cousine étaient mues par une force invisible qui exigeait que le plaisir qu’elles prenaient des femmes se répandît, si possible, dans l’univers entier, et que pour parvenir elles comptaient beaucoup sur la contagion. » (idem, p. 110) ; « De toute façon, le vingt-et-unième siècle sera bi ou ne sera pas ! » (Claude, une des héroïnes lesbiennes du roman Des chiens (2011) de Mike Nietomertz, p. 63) ; « R. me dit qu’il est peut-être bi, qu’il sait pas et que dans le fond, il s’en branle, il veut avoir tous les choix. Moi ça m’effraie qu’il ne choisisse pas son camp. Polly dit que la sexualité, de toute façon c’est dans la tête, et en réinterprétant Freud, ‘On est tous des bisexuels qui faisons des choix.’ » (Mike, le narrateur homosexuel, op. cit., pp. 67-68) ; « Toutes les femmes sont des lesbiennes dans l’âme ! » (les filles lesbiennes du film « Pride » (2014) de Matthew Warchus) ; etc. Par exemple, dans le film « Judas Kiss » (2011) de J.T. Tepnapa et Carlos Pedraza, Danny, l’un des héros homosexuels, dans son synopsis cinématographique, veut créer « un univers où tout est inversé, un monde gay où les hétéros sont une minorité ». Dans le film « Were The World Mine » (2010) de Tom Gustafson, le but affiché des protagonistes homosexuels est « de rendre gays tous les hétéros ». Dans son one-woman-show Chatons violents (2015), la compagne d’Océane Rose-Marie a un pote qui fait de la bande dessinée. Océane s’énerve contre lui parce qu’il n’est pas homo : « Il ne peut pas être pédé comme tout le monde ? » Dans la pièce L’Héritage était-il sous la jupe de papa ? (2015) de Laurence Briata et Nicolas Ronceux, Géraldine, la bourgeoise découvrant avec horreur que tout son entourage, et même son mari, devient homo, s’insurgent : « On n’est pas tous pédés !! »
La politique expansionniste homosexuelle ne s’appuie pas uniquement dans la défense ouverte d’une identité ou d’un amour homosexuel(-le). L’autoritarisme des personnages homosexuels peut prendre des détours et se valoir de la défense des enfants (« mariage pour tous », PMA, GPA, adoption) ou des pauvres (« la solidarité ») pour asseoir son pouvoir : « Je veux un enfant et je l’aurai ! » (Claire et sa compagne Suzanne dans la pièce Le Mariage (2014) de Jean-Luc Jeener)
k) Mappemonde : It’s a Small World

Film « Le Dictateur » de Charlie Chaplin
La vision de l’existence qu’adoptent certains héros homosexuels étant homosexualo-centrée, narcissique, faussement humaniste (puisqu’elle est déconnectée du réel et très liée à la pulsion fantasmatique), médiatique, il arrive qu’ils le réduisent à une mappemonde, à un petit écran de télévision ou d’ordinateur portable, à un miroir d’eux-mêmes ou de l’être aimé, à un globe terrestre qu’ils peuvent tenir dans leurs mains en se prenant pour les Créateurs du Monde : « L’Univers, c’est la personne. » (cf. une réplique de la pièce Howlin’ (2008) d’Allen Ginsberg) ; « J’imaginais le corps de Linde et la carte du pays fusionnant les limites entre plusieurs États afin qu’ils se chevauchent. » (Anamika, l’héroïne lesbienne parlant de son amante Linde, dans le roman Babyji (2005) d’Abha Dawesar, p. 57) ; etc. Par exemple, dans le ballet Alas (2008) de Nacho Duato, le héros désire « s’identifier au monde ». Dans le film « L’Homme de sa vie » (2006) de Zabou Breitmann, le mot « Univers » apparaît en ombre au dos de Frédéric au moment où il entre dans le bar et que Hugo tombe amoureux de lui. Dans le film « Como Esquecer ? » (« Comment t’oublier ? », 2011) de Malu de Martino, Julia dit que le corps d’Antonia « était une carte qui n’avait aucun secret pour elle ». Dans le film « L’Objet de mon affection » (1998) de Nicholas Hytner, George, le héros homosexuel maître d’école, explique à toute sa classe de primaire, avec un globe terrestre, à quoi ressemble la Planète. Le monde miniature à portée de main symbolise au fond l’étroitesse de la conception libertine de l’Amour. Dans le film « Die Mitter der Welt » (« Moi et mon monde », 2016) de Jakob M Erwa, Phil, le héros homo, a dans sa chambre une immense mappemonde accrochée au-dessus de son lit. Et elle s’anime en décor lumineux sur lui. D’ailleurs, même le titre du film illustre qu’il se prend pour le monde et qu’il est dans son monde.
Le monde mondialisé/érotisé sous forme de mappemonde, possédé avec jouissance par le dictateur homosexuel, apparaît dans un certain nombre de fictions homo-érotiques : cf. le film « My Summer Of Love » (2004) de Pawel Pawlikovsky, le film « Le Dictateur » (1940) de Charlie Chaplin (avec le dictateur efféminé face à sa mappemonde), la pièce Le Roi des aulnes (1970) de Bernard-Marie Koltès (avec le gyroscope), le film « Pink Narcissus » (1971) de James Bidgood (avec le globe terrestre), le film « Star Maps » (1997) de Miguel Arleta, la pièce La Reine morte (1942) d’Henry de Montherlant (avec l’astrolabe), le film « Queen Of The Whole Wide World » (2001) de Roger Hyde, le film « Mathi(eu) » (2011) de Coralie Prosper (avec la mappemonde affichée dans la chambre de Mathilde), le film « Le Cimetière des mots usés » (2011) de François Zabaleta, la pièce La Nuit de Madame Lucienne (1986) de Copi (avec les planètes comparées à des oranges), la pièce Dans la solitude des champs de coton (1987) de Bernard-Marie Koltès (avec le monde tenu à la pointe de la corne d’un taureau), etc.
« Il est à moi, le Monde, il est à moi, le Monde ! » (cf. la chanson « Dessine-moi un mouton » de Mylène Farmer) ; « Le monde m’appartient ! » (la voix narrative, du haut de sa fenêtre, dans le roman La Voyeuse interdite (1991) de Nina Bouraoui, p. 99) ; « Et dans mes mains le monde tournera. Je suis la Reine ! » (cf. la chanson « La Reine » de Lorie) ; « Comment on voit le monde quand sur son planisphère tout est à l’envers ? » (Lourdes dans la pièce Les Gens moches ne le font pas exprès (2011) de Jérémy Patinier) ; « Rakä […] essayait de trouver notre position sur une mappemonde échappée par fortune au supplice des livres. » (Gouri dans le roman La Cité des rats (1979), p. 124) ; « Essaie de voler, mon petit. Tu vas voir comme ce n’est pas difficile. Je te donnerai un sucre. Je te montrerai l’Afrique, tu vas voir, c’est comme un mouchoir. Je te montrerai le monde, il est comme une boule de billard bleue avec des puces dessus. » (le Vrai Facteur dans la pièce La Journée d’une rêveuse (1968) de Copi) ; « Le monde, ma chérie amie, c’est fini, archi-fini, c’est une carte postale du Sacré-Cœur en ovale juste bonne pour les touristes ! » (Fifi à Mimi dans la pièce Les Escaliers du Sacré-Cœur (1986) de Copi) La mappemonde dans les œuvres homosexuelles traduit en général une conception plate, caricaturale, mégalomaniaque, désenchantée de la vie.
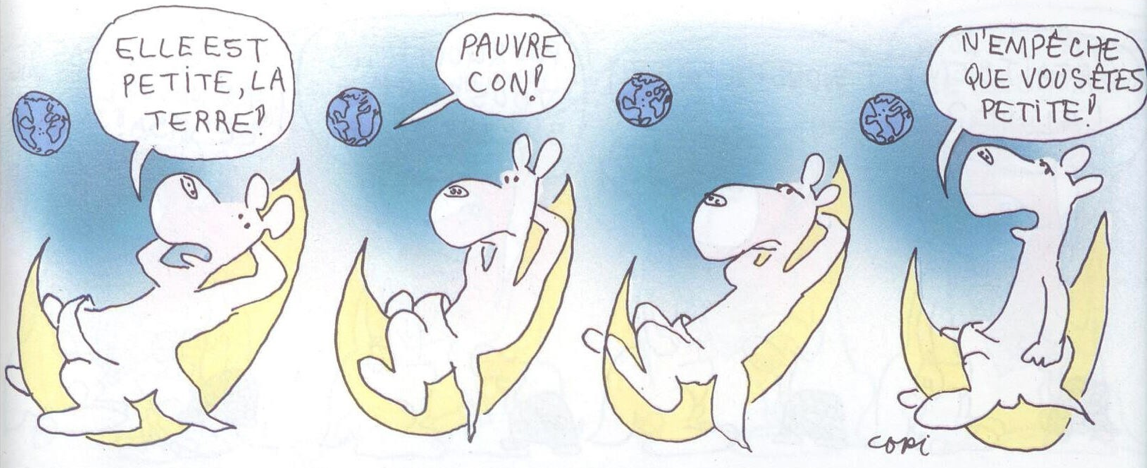
B.D. « Kang » de Copi
FRONTIÈRE À FRANCHIR AVEC PRÉCAUTION
PARFOIS RÉALITÉ
La fiction peut renvoyer à une certaine réalité, même si ce n’est pas automatique :
a) Le père militaire :
Avant de se durcir et de choisir la voie du despotisme, un certain nombre de personnes homosexuelles montrent des antécédents familiaux qui semblent les avoir prédestinés. Bien sûr, ceux-ci expliquent mais ne justifient rien, n’impliquent aucun déterminisme. Cependant, j’annonce tout de suite que ce code que je traite ici, loin de devoir culpabiliser la communauté homosexuelle (tant j’insiste ici sur les circonstances atténuantes et les possibles violences qui ont pu survenir en amont dans le passé des individus homos), est d’abord là pour aider les personnes homosexuelles à identifier leurs vieux démons et la haine de soi dont le désir homosexuel est le signe, pour éviter précisément les reproductions mimétiques inconscientes de schémas totalitaires parentaux et sociaux.
Car oui, certaines parmi elles ont reçu une éducation trop stricte, soit parce que trop laxiste, soit parce que trop exigeant. Elles ont vécu l’éducation de leurs parents comme une tyrannie (parce que parfois elle en était une). Dans son essai Man, Morals And Society (Homme, morale et société, 1945), J.-C. Flugel écrit que les individus homosexuels qui, dans leur enfance, se sont identifiés avec des modèles paternels ou maternels très sévères auront tendance à embrasser en grandissant des causes conservatrices et à être fascinés par les régimes autoritaires. Beaucoup de sujets homosexuels ont un père militaire de carrière (Érik Rémès, Jean Le Bitoux, Renaud Camus, Graham Chapman, Bai Xianyong, Luis Cernuda, Bernard-Marie Koltès, Rupert Everett, Havelock Ellis, Pier Paolo Pasolini, Hélène de Monferrand, etc.) ou un géniteur particulièrement autoritaire (James Baldwin, Julien Green, Serguei Esenin, Louis II de Bavière, Virginia Woolf, Élia Kazan, etc.). « Le capitaine n’était pas un joyeux drille. Le nez droit, l’œil sévère, militaire à la maison comme à la caserne, il aimait l’ordre et l’obéissance et il nous faisait baisser la tête… » (Jean-Claude Brialy parlant de son père, dans son autobiographie Le Ruisseau des singes (2000), p. 25) ; « Notre maison regorgeait de livres, des jeux de société, ainsi que des décorations militaires qui peuplaient le salon. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 18)
b) Le comportement de vieux gars tyrannique et inflexible :
Le manque d’amour et de tendresse parentale peut avoir des retombées sur le caractère de certains individus homosexuels, qui pour le coup deviennent des « vieux garçons » irascibles, qui ne supportent pas de se plier à d’autres désirs que les leurs (cf. je vous renvoie également au code « Parodies de mômes » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels). Eux ou bien leur entourage les décrivent comme des hommes ou des femmes pas faciles à vivre, manquant de souplesse, transis de peurs et de complexes, bref, psychorigides : « Lire la biographie de Carson McCullers, de Tennessee Williams ou de Truman Capote, c’est lire la vie d’éternels enfants terribles, de monstres sacrés, de sacrés monstres, empêtrés dans leurs contradictions, englués dans leur narcissisme d’adolescents égoïstes. » (Georges-Michel Sarotte cité dans la biographie Carson McCullers (1995) de Josyane Savigneau, p. 210) ; « J’espère que dans ses biographies elle ne sera pas dépeinte par la postérité toute de blanc vêtue ou avec une auréole. C’était une garce, et je ne veux pas qu’elle apparaisse comme un ange. » (Robert Walden à propos de Carson, p. cit., p. 317) ; « Marcel est génial, mais c’est un insecte atroce, vous le comprendrez un jour. » (Lucien Daudet à propos de Marcel Proust, cité dans Le Passé défini (1953) de Jean Cocteau) ; « Il avait beau être un tyran, on finissait par l’aimer pour cela, quand on en connaissait les raisons. » (Céleste, la nourrice de Marcel Proust, citée dans l’article « Sainte Céleste » de Diane de Margerie, sur le Magazine littéraire, n°350, janvier 1997, p. 44) ; « Je devins bientôt un enfant brillant mais de caractère difficile. » (Berthrand Nguyen Matoko, Le Flamant noir (2004), p. 12) ; « Sur un plateau [en tant que metteur en scène], je suis un emmerdeur. » (Copi cité dans l’article « Copi en forme » de Jean-Pierre Thibaudat, dans le journal Libération du 10 octobre 1983) ; etc.
Dans l’article « Rainer Werner Fassbinder » de John Tain (publié sur le Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes (2003) de Didier Éribon, pp. 188-190), le réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder est défini comme un « petit dictateur » boulimique. Dans sa biographie La Jeunesse d’André Gide (1963), Jean Delay en arrive à traiter le célèbre romancier français de « pédéraste arrogant ». Miguel de Molina est présenté comme un homme ultra-maniaque, capricieux, sauvage, dur, têtu, snob, et méprisant envers les sujets homosexuels (cf. l’article « Miguel De Molina, Tan Grande, Tan Andaluz » (1997) d’Ángel Berlanga). Dans le film biographique « Yves Saint-Laurent » (2014) de Jalil Lespert (qui veut pourtant donner une image positive de l’homosexualité), Pierre Bergé apparaît comme « un nerveux » colérique, un maniaque, un gestionnaire calculateur et volage : « T’aboies tout le temps » lui reproche par exemple Victoire. Et le compagnon de Bergé, Yves Saint-Laurent, dans un autre style, n’est pas plus souple : dans le documentaire « Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : l’Amour fou » (2010) de Pierre Thoretton, il s’associe volontiers à la « grande famille des nerveux » décrite par Marcel Proust.
La présomption d’homosexualité rigide planant sur certains individus encore célibataires à 30 ans n’a pas à nous choquer ou à être moralisée, car elle se limite pas à une simple obsession sociale du mariage : elle peut dire aussi un assèchement du cœur chez pas mal de sujets homosexuels dont la vie n’est pas pleinement donnée à la bonne personne. « Cette absence de reconnaissance s’est parfois incarnée, au XIXe siècle, dans la figure de la ‘vieille fille’, grande et maigre come la Miss Harriet de Maupassant (Miss Harriet, 1883). […] C’est le cas par exemple de la Lisbeth Fischer de Balzac (La Cousine Bette, 1847). […]. Derrière l’archétype de la ‘vieille fille’ se cache celui de ‘la’ lesbienne – et plus généralement des femmes qui font preuve d’indépendance. » (Natacha Chetcuti, Se dire lesbienne : Vie de couple, sexualité, représentation de soi (2010), pp. 100-101) ; « Quand nous étions ensemble, Martine et moi, nous étions seules. Nous avions essayé de nous tenir chaud, de nous réconforter l’une à l’autre, mais la solitude était toujours là et ce n’était pas la vie. Martine et moi étions deux vieux garçons misogynes, mais à qui était-ce la faute ? » (Paula Dumont, La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 134)
Le despote homosexuel version réel (même s’il ne s’actualise jamais complètement), c’est en général l’homme hétéro donjuanesque et libertaire qui se bisexualise et s’homosexualise en assumant (un peu mais pas trop) l’étiquette de l’homosexuel pour la nier la plupart du temps (il est donc homophobe), et surtout pour nier ses actes homosexuels et la responsabilité qu’ils lui confèrent. Par exemple, dans le documentaire « Cet homme-là est un mille-feuilles » (2011) de Patricia Mortagne, le père de Patricia, homosexuel tardif, est présenté comme un tyran qui, parce qu’il a toujours cherché dans ses relations le confort de la fusion, qu’il n’a jamais su couper les liens avec ses proches (ses enfants, sa femme, ses amants avec qui il vit dans la même propriété : « Tu l’as bien dit toi-même : je ne sais pas couper les liens que j’ai avec les autres. »), et qu’il s’est créé « sa petite cour », est pourri « gâté », « possessif »… même s’il niera mollement qu’il a agi comme un despote : « J’ai pas l’étoffe d’un tyran. »
Dans mon entourage amical, j’ai un ami homosexuel, sensiblement dans la même situation, hébergeant dans sa baraque son jeune amant, mais aussi son ex-compagne et le fils qu’ils ont eu ensemble… Et j’entends parfois son copain lui reprocher son statut de pacha pourri gâté, qui n’a renoncé à rien, qui « a tout » (le beurre et l’argent du beurre), qui n’a pas choisi de donner son cœur entièrement à une seule personne. Oui : l’homosexualité et bisexualité pratiquées, c’est le summum de la tyrannie du désir homosexuel.
c) Esprit de conquête et orgueil :
Le mal-être existentiel de certaines personnes homosexuelles peut prendre chez elles la forme de l’orgueil offensif, de la fierté mal placée, de la carcasse de suffisance : « Général, empereur, Byron, ou rien. » (Jean-Luc Lagarce dans son Journal, 1992) ; « J’aime les tsars et les aristocrates, mais leurs actions ne sont pas bonnes. […] Le président Wilson n’est pas un danseur. Wilson est dieu dans la politique. Je suis Wilson. Je suis un politique raisonnable. » (Vaslav Nijinski, Cahiers (1918-1919), p. 66) ; « Je jouais plusieurs rôles, y compris mon préféré, celui de leader suprême. Où que je fusse, je parvenais toujours à former une bande, une bande où j’étais le chef. » (Gore Vidal, Palimpseste – Mémoires (1995), p. 124) ; « J’ai toujours eu l’habitude de faire ce que je voulais. » (Catherine, intervenante lesbienne, dans l’essai L’Homosexualité dans tous ses états (2007) de Pierre Verdrager, p. 63) ; « Comme ma mère, je suis têtu, dictateur, quand je le veux. » (Abdellah Taïa, Une Mélancolie arabe (2008), p. 119) ; « Je suis pour l’ordre. Vive l’ordre ! … Évidemment, l’ordre le plus raffiné est celui qui fait la plus grande place au désordre ! » (Renaud Camus dans le documentaire « L’Atelier d’écriture de Renaud Camus » (1997) de Pascal Bouhénic) ; « Face aux autres, Wilde montrait un masque trompeur, fabriqué pour étonner, amuser ou parfois exaspérer. Il n’écoutait jamais et il prêtait à peine attention à un avis autre que le sien. À partir du moment où il n’était pas le seul à briller, il s’éclipsait. » (André Gide dans « Masques de Oscar Wilde ») ; « J’ai une haute opinion de moi, c’est vrai. C’est effrayant d’être ainsi infatué de soi-même. […] Rien ne me décourage plus que de percevoir en moi cette suffisance (qui n’est pas de la confiance en soi). » (Yukio Mishima, Correspondance 1945-1970 (1997), p. 66) ; « Je suis un peu obstiné, c’est mon côté breton, sale gosse. […] Je suis très orgueilleux. » (Christophe Honoré cité sur le site www.e-llico.com, consulté en juin 2005) ; « Je possède un orgueil que je crois terrible. » (la chanteuse Mylène Farmer citée dans la biographie Ainsi soit-elle (1991) de Philippe Séguy) ; « Ton destin de souveraine est la volonté de Dieu. » (la voix-off s’adressant à Christine, dans le docu-fiction « Christine de Suède : une reine libre » (2013) de Wilfried Hauke) ; « Elle a été élevée pour régner. On l’a formatée pour commander. » (la biographe Marie-Louise Rodén parlant de Christine, idem) ; « Il me faut d’abord être couronnée roi ! » (Christine, idem) ; « J’ai peur de découvrir mes limites. » (Alexandre, jeune témoin homo de 24 ans, dans l’émission Temps présent spéciale « Mon enfant est homo » de Raphaël Engel et d’Alexandre Lachavanne, diffusée sur la chaîne RTS le 24 juin 2010) ; etc.
Quand Oscar Wilde débarque à New York le 2 janvier 1882 devant une meute de journalistes et que le douanier lui demande s’il a quelque chose à déclarer, il répond : « Rien d’autre que mon génie. » (François Dupuigrenet-Desroussilles, « Chronologie », dans le Magazine littéraire, n°343, mai 1996, p. 20) Dans l’affiche de son one-man-show Bon à marier (2015), Jérémy Lorca se représente avec une couronne de roi. Dans mon entourage amical proche, je connais un ami homosexuel qui se déguisait en Néron pendant son adolescence.
En amour comme en société, certaines personnes homosexuelles prétendent avoir tous les pouvoirs : « J’étais toujours le chef, et mon frère, docile et effacé, faisait office de chauffeur, de secrétaire et d’adjoint, toujours prêt à participer aux jeux fantastiques dont j’avais le secret. » (Jean-Claude Brialy, Le Ruisseau des singes (2000), p. 33) ; « Enfant, j’aimais les costumes, les déguisements et les cérémonies militaires. » (idem, p. 24) ; « J’aime l’aventure, l’ambition. J’aime commander. Et les femmes soumises. » (Maïté, femme lesbienne, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) ; etc. Dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, Guy Hocquenghem, l’un des pères du militantisme homosexuel français dans les années 1970, est décrit comme un orateur despotique et imbu de sa personne.
Lors de la conférence « Différences et Médisances » autour de la sortie de son roman L’Hystéricon, à la Mairie du IIIe arrondissement, le 18 novembre 2010), quand Christophe Bigot raconte sa petite enfance, on ne peut que penser qu’il a confondu cour d’école et cour de justice : « Je faisais le bourreau du Tribunal révolutionnaire sur la cour d’école. » D’ailleurs, il avoue s’être identifié très tôt (avant de le dés-idéaliser) au procureur Camille Desmoulins, figure du romantisme avant l’heure : « Il est jeune, courageux, fougueux, c’est un amoureux. J’ai voué un culte à Camille Desmoulins pendant toute mon adolescence. […] C’est un homme violent qui désigne, à la vindicte populaire, les contre-révolutionnaires. »
« Pourquoi donc les pédérastes feraient-ils de meilleurs chefs et de meilleurs éducateurs ? » Hans Blüher répond : « Bien qu’il n’y ait pas de différences essentielles entre homosexuels et non homosexuels, il y a des différences marquées dans l’efficacité de l’éducation et de l’enseignement de la jeunesse. Maintes et maintes fois, des cas historiques ont montré que l’efficacité d’un chef était directement proportionnelle au degré de son inversion sexuelle. […] Du point de vue éducatif, il y a cinq types sexuels d’hommes, depuis l’hétérosexuel exclusif jusqu’à l’homosexuel complet. L’homme hétérosexuel exclusif est le moins bien habilité à enseigner la jeunesse. La seconde catégorie, à savoir des hommes qui satisfont leurs besoins sexuels avec des femmes, mais sont socialement dépendants de leur propre sexe, fait d’excellents éducateurs, de même que les bi-sexuels. […] Un quatrième type, c’est l’homme qui satisfait ses besoins sexuels avec des hommes, mais remplit la plupart de ses besoins sociaux avec des femmes. . […] Le cinquième et dernier type d’homme est l’homosexuel exclusif. De tels hommes sont le point focal de toutes les organisations de jeunesse, et sont souvent des figures révolutionnaires. » (Hans Blüher dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, p. 149)
d) Architecture et homosexualité :
Même si, à l’évidence, le trio homosexualité-architecture-totalitarisme reste difficile à prouver, il existe et certaines personnalités du monde homosexuel en font mention inconsciemment : « Décidément, les dictateurs ont un goût très sûr en architecture. » (Pascal Sevran, Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 201) Je vous renvoie à l’essai Queer Space: Architecture and Same-Sex Desire Hardcover (1997) d’Aaron Betsky.
On rencontre d’ailleurs des architectes homosexuels ou tout du moins un attrait des dictateurs bisexuels pour l’architecture. Par exemple, Hitler était fasciné par l’architecture viennoise.
e) Maniaque de la propreté :
Certaines personnes homosexuelles sont tellement soucieuses de tout contrôler dans leur vie et leurs amours – parce qu’au fond on ne leur a pas donné assez d’amour et de confiance – qu’elles mettent le paquet sur le matériel, les apparences, les mondes figés. Elles se montrent souvent hyper maniaques et obsédés par la propreté : « Ranger, ranger encore. Mon obsession. […] Mettre de l’ordre, ne rien laisser traîner après moi. » (Pascal Sevran, Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006), p. 148) ; « Ma douce folie du ménage est un plaisir, presque une joie, dont je ne me lasse pas. Un besoin impérieux. » (idem, p. 188) ; « Exagération dans la propreté corporelle » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 378) ; « Beaucoup de professeurs signalent, au long des cours qu’ils font à de futurs médecins, comment la peur des maladies vénériennes pousse certains individus vers la pédérastie. Cette crainte agit naturellement sur les esprits faibles. On sait que Henri III ne devint pédéraste qu’à son retour d’Italie où il avait contracté une maladie vénérienne. Diderot, dans ses œuvres, signale qu’une des causes de l’immense développement, en son temps, de l’homosexualité, n’était autre que l’effroi produit par les maladies vénériennes. Beaucoup d’hommes sont devenus des invertis par peur de la syphilis. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p.218) ; « J’suis un peu maniaque. Dès qu’il y a une mèche qui va pas… » (Laura, homme M to F, dans l’émission Zone interdite spéciale « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres » diffusée le 12 novembre 2017 sur la chaîne M6) ; etc.
Par exemple, le romancier homosexuel Marcel Proust, sous prétexte de son asthme, il ne supportait pas les parfums, les plantes, les bruits (il avait tapissé sa chambre de plaques de liège).
f) Le militaire homosexuel :
Il n’est pas rare que certains individus homosexuels aient trouvé dans les métiers militaires et para-militaires un bon compromis entre leur recherche puriste de rigueur et leurs pulsions esthético-sexuelles : cf. le documentaire « Ma Vie (séro)positive » (2012) de Florence Raynel (avec Kévin, le trentenaire, ex-officier de police), l’autobiographie Folies-Fantômes (1997) d’Alfredo Arias (racontant la liaison entre le prof d’art dramatique et l’un de ses élèves cadets du lycée militaire), l’association Flag ! (créée en 2001) réunissant des policiers et des gendarmes homosexuels en France, etc.
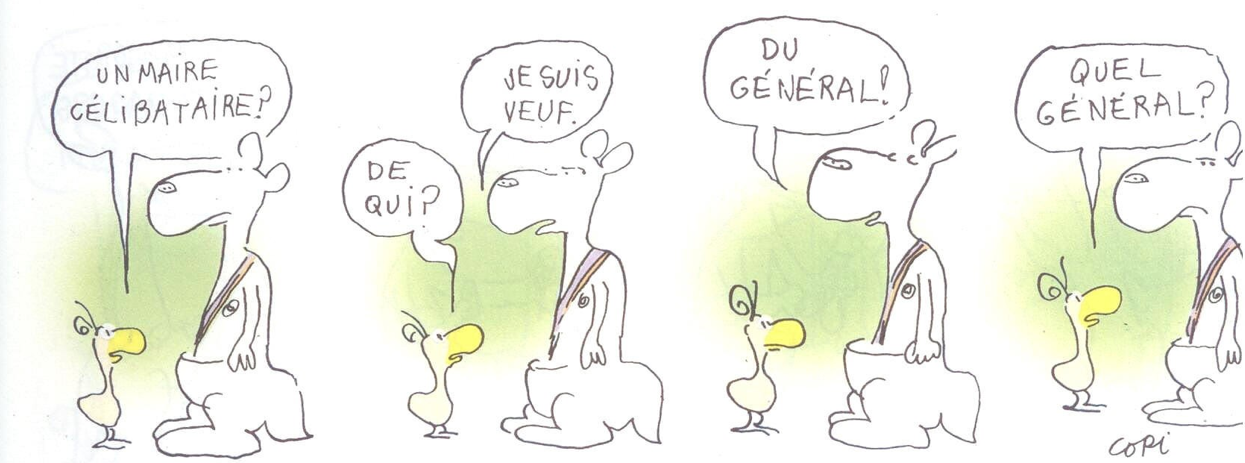
B.D. « Kang » de Copi
Les liens entre l’armée et l’homosexualité ont beau être passés sous silence (« Don’t ask, don’t tell » comme a dit Bill Clinton), ils existent : pensons au maréchal Lyautey, au général Montgomery, Cambacérès, Mauricio Ruiz, Maurice Pinguet, Roger Vandenberghe, etc. « Il y a beaucoup d’homophiles dans l’armée. Nous accueillons dans notre club jusqu’au grade de colonel. » (Abraham, responsable homo du Club 58 en Suisse, dans le documentaire « Les Homophiles » (1971) de Rudolph Menthonnex et Jean-Pierre Goretta) Par exemple, Blücher (l’adversaire de Napoléon pendant la campagne de France en 1814 et à Waterloo en 1815) avait la réputation d’être un homosexuel chevronné. Quant aux généraux homosexuels de l’armée allemande, de l’époque hitlérienne, leurs noms sont sur les lèvres de tous… Goering, Himmler, Roehm, et même Hitler. Le scandale du Général Eulenburg dans l’armée du Kaiser Guillaume II sous le Deuxième Reich, ou bien l’affaire des cadets du collège militaire en Argentine en 1942, ont bel et bien fait date. Le comportement erratique de l’ancien commandant en chef de l’Armée suisse Roland Nef serait lié à une homosexualité réprimée. Le film « Der Fall Des Generalstabs-Oberst Redl » (1931) de Karl Anton raconte la vie d’un militaire homosexuel, Alfred Redl, ayant réellement eu des pratiques homosexuelles. En 1946, le gouverneur militaire de Melilla est homosexuel et force Juan Soto à coucher avec lui (Fernando Olmeda, El Látigo Y La Pluma (2004), p. 89). « Il avait dix-sept ans à présent, presque dix-huit, comme moi. Nous avions tous deux connu cinq ans de souffrance dans ce lycée militaire où nos familles respectives nous avaient envoyés, avec l’espoir que cette éducation virile anéantirait notre imaginaire. Dans un esprit de pédagogie et de feinte gentillesse, ils avaient formé le plan de nous éliminer. Nous avions construit, Ernestito et moi, un jeu de miroirs qui allait devenir notre planche de salut : chacun de nous était tantôt le personnage, tantôt le reflet, et nous ne nous quittions pas. Ce rituel allait nous permettre de survivre aux innombrables épreuves d’humiliation auxquelles cette ‘formation’ se prête volontiers. » (Alfredo Arias, Folies-Fantômes (1997), pp. 189-190)
Le militaire ou le flic homosexuels apparaît maintenant dans bien des publicités et des discours : pensons aux flics des dessins pornographiques homosexuels de Roger Payne ou de Tom of Finland, au personnage du policier dans le groupe des Village People, à la publicité pour la voiture Renault Clio (2010), etc.
Le militaire gay est souvent une projection des communautaires homosexuels eux-mêmes, qui attribue aux corps armés leurs propres fantasmes de dictature et de luxure (des fantasmes prenant parfois la forme allégorique de la femme fatale incestueuse) : « Les militaires aussi sont des folles, c’en est même incroyable, ce sont les plus folles de tous ! Sadiques. Elles organisent des séances de torture, et tout ça… Et puis elles sont mariées avec les femmes les plus laides du monde, les plus monstrueuses. Elles ne les baisent jamais, d’ailleurs, on s’en doute. » (Copi dans son interview par Alberto Cardin, dans le journal Libération du 10-11 juin 1978) ; « Quand notre neveu [Alfredo] a fait le lycée militaire, il croyait voir parfois, entre ces hommes en uniforme, les fantômes d’une femme qui apparaissait et disparaissait. Laquelle d’entre nous était-ce ? Qui de nous trois pouvait-ce être ? » (une des 3 tantes d’Alfredo Arias, dans l’autobiographie de ce dernier Folies-Fantômes (1997), p. 148)
D’ailleurs, sur certains lieux de drague homosexuelle, il arrive que des hommes homosexuels se déguisent en flics pour satisfaire leurs appétits sexuels et pratiquer les actes homosexuels sans craindre d’être découvert : « Ces ‘tasses’ restent le lieu de prédilection des invertis. C’est là que se nouent les idylles, là que l’on s’échange les adresses de rendez-vous ; c’est là aussi qu’opèrent les faux frères, les truqueurs, les faux policiers : tout y est permis puisque, en général, les victimes, par crainte du scandale, ne portent pas plainte. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 24) ; « Des fois il y en a qui attaquent tout de suite en disant ‘Tu prends combien ?’, mais ceux-là, je ne leur réponds pas, j’ai toujours peur que ce soient des flics. » (Pierre Benichou parlant de l’ambiance dangereuse des lieux de drague homo, dans le journal Le Nouvel Observateur, p. 44)
g) Le soldat-paon :
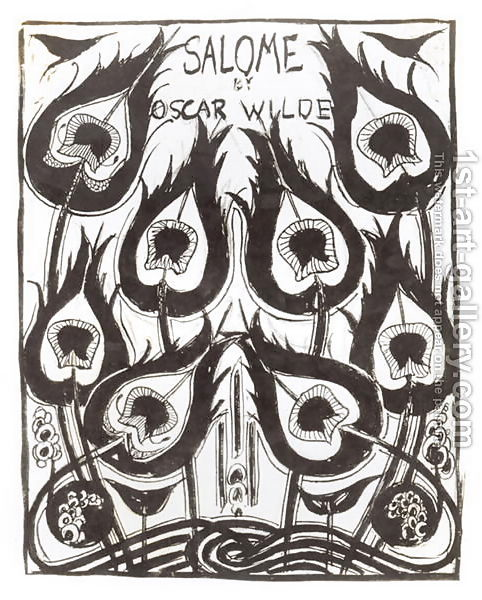
Illustration d’Aubrey Beardsley pour « Salomé » d’Oscar Wilde : « la Robe de Paon »
L’identification au despote orgueilleux se fait parfois par le biais du sentiment amoureux esthétisé sous la forme d’un animal : le paon. Par exemple, dans son recueil de poèmes La Danse de Sophocle (1912), Jean Cocteau s’illustre en animal mi-homme mi-paon. On retrouve la femme-paon chez Alfred Hitchcock, l’humoriste Jarry, ou bien chez Thierry Le Luron (qui imite Line Renaud). Il est curieux d’observer qu’en Espagne la culture de la frivolité camp féminisante qui a émergé sous le franquisme et qui perdure aujourd’hui soit appelée « la Pluma » (traduction : « la plume »). Au Venezuela, quand on suspecte quelqu’un d’être homo, on lui dit qu’on lui voit les plumes : « Se le salen las plumas… »

Collection Spring Summer de Thierry Mugler
La « follitude » (la féminité fatale singée) est souvent appréhendée comme un instrument de pouvoir, de propagande, et de soumission : « Une nouvelle surprise m’attendait : mon gitan ‘grand et beau’, une fois la lumière éteinte, s’avéra une triste ‘lopette’ plus efféminé qu’il n’est permis de l’être. Poussant des cris de paon, il provoqua presque un scandale dans l’hôtel. » (Jean-Luc, 27 ans, dans l’essai Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970) de Jean-Louis Chardans, p. 109) ; « La folle est une forme de concession à la répression, afin d’en atténuer les effets. » (Jean-Yves Le Talec, Folles de France (2008), p. 36. C’est moi qui surligne.) ; « Ce qui comptait, c’était de se pavaner comme un paon. » (Steve Blame parlant du vent de « liberté » homosexuelle au Studio 54 à New-York à la fin des années 1970, interviewé dans le documentaire « Somewhere Over The Rainbow » (2014) de Birgit Herdlitschke, diffusé en juillet 2014 sur la chaîne Arte)
h) Le despote homosexuel :

B.D. « Le Monde fantastique des gays » de Copi
Il serait bien sûr erroné de penser que les caricatures des despotes mondiaux en homosexuels sont soit totalement révélatrices (l’homosexualisation des hommes de pouvoir qu’on veut discréditer, affaiblir, ridiculiser, est une stratégie bien connue de dévalorisation : même le Pape en fait les frais…) soit totalement infondées. Car en effet, dans l’Histoire mondiale internationales, il y a eu des cas avérés de dictateurs et d’hommes politiques – ce qui ne va pas nécessairement ensemble, je me permets de le dire – qui ont été bisexuels voire homosexuels pratiquants : Néron, Frédéric II de Prusse, Édouard II (amoureux de son favori Gaveston) et Jacques Ier d’Angleterre, Henri III, Rodolphe II, Alexandre de Macédoine, le Sultan Mehmet Fatih (Mehmet II, le conquérant de Constantinople), le Sultan Suleyman Kânouni, Mustapha Ataturk de Turquie, Louis II de Bavière, etc. Pour de plus amples détails, je vous conseille la lecture du Dictionnaire des chefs d’État homosexuels ou bisexuels (2004) de Didier Godard, du Dictionnaire des homosexuels et bisexuels célèbres (1997) de Michel Larivière, ou bien de la partie « Grands Hommes » du code « Défense du tyran » dans mon Dictionnaire des Codes homosexuels) Hitler (cf. la biographie La Face cachée d’Hitler (2002) de Lothar Machtan), Charles XII de Suède, Christian VII de Danemark et de Norvège, Guillaume III d’Orange-Nassau, Édouard VIII de Grande-Bretagne, José Antonio Primo de Rivera, Tibère, Jules César, Agélisas II, Caligula, etc.
« Si l’on brûlait tous ceux qui font comme eux, dans bien peu de temps, hélas, plusieurs seigneurs de France et prélats d’importance souffriraient le trépas. » (cf. la chanson « La Complainte de Chausson et Fabbri », tous deux exécutés pour sodomie en 1661) ; « Il existe, chez les grands meneurs d’hommes, un tel sens de la virilité que, souvent, cette prédilection pour la beauté et la force physique du mâle dégénère en un attachement contre nature. Il n’y a pas lieu, ici, de condamner ou d’approuver. On se borne à constater cette particularité et à relever quelques-uns des plus frappants exemples de l’histoire. Au-delà de l’histoire, cependant, la légende ! Car la légende, avant l’histoire, est fertile en témoignages sur les penchants homosexuels des conducteurs de l’humanité. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 213) ; « [Au Grand Siècle français] L’homosexualité reparaît, plus triomphante que jamais, sous Louis XIII et Louis XIV. Un grand nombre de hauts personnages s’y livrèrent ouvertement et l’on compte parmi eux le frère de Louis XIII, Gaston d’Orléans, et ses familiers : le duc de Bellegarde, le chevalier de Lorraine ; Monsieur, frère de Louis XIV, le duc de Vendôme, qui fut accusé du ‘ragoût d’Italie’, dit Tallemant des Réaux ; le fils du maréchal de Villars, surnommé ‘l’ami des hommes’ ; le Grand Condé, le duc de Vermandois, le prince de Conti, le Grand Dauphin, ainsi que le comte de Gramont. Le vice contraire fut fort répandu parmi les dames de la cour. Madame de Maintenon et Ninon de Lenclos, Adelaïde de Savoie, la Princesse de Monaco et Christine de Suède en furent très longtemps les championnes. » (idem, p. 140) ; « Catherine de Russie, la Grande Catherine, sur ses vieux jours, après avoir épuisé plusieurs centaines d’amants, préféra les femmes et ses maîtresses furent aussi nombreuses que les premiers. Édouard II et Jacques Ier, en Angleterre. » (idem, p. 141) ; « Guillaume II est superficiel et agité, incapable de travailler sérieusement, sentimental et théâtral, arrogant et parfois même violent, et il recherche les applaudissements comme un homme de théâtre. » (Baechler cité dans l’essai Le Rose et le Brun (2015) de Philippe Simonnot, pp. 48-49) ; « Je suis une terroriste du Genre ! » (Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla) ; « On est une armée, un mouvement pour faire bouger les choses. » (Ann Northrop, activiste d’Act-Up aux États-Unis, dans le documentaire « Lesbiennes, gays et trans : une histoire de combats » (2019) de Benoît Masocco) ; etc.
L’abbé séculier Brantôme, chroniquant les mœurs légères de la cour française au XVIe siècle dans La Vie des dames galantes, nous a dressé le portrait de beaucoup de dames de compagnie qui, jour et nuit, au nombre de deux ou trois cents, s’unissaient corporellement. « À cette époque (1596), Paris aussi bien que la Cour regorgeait de femmes lesbiennes, que les maris tenaient d’autant plus chères qu’avec elles, ils vivaient sans jalousie. Les unes, sans s’en cacher, nourrissaient des belettes, dont les Anciens usaient comme des lettres hiéroglyphiques pour signifier des tribades ; les autres s’échauffaient avec leurs adorateurs, sans consommer l’acte d’amour, et sans pour autant vouloir les contenter puis venaient se rafraîchir avec leurs compagnes. » (Henri Sauval, Amours des Rois de France, 1739)
Des hommes politiques tels qu’Héliogabale, Jules César, Henri III, Catherine II, Néron, se sont vraiment travestis. « Néron s’habillait non seulement en femme, le plus souvent en courtisane de basse classe, poussant son vice jusqu’à épouser un esclave affranchi. Héliogabale, un des derniers empereurs romains, multiplia les extravagances et se prostitua dans les bas quartiers de Rome. » (Jean-Louis Chardans, Histoire et anthologie de l’homosexualité (1970), p. 285) Christine de Suède (1626-1689), par exemple, refusa de se marier et passa une bonne partie de sa vie habillée en homme.
La bisexualité de Mao Zedong – qui a pourtant persécuté de son vivant les personnes homosexuelles – est abordée par exemple dans l’essai Assises de la mémoire gay, gays et lesbiennes en Chine (2004) des Actes des troisièmes assises internationales (p. 57). En 2017, le président des Philippines, Rodrigo Dutertre, a avoué sa bisexualité.

Yukio Mishima
L’écrivain homosexuel japonais Yukio Mishima est allé jusqu’à fonder un régime militaire et sa propre secte mystico-militaire qu’il a baptisée « la Société du Bouclier » : « Je me suis fait réprimander en ces termes : ‘Dis donc, tu ne serais pas un peu facho ?’ » (Yukio Mishima, Correspondance 1945-1970 (1997), p. 93) D’ailleurs, dans son récit de la journée du putsch raté de l’écrivain le 25 novembre 1970, Marguerite Yourcenar compare Mishima à un dictateur à son balcon (cf. l’article « Yukio Mishima, La nostalgie du Japon classique » de Marguerite Yourcenar, cité sur le site www.islaternura.com, consulté en janvier 2003).
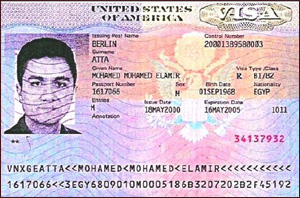
Mohammed Atta
Plus proche de nous, Mohammed Atta, l’un des 4 terroristes du 11 septembre 2001, et membre d’Al Qaïda, était homosexuel. En 2011, des rebelles libyens ont découvert des DVD pornos gay dans le bureau de la villa de Saadi Kadhafi, le 3ème fils du colonel. Certains jeunes islamistes (Omar Mateen et tant d’autres) s’attaquent aux personnes homos parce qu’ils sont eux-mêmes homos pratiquants. Sur l’édito « Hitler et les talibans » de Thomas Doustaly, dans la revue Têtu (n°60, novembre 2001), il est question d’études sociologiques qui ont été faites sur l’homosexualité chez les talibans (données qui sont évidemment méprisées et caricaturées par la comité de rédaction de Têtu). Je vous renvoie à tous les cas d’homophobie actuels dans lesquels est systématiquement observable l’homosexualité refoulée (mais aussi célébrée !) des persécuteurs des personnes homosexuelles (cf. je vous renvoie au code « Homosexuel homophobe » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels).

Ce n’est pas un hasard si ce sont souvent les milieux sociaux les plus stricts, où le culte de la personnalité est un objectif, où la différence des sexes est très marquée ou paradoxalement gommée – le sport, la mode, l’art, la politique, la télé, la religion, la danse, etc. – qui accueillent le plus de personnes homosexuelles. « Dans les pays fascistes, l’homosexualité, ruineuse pour la jeunesse, fleurit impunément. Dans le pays où le prolétariat s’est audacieusement emparé du pouvoir, l’homosexualité a été déclarée crime social et sévèrement punie. » (Gorki, Humanisme prolétarien, 1934)
Le totalitarisme, fort heureusement, ne débouche pas toujours sur une dictature nationale réelle, mais reste à l’état de fantasme inassouvi chez la majorité des personnes homosexuelles, fantasme qui sera d’autant plus actualisable qu’il n’est pas souvent conscientisé et reconnu humblement par ces dernières : « Je sais que c’est moi le dictateur, moi qui ne laisse aucun espace pour la contradiction. […] Je ne suis pas un metteur en scène, je suis un contremaître. […] Suis-je devenu en deux films un cinéaste de droite ? » (Christophe Honoré dans son autobiographie Le Livre pour enfants (2005), pages 116, 125, puis 141) ; « Mon premier soin, quand je serai dictateur, ce sera de faire pendre haut et court un psychiatre, de préférence un psychanalyste. » (Marcel Arland dans l’autobiographie Le Privilège des jonquilles, Journal IV (2006) de Pascal Sevran, p. 204) ; « Ami du théâtre, bonjour ! Voici une pièce où joue un copain de lycée, Alexis Wininger surnommé par moi Anicétus à l’époque où je me prenais pour Néron 😉 Si tu peux la voir, dis-moi ce que tu en penses. » (cf. le mail d’un ami homo, Sylvain, 32 ans, reçu en novembre 2010) ; etc. Par exemple, dans son documentaire « Des filles entre elles » (2010) de Jeanne Broyon, la réalisatrice lesbienne Jeanne Broyon se met le masque de Ben Laden sur le visage. Les artistes homosexuels interprètent à maintes reprises des rôles de dictateurs (Tim Curry, Marlon Brando, David Bowie, Elton John travesti en Marie-Antoinette, Freddie Mercury déguisé en roi lors des concerts de Queen, etc.). L’acteur Maurice Escande, par exemple, joue exclusivement les personnages de monarques dans des films historiques. Dans le spectacle musical Un Mensonge qui dit toujours la vérité (2008) d’Hakim Bentchouala, Jean Cocteau raconte son goût pour le terrorisme : il aime à se déguiser en fantômes pour faire peur aux autres.
i) L’armée homosexuelle :
La fusion entre totalitarisme et homosexualité ne se limite pas aux monarques d’antan. Elle s’élargit aux tenants de la culture homosexuelle contemporaine : les militants d’association LGBT, les couples homosexuels dits « ordinaires » et les célibataires occasionnels, mais aussi les personnes transsexuelles (particulièrement utilisées comme épouvantails à moineaux sociétaux) : cf. le documentaire « La Terreur transsexuelle » (2007) d’Aykut Atasay, le documentaire « Transexual Menace » (1995), au film « Brüno » (2009) de Larry Charles, et au documentaire « Armée d’amour » (1978) de Rosa von Praunheim, etc. « Rien ne nous arrêtera ! » (Conchita Wurst, le chanteur autrichien barbu travesti M to F, après sa victoire à l’Eurovision en juin 2014) Par exemple, Michel Dorais propose très sérieusement d’organiser une « Gayrilla » (2005) contre l’homophobie. Pendant la soirée thématique « La Représentation LGBT à la télévision française » organisée au Centre LGBT de Paris le 24 juin 2010, l’homme transsexuel M to F Pascale Ourbih n’arrête pas d’employer le lexique du combat : « Tant qu’on n’a pas gagné sur tous les fronts, c’est le même combat. » Dans le militantisme homosexuel français s’illustrent différents « groupes commandos » tels que le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (1971), les Groupes de Libération Homosexuelle (1974), le Comité d’Urgence Anti-répression Homosexuelle (1979), Act-Up (1987), etc. Les Panthères roses, SOS Homophobie, Ni Putes Ni Soumises, et Act-Up constituent une forme de « police rose ».
En ce qui concerne le despotisme homosexuel à échelle communautaire, je vous renvoie au code « Milieu homosexuel infernal » de mon Dictionnaire des Codes homosexuels. Beaucoup de personnes homosexuelles décrivent le « Milieu homosexuel » comme une dictature, un paradis de la consommation et de l’apparence, avec des légions de clones militaires.
j) La politique expansionniste du milieu homo : le fascisme gay

B.D. « Kang » de Copi
Il arrive que certains individus homosexuels ne se fassent pas à l’idée que, selon eux, le monde soit « non-homosexuel » ou ne soit pas « hétérosexuel ». Pour « libérer » chez tous ceux qui ne voient pas la sexualité comme eux « l’homosexuel qui serait en eux », beaucoup partent en croisade pour l’« amour libre » (homo, hétéro, bi, peu importe) : « Pour moi, j’imaginais que les gars devaient tous être homosexuels quelque part au fond. Je n’arrivais pas à croire que l’on puisse avoir du désir pour une femme, seulement pour une femme. Je me disais que c’était une bande de menteurs. Moi, au moins, j’étais honnête. » (un témoin interviewé dans l’essai Mort ou fif (2001) de Michel Dorais, p. 90) ; « La France est homosexuelle. » (Jeanne Broyon, la réalisatrice lesbienne du documentaire « Des filles entre elles », 2010) ; « Faire du monde ‘réel’ un monde tout homo. […] Comme l’écrivait déjà Gilles Deleuze dans Proust et les signes, ‘l’homosexualité est la vérité de l’amour’. C’est une telle expansion de l’homo-érotisme loin des petits sujets désirants, par-delà les labels d’homo ou d’hétéro, et peu à peu jusqu’aux plantes, aux mots perdus et même aux courants d’air, jusqu’au flou d’une complète indéfinition, qui fait de Proust à son insu le maître à penser, le plus grand répétiteur de toute la doctrine queer. » (François Cusset, Queer Critics (2002), pp. 166-167) ; « Oui, oui. On est mal-baisés ! Oui. On avait un humour époustouflant ! À partir de ce moment-là, j’étais persuadée que tout le monde était homosexuel. » (une témoin lesbienne de 70 ans, dans le documentaire « Les Invisibles » (2012) de Sébastien Lifshitz) ; « Nous, le féminin, nous allons occuper votre espace. Nous allons faire de nos corps des armes. » (Linn, jeune homme brésilien travesti en femme, dans le documentaire « Bixa Travesty » (2019) de Kiko Goifman et Claudia Priscilla) ; etc. Par exemple, dans l’émission de Patrick Buisson traitant du « communautarisme gay » sur la chaîne LCI en 2003, Alain Soral définit le mouvement gay de « réactionnaire » (il parle « tapettocentrisme »)… et au même moment, l’écrivain homosexuel Guillaume Dustan soutient qu’« il faut démocratiser l’homosexualité car tout le monde est bisexuel ».
Cette homosexualisation de la terre entière commence par la blagounette… et puis la blague devient parfois beaucoup plus sincère que prévu. « La queerisation tant souhaitée de la société, autrement dit l’éradication des ‘catégories sexuelles’, si elle se réalise jusqu’au bout, sera aussi un grand moment de criminalisation générale et de nettoyage des derniers résidus du vieux monde. Un grand épisode d’épuration. Ni homme ni femme nulle part, mais des Vigilants et des Dénonçants partout. Plus de sexes mais du sexe. Du sexe partout parce que plus de sexes. » (Philippe Muray, Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 68) ; « Cette subversion vise à terme à instaurer la dictature d’une minorité. » (Élizabeth Montfort, Le Genre démasqué (2011), p. 43) ; « On ne s’arrêtera jamais. Le progrès de la démocratie, c’est ça. » (Louis-Georges Tin dans le documentaire « Homo et alors ?!? » (2015) de Peter Gehardt) ; etc. À présent, des intellectuels (de droite comme de gauche, homosexuels ou non) décrivent la dérive totalitaire de la communauté homosexuelle actuelle (cf. l’essai Les Maîtres Censeurs (2002) d’Élisabeth Lévy, l’essai Épître à nos nouveaux maîtres (2002) d’Alain Minc, l’essai La Tentation de l’innocence (1995) de Pascal Bruckner, l’essai Big Mother (2002) de Michel Schneider, l’essai Les Martyrocrates (2004) de Gilles William Goldnadel, l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, etc.). Dans le documentaire « Act-Up – On ne tue pas que le temps » (1996) de Christian Poveda, la fameuse association activiste homosexuelle Act-Up est accusée de « totalitarisme intellectuel » par le ministre de la santé Hervé Gaymard… ce que ses militants ne semblent pas démentir en actes et en discours : « Act-Up, c’est une société de nettoyage en quelque sorte. » ; « J’ai eu l’impression d’être dans un mouvement qui n’avait plus rien à voir avec la lutte contre le Sida, un mouvement qui disait le bien et le mal de manière totalement totalitaire. » (Pierre Kneip au sujet d’Act-Up, cité dans l’essai Le Rose et le Noir (1996) de Frédéric Martel, p. 526)
Les slogans des militants homosexuels deviennent de plus en plus menaçants et belliqueux. Ils prennent des tournures qui suggèrent le caprice mégalomaniaque victimisant : « L’homosexualité n’a pas de frontières » (pour la Journée Internationale contre l’Homophobie de 2009 en France) ; « Le changement c’est maintenant ! » (cf. slogan indigent de la campagne de François Hollande aux élections présidentielles françaises de 2012) ; « L’Égalité n’attend plus ! » (pour la Gay Pride parisienne en juin 2012) ; « La France est toujours à la traîne. » (Florence d’Arthuy souhaitant élargir la pratique de la PMA et la GPA à toute la Nation française, dans son documentaire « Homos, et alors ? » diffusé dans l’émission Tel Quel, sur la chaîne France 4, le 14 mai 2012) ; « Les gouines, les pédales, seront le genre humain ! » (cf. le détournement de l’International par quelques Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, dans le documentaire « Et ta sœur ! » (2011) de Sylvie Leroy et Nicolas Barachin) ; « Avec une mentalité pareille, ce n’est pas demain qu’on va prendre en main les commandes de la planète ! » (p. 235) (Paula Dumont critiquant les femmes « hétérosexuelles », dans son autobiographie La Vie dure : Éducation sentimentale d’une lesbienne (2010), p. 235) ; « Nous, gays et lesbiennes, les masses de marginaux et des laissés-pour-compte, dissidents, hétérodoxes et non-conformes de tout poil, nous sommes le vecteur d’une nouvelle et inédite organisation de l’humanité. Rebellons-nous contre ceux qui nous divisent ! Ce que nous avons entendu ici ce soir, il faut le crier sur les toits ! » (Marisol, le transsexuel M to F, dans l’article « Crónica Auténtica De Lo Acontecido En Un Pub De Chueca Una Noche De Verano » de J. A. Herrero Brasas, dans l’ouvrage collectif Primera Plana (2007), p. 123)
Les soirées-débats organisées par des associations homosexuelles classiques finissent parfois par des envois de ce type : « Courage mes frères. La lutte continue ! » (cf. la phrase de Bruno venant clore le débat sur l’homoparentalité, organisé au bar Le Cargo d’Angers (France) en 2002) ; « Il nous faut suivre le ‘Droit Chemin’ de l’homosexualité. » (cf. la phrase de conclusion de l’exposé de l’homme transsexuel Natacha aux JAR de l’association David et Jonathan au Mont Dore, en 2004) Dans le documentaire « Tellement gay ! Homosexualité et Pop Culture, Out » (2014) de Maxime Donzel, il est question de « faire vivre cette culture dont la portée ne cessera jamais d’être politique » : cette culture libertaire, cela va de soi. Lors de sa conférence pour présenter son essai Délinquance juvénile et discrimination sexuelle au CGLBT de Paris en janvier 2012, Sébastien Carpentier a encouragé fortement les interventions en milieu scolaire : « Les interventions en milieu scolaire, il faut vraiment les développer. […] Il faut vraiment sensibiliser les parents. » ; il justifie le plus sérieusement du monde que le « Genre » soit une « police ». Dans le documentaire « La Grève des ventres » (2012) de Lucie Borleteau, le Collectif « Grève du ventre » (homo ? bi ? en tous cas, « queer ») est un groupe commando menant une politique expansionniste pour que les femmes « arrêtent de faire des enfants ». Dans l’essai Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, le lexique guerrier est omniprésent dans tous les articles. En parcourant l’univers documentaire de la communauté homosexuelle, on tombe souvent sur de véritables films de propagande, des reportages résonnant comme des appels à la violence proférés par des militants homosexuels zélés tenant un discours belligérant. Par exemple le reportage « The Edge Of Each Other’s Battles : The Vision Of Audre Lorde » (2002) de Jennifer Abod nous montre une Audre Lorde qui se comporte comme un vrai gourou, une femme-dictateur prônant le féminisme noir lesbien. Saisissant.
Les militants homosexuels deviennent de plus en plus gourmands de droits, parce qu’ils ne veulent pas régler la question de la haine de soi, si centrale dans la communauté homosexuelle. « Ainsi glisse-t-on, sans crier gare, du PaCS – évident – au droit à l’adoption – plus complexe. De la répression des discriminations – impérative à la revendication de la spécificité – inacceptable – […] de la solidarité entre brimés – naturelle – à la transformation en un appareil de pouvoir – illégitime. » (Alain Minc, Épîtres à nos nouveaux maîtres (2002), p. 54) ; « Vous êtes une maçonnerie comme une autre. […] Est-ce un procès en sorcellerie ? Autant que pour les autres confréries ; ni plus, ni moins. Le sentiment d’exclusion conduit à des réflexes de solidarité et ceux-ci engendrent tout naturellement des réseaux de pouvoir. » (idem, p. 74) ; « Les plus radicaux ne se cachent pas, d’avoir une conception très extensive de la pénalisation de l’homophobie, et ne se gênent pas pour écrire qu’elle ‘ne doit pas se limiter aux seules insultes ou violences, mais doit être élargie à l’homophobie discursive de certain(e)s intellectuel(s) supposé(e)s bien-pensant(s).’ Il s’agit donc bien d’une loi des suspects destinée à interdire toute expression jugée non correcte et même à bâillonner tout contradicteur potentiel, si possible avant même qu’il se soit manifesté, fût-ce de manière discursive. » (Philippe Muray, Festivus festivus : Conversations avec Élisabeth Lévy (2005), p. 127)
Généralement, les personnes homosexuelles ou gay friendly nous rient au nez quand on leur parle de « lobby gay » (cf. la conférence « Le Lobby gay… Un bruit de couloir » à l’Amphithéâtre Érignac à Sciences Po Paris le mardi 22 février 2011), alors que pourtant, il existe bien, ce groupe de pression, qui, au moins dans la sphère médiatique, a su s’imposer massivement depuis quelques décennies, au point que maintenant, dans les pays occidentaux, plus beaucoup de personnes se choquent de légaliser le mariage homosexuel.

La communauté homosexuelle, depuis les années 1960-1970, s’est transformée en police de la pensée et de la bonne intention. « Maintenant est venu le moment de continuer à défendre la Société de l’Arc-en-ciel : une société ouverte, plurielle, métisse, où tout le monde sans exception à sa place. […] Plus que jamais, nous devons être actifs dans la lutte pour la liberté, l’égalité et la fraternité. » (Pedro Zerolo cité dans l’ouvrage collectif Primera Plana (2007) de Juan A. Herrero Brasas, p. 50) ; « Nous sommes particulièrement fiers de programmer une séance d’éducation à l’image réservée aux collégiens afin de les sensibiliser aux questions de genre et au problème de l’homophobie. » (l’acteur transsexuel M to F Pascale Ourbih, éditorial de la plaquette du 17e Festival Chéries-Chéris, le 7-16 octobre 2011, au Forum des Images de Paris) ; etc. C’est l’idéologie de la « diversité, de l’hétérogénéité, de l’hétérodoxie » (Juan A. Herrero Brasas, Primera Plana (2007), p. 9), mise paradoxalement à plat par le désir insistant d’égalité, qui est matraquée. Par exemple, dans l’article « Esta Batalla La Vamos A Ganar » tiré du même essai d’Herrero Brasas, la militante lesbienne espagnole Boti García Rodrigo arrive quand même à employer le mot « égalité » rien moins que 26 fois ! (sur un espace textuel de seulement 7 pages, il fallait le faire !). En réalité, l’éloge de la diversité et de l’égalité n’est souvent qu’une façade, un désir d’uniformité énonçant que tous les homos sont les mêmes ou bien que tout le monde est homosexuel. C’est la chasse au Réel, et à l’Amour pour le coup, qui est lancée. Par exemple, dans la devise inscrite sur le guide Gay-Friendly France (2000) édité par l’Office français du Tourisme (« Égalité, Fraternité, Diversité »), le pluralisme uniformisant – appelé « Diversité » – a pris bizarrement la place de la Liberté… En octobre 2004, les slogans choisis pour l’ouverture de la chaîne Pink TV en France étaient « Le Liberté, ça se regarde » ainsi que « Liberté, Égalité, Télé ». Le mot « Fraternité » a été éjecté au profit de l’image médiatique, de la machine.
La communauté homosexuelle fictionnelle élève le culturel sur un piédestal, sans penser que tout système totalitaire est aussi culturel que les cultures humanistes (puisque tout ce qui est humain est à la fois naturel et culturel). Elle cherche à s’imposer par le sentiment et des concepts fleur bleue déconnectés du réel, vides de sens (« la tolérance », « l’égalité », « la liberté », « l’amour »…). Or, comme l’explique à juste titre Pierre Jourde dans son essai La Littérature sans estomac (2002), « il n’y a guère de dictatures qui ne se réclament de la démocratie et de la liberté. » (p. 48) L’enfer totalitariste est réellement pavé de bonnes intentions !
L’homophobie (réelle mais surtout fantasmée) sert d’alibi à beaucoup de personnes homosexuelles pour justifier leurs actes homosexuels les plus violents et les plus hypocrites, justifier tous leurs caprices : « Il n’y aurait pas eu toutes ces manifs pour tous, je crois que je ne me serais pas mariés. C’est plus un acte militant [contre l’homophobie] qu’un mariage d’amour. » (Pierre parlant de son « mariage » avec Bertrand, dans l’émission Infra-Rouge du 10 mars 2015 intitulée « Couple(s) : La vie conjugale » diffusée sur France 2)
Le plus inquiétant, c’est qu’actuellement, le lobby hétéro gay friendly sait très bien jouer sur l’ignorance populaire en matière d’Histoire (ignorance qui a atteint les hautes sphères du pouvoir politique), sur la culpabilité mondiale et la corde sensible de l’homophobie, du machisme ou de l’esclavagisme, pour asseoir sa bien-pensance. Tout l’art des groupes féministes, marxistes, et maintenant LGBT. Les prétentions anti-esclavagistes de ces nouveaux mouvements esclavagistes prêteraient presque à sourire si ces derniers n’étaient pas aussi sérieux et intolérants aux différences fondatrices (différence des sexes + différence Créateur/créatures) et aux personnes, dans les faits…
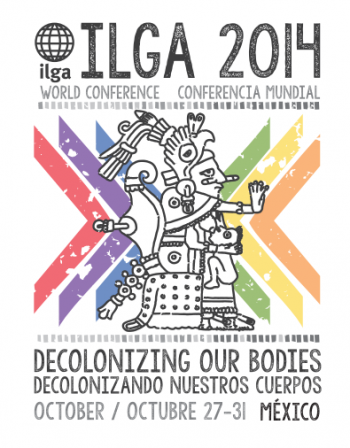
« Décolonisez vos corps » (… car la sexuation naturelle, c’est l’Esclavage colonialiste, bien sûr…)
k) Mappemonde :
La vision de l’existence qu’adoptent beaucoup d’individus homosexuels étant homosexualo-centrée, narcissique, faussement humaniste (puisqu’elle est déconnectée du réel et très liée à la pulsion fantasmatique), médiatique, il arrive qu’ils le réduisent à une mappemonde, à un petit écran de télévision ou d’ordinateur portable, à un miroir d’eux-mêmes ou de l’être aimé, à un globe terrestre qu’ils peuvent tenir dans leurs mains en se prenant pour les Créateurs du Monde : je vous renvoie à tout l’univers visuel des premières années de la chaîne télévisuelle franco-allemande ARTE (particulièrement gay friendly), à l’esthétique de Philippe Decouflé.

Le monde miniature à portée de main symbolise au fond l’étroitesse de la conception libertine de l’Amour, la brutalité anesthésiante et amnésique du viol : « J’étais dans le sommeil. Je flottais. Le monde était devenu bleu et moi, petit et grand, bientôt très grand, bientôt avec une autre image de moi-même. Me construire autrement, dans une autre vie. » (Abdellah Taïa décrivant ses impressions pendant qu’il se fait violer, dans son autobiographie Une Mélancolie arabe (2008), p. 17) ; « J’ai couché avec la terre entière. Enfin, j’ai fait ce que j’ai pu. C’est une phrase un peu donjuanesque. » (Pierre Démeron, homosexuel de 37 ans, au micro de Jacques Chancel, dans l’émission Radioscopie sur France Inter, 3 avril 1969) ; etc.

« Le Livre Blanc » de Copi
Pour accéder au menu de tous les codes, cliquer ici.